Version complète : Cinéma
Forum de Culture PSG > Les forums du Bas : Parce que la communauté ne parle pas que de foot > Forum Sports et Loisirs
Pages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
2001 c'est le genre de films où si tu n'es pas dans l'ambiance, c'est difficile d'accrocher vu que ça correspond pas tellement aux normes cinématographiques vu que le rythme pourra sembler bien lent à certains, et que ça se ressent plus que ne s'explique. Par contre si tu es pris dans le truc, l'expérience peut être assez marquante. Surtout dans de bonnes conditions, c'est le genre de films que j'aurais adoré découvrir au ciné.
Je viens de lire une explication de la fin dite par Kubrick lui-même je me demande si c'est une blague 
Je viens de lire une explication de la fin dite par Kubrick lui-même je me demande si c'est une blague 
C'est quoi? Je sens que c'est du foutage de gueule
2001 c'est le genre de films où si tu n'es pas dans l'ambiance, c'est difficile d'accrocher vu que ça correspond pas tellement aux normes cinématographiques vu que le rythme pourra sembler bien lent à certains, et que ça se ressent plus que ne s'explique. Par contre si tu es pris dans le truc, l'expérience peut être assez marquante. Surtout dans de bonnes conditions, c'est le genre de films que j'aurais adoré découvrir au ciné.
J'ai pas réussi à comprendre comment tu peux être pris. J'imagine que c'est expérimental mais j'arrive pas à voir le truc. Alors que j'aime bien Kubrick niveau expérimental orange mécanique je comprends mais 2001 je trouve vraiment que c est une imposture.
C'est quoi? Je sens que c'est du courage de gueule
https://www.ecranlarge.com/films/news/10268...terview-inedite
Non c'est pas du foutage de gueule, la théorie d'une intervention d'une intelligence extra-terrestre qui aurait modifié la nature de l'espèce humaine pour la sortir de la bestialité commençait à devenir populaire à l'époque du film.
Mais 2001 ne le regardez jamais sur une petite télé en faisant autre chose, c'est comme mélanger du caviar avec du tarama et s'étonner que ce ne soit pas si bon...
Mais 2001 ne le regardez jamais sur une petite télé en faisant autre chose, c'est comme mélanger du caviar avec du tarama et s'étonner que ce ne soit pas si bon...
Quelle que soit la théorie que les uns et les autres avancent, c'est pas le plus important, y a pas de mal à admettre qu'on est simplement pas en mesure de décortiquer une scène ou un film, c'est pas ça qui empêche d'en apprécier le visionnage et de se sentir inspirés. Perso les dernières minutes (je parle plus du trip visuel que de l'image de fin que je trouve assez pompeuse) je les avais plus ressenties comme la porte vers une dimension supérieure et les limites de la compréhension humaine, et je trouve qu'elles sont une représentation assez brillante de ça, mais j'aime bien l'autre explication. Enfin bon, faut pas chercher à tout rationaliser, ça doit être plus viscéral que ça 
J'ai pas réussi à comprendre comment tu peux être pris. J'imagine que c'est expérimental mais j'arrive pas à voir le truc. Alors que j'aime bien Kubrick niveau expérimental orange mécanique je comprends mais 2001 je trouve vraiment que c est une imposture.
Non mais tu peux dire que tu n'aimes pas pour ci ou ça mais qualifier 2001 Odyssée de l'espace d'imposture
T'es fou frère.
Un des plus grand film de l'histoire du cinéma.
Non c'est pas du foutage de gueule, la théorie d'une intervention d'une intelligence extra-terrestre qui aurait modifié la nature de l'espèce humaine pour la sortir de la bestialité commençait à devenir populaire à l'époque du film.
Mais 2001 ne le regardez jamais sur une petite télé en faisant autre chose, c'est comme mélanger du caviar avec du tarama et s'étonner que ce ne soit pas si bon...
Mais 2001 ne le regardez jamais sur une petite télé en faisant autre chose, c'est comme mélanger du caviar avec du tarama et s'étonner que ce ne soit pas si bon...
Monsieur mange du caviar.........
Monsieur mange du caviar.........
Pas assez souvent mais je suis d'origine russe c'est culturel....
Sinon pour ceux qui trouvent 2001 trop obscur jetez un coup d’œil à 2010 L'année du 1er contact, suite plus ou moins officielle signée Peter Hyams, c'est évidemment pas du même niveau mais pas du tout la bouse dénoncée quand c'est sorti, et ça donne quelques éléments de réponse aux questions posées dans le 1er.
Bah maintenant faut regarder le premier film "l'arnaqueur" de 1961.
Merci
Non mais tu peux dire que tu n'aimes pas pour ci ou ça mais qualifier 2001 Odyssée de l'espace d'imposture 
T'es fou frère.
Un des plus grand film de l'histoire du cinéma.
T'es fou frère.
Un des plus grand film de l'histoire du cinéma.
Non mais je comprends juste pas l'intérêt du film
Pas assez souvent mais je suis d'origine russe c'est culturel....
Sinon pour ceux qui trouvent 2001 trop obscur jetez un coup d’œil à 2010 L'année du 1er contact, suite plus ou moins officielle signée Peter Hyams, c'est évidemment pas du même niveau mais pas du tout la bouse dénoncée quand c'est sorti, et ça donne quelques éléments de réponse aux questions posées dans le 1er.
Sinon pour ceux qui trouvent 2001 trop obscur jetez un coup d’œil à 2010 L'année du 1er contact, suite plus ou moins officielle signée Peter Hyams, c'est évidemment pas du même niveau mais pas du tout la bouse dénoncée quand c'est sorti, et ça donne quelques éléments de réponse aux questions posées dans le 1er.
Si vous voulez les réponses à vos questions, lisez les livres bande d'incultes....
2001
2010
2061
Je pose ça là pour que les "racistes ragent" :
On espère un meilleur sort que ghostbuster ou ocean8, dommage je l'aimais bien daniel craig même s'il n'est plus tout jeune.
QUOTE
Une femme noire dans le costume de 007 pour le prochain James Bond
Alors que le prochain long-métrage est en cours de tournage, une source du Daily Mail vient de lâcher une bombe: l’interprète de Maria Rambeau dans Captain Marvel devrait incarner le célèbre agent secret.
Alors que rumeurs et polémiques affolent les réseaux sociaux pour savoir qui prendra la suite de Daniel Craig dans le costume de l’espion britannique, les scénaristes de James Bond ont décidé de prendre tout le monde de court. Dans le prochain long-métrage, qui sortira en avril, 007 sera incarné par une femme noire, selon une source citée par le Daily Mail . En l’occurrence, l’actrice britannique d’origine jamaïcaine Lashana Lynch.
Une femme pour 007
Toujours selon la source du quotidien anglais, le film débutera en Jamaïque alors que notre espion préféré coule
«Bond est toujours Bond, mais il a été remplacé en 007 par cette superbe femme»
Source du Daily Mail Online
des jours tranquilles en compagnie de Léa Seydoux, savourant une retraite bien méritée. Mais le repos jamais ne dure et il sera rappelé d’urgence au MI6 pour une crise planétaire globale. Arrivé au QG de l’agence, le fameux «entrez 007» résonne mais, surprise, c’est une femme noire, interprétée donc par Lashana Lynch (Captain Marvel), qui se présente devant M.
«C’est un moment à vous faire lâcher votre pop-corn» indique la source du journal britannique. «Bond est toujours Bond, mais il a été remplacé en 007 par cette superbe femme». Il est, «bien sûr, sexuellement attiré par la nouvelle et essaie ses tours de séduction habituels, mais il est déconcerté quand il s’aperçoit que ça ne fonctionne pas sur une jeune femme noire brillante, qui lève les yeux vers lui et n’a pas envie de sauter dans son lit. Certainement pas au début.» L’informateur a ajouté que maintenant le terme de «James Bond Girls» est interdit et qu’il faut à présent les appeler «James Bond Women».
Un James Bond post #MeToo
Cet énorme changement est probablement dû à Phoebe Waller-Bridge une des scénaristes du film, appelée spécialement par Daniel Craig pour s’assurer que la franchise de 57 ans évolue avec son temps. «On a beaucoup parlé de la pertinence de Bond à cause de qui il est et de la façon dont il traite les femmes» a-t-elle confié. La source du magazine a affirmé que le film «est un James Bond de l’ère moderne qui séduira la jeune génération tout en restant fidèle à ce que nous attendons tous d’un film de ce calibre. Il y a des séquences de poursuite, et des combats spectaculaires, Bond est toujours Bond mais il doit apprendre à gérer le monde de #MeToo».
Une chose est sûre: avec ce choix, le 25e volet des aventures de l’espion risque de sérieusement diviser les fans de la franchise. Alors, le changement était-il pertinent? Les inconditionnels de la saga auront la réponse le 8 avril prochain.
Lefigaro.fr
Alors que le prochain long-métrage est en cours de tournage, une source du Daily Mail vient de lâcher une bombe: l’interprète de Maria Rambeau dans Captain Marvel devrait incarner le célèbre agent secret.
Alors que rumeurs et polémiques affolent les réseaux sociaux pour savoir qui prendra la suite de Daniel Craig dans le costume de l’espion britannique, les scénaristes de James Bond ont décidé de prendre tout le monde de court. Dans le prochain long-métrage, qui sortira en avril, 007 sera incarné par une femme noire, selon une source citée par le Daily Mail . En l’occurrence, l’actrice britannique d’origine jamaïcaine Lashana Lynch.
Une femme pour 007
Toujours selon la source du quotidien anglais, le film débutera en Jamaïque alors que notre espion préféré coule
«Bond est toujours Bond, mais il a été remplacé en 007 par cette superbe femme»
Source du Daily Mail Online
des jours tranquilles en compagnie de Léa Seydoux, savourant une retraite bien méritée. Mais le repos jamais ne dure et il sera rappelé d’urgence au MI6 pour une crise planétaire globale. Arrivé au QG de l’agence, le fameux «entrez 007» résonne mais, surprise, c’est une femme noire, interprétée donc par Lashana Lynch (Captain Marvel), qui se présente devant M.
«C’est un moment à vous faire lâcher votre pop-corn» indique la source du journal britannique. «Bond est toujours Bond, mais il a été remplacé en 007 par cette superbe femme». Il est, «bien sûr, sexuellement attiré par la nouvelle et essaie ses tours de séduction habituels, mais il est déconcerté quand il s’aperçoit que ça ne fonctionne pas sur une jeune femme noire brillante, qui lève les yeux vers lui et n’a pas envie de sauter dans son lit. Certainement pas au début.» L’informateur a ajouté que maintenant le terme de «James Bond Girls» est interdit et qu’il faut à présent les appeler «James Bond Women».
Un James Bond post #MeToo
Cet énorme changement est probablement dû à Phoebe Waller-Bridge une des scénaristes du film, appelée spécialement par Daniel Craig pour s’assurer que la franchise de 57 ans évolue avec son temps. «On a beaucoup parlé de la pertinence de Bond à cause de qui il est et de la façon dont il traite les femmes» a-t-elle confié. La source du magazine a affirmé que le film «est un James Bond de l’ère moderne qui séduira la jeune génération tout en restant fidèle à ce que nous attendons tous d’un film de ce calibre. Il y a des séquences de poursuite, et des combats spectaculaires, Bond est toujours Bond mais il doit apprendre à gérer le monde de #MeToo».
Une chose est sûre: avec ce choix, le 25e volet des aventures de l’espion risque de sérieusement diviser les fans de la franchise. Alors, le changement était-il pertinent? Les inconditionnels de la saga auront la réponse le 8 avril prochain.
Lefigaro.fr
On espère un meilleur sort que ghostbuster ou ocean8, dommage je l'aimais bien daniel craig même s'il n'est plus tout jeune.
Je pose ça là pour que les "racistes ragent" :
On espère un meilleur sort que ghostbuster ou ocean8, dommage je l'aimais bien daniel craig même s'il n'est plus tout jeune.
On espère un meilleur sort que ghostbuster ou ocean8, dommage je l'aimais bien daniel craig même s'il n'est plus tout jeune.
C'est juste un personnage secondaire du film qui reprends le code 007, pas la nouvelle James Bond.
Max Richter ça fait toujours son effet.
Edward Furlong de retour en John Connor 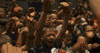
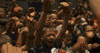
Dans le genre idée d'adaptation bien pourrie :
Attention, possible traumatisme après avoir vu cette vidéo
Attention, possible traumatisme après avoir vu cette vidéo
Non mais je comprends juste pas l'intérêt du film  je m'attendais à un moment de cinéma qui allait me coller à mon fauteuil et j'ai pas été pris, la partie avec Hal à la limite voire la fin ou il se passe enfin quelque chose.
je m'attendais à un moment de cinéma qui allait me coller à mon fauteuil et j'ai pas été pris, la partie avec Hal à la limite voire la fin ou il se passe enfin quelque chose.
L'intérêt est uniquement esthétique, en gros, trois heures d'images qui vont créer toute l'esthétique des 70's façon Hipgnosis (pochettes d'albums de Pink Floyd et Led Zep' notamment).
https://twitter.com/marvelstudios/status/1152751492555669504?s=12
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
https://twitter.com/marvelstudios/status/1152756007036018688?s=12
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Blade ca a mis sur le cul tout le monde 
Devant le succès de la saga Delon, cet été c'est Al Pacino :
A la découverte d’Al Pacino, une bête sauvage à la gueule d’ange
Par Samuel Blumenfeld
Al Pacino en six films cultes (1/6). Après l’avoir repéré sur les planches new-yorkaises, Jerry Schatzberg offre à l’acteur explosif son premier grand rôle au cinéma, en 1971, dans « Panique à Needle Park ».[/u][/u]
Lorsqu’il prend place, en février 1968, à l’Astor Place Theatre, sur Lafayette Street, en bas de Manhattan, Jerry Schatzberg se demande encore comment l’on prononce le nom de cet acteur dont on parle tant à New York. Doit-on dire « Pa-ssi-no » ou, comme bientôt plus personne ne l’ignorera, « Peu-tchi-no » ? Davantage que le mystère du nom, le visage du jeune homme intrigue Jerry Schatzberg. Ce photographe de mode réputé, connu notamment pour ses nombreux portraits de Bob Dylan et d’Aretha Franklin, s’apprête à réaliser son premier film, Portrait d’une enfant déchue, avec Faye Dunaway.
Pacino, constate Schatzberg, va avoir 28 ans, mais il arbore un air si innocent… Son visage ne cadre pas avec le rôle d’un des deux délinquants dans la pièce qu’il doit jouer ce soir à l’Astor Place Theatre, L’Indien cherche le Bronx, écrite par un jeune dramaturge, Israel Horovitz. Pacino y harcèle puis moleste un étranger à la recherche de son chemin, d’autant plus perdu qu’il ne parvient pas à se faire comprendre en anglais. Sa taille, 1,67 m, inhabituellement petite, remarque le photographe, devrait l’empêcher d’éclipser ses partenaires sur scène.
Et puis le nez du comédien, note Schatzberg, élégamment prononcé, à la rondeur harmonieuse, et son menton rectangulaire, évoquent une ressemblance évidente avec un autre comédien, Dustin Hoffman, dont le premier film, Le Lauréat, de Mike Nichols, triomphe de manière imprévue depuis sa sortie, en décembre 1967.
Du reste, les carrières des deux comédiens suivent des cours parallèles. Hoffman et Pacino sont retenus la même année, en 1966, à l’Actors Studio, célèbre école où, selon une méthode bien définie, chaque élève doit s’imprégner des personnages incarnés pour en révéler la psychologie. Durant son audition d’admission, Pacino choisit deux monologues.
C’est contraire à l’usage, et même inédit dans l’enceinte de cette prestigieuse école, où le maestro Lee Strasberg a vu passer Marlon Brando, Montgomery Clift et James Dean. L’un des monologues est tiré de la pièce Le marchand de glace est passé, d’Eugene O’Neill, l’autre de Hamlet, de Shakespeare – un auteur qui suivra Pacino toute sa vie et qu’il connaît parfaitement. « C’était risqué, mais ce risque, je ne pouvais me permettre de ne pas le prendre », explique Pacino à Lee Strasberg. Les apprentis acteurs, présents à l’audition, acclament le candidat, brisant une autre tradition de l’Actors Studio – on n’applaudit jamais ses pairs.
La génération d’acteurs italo-américains
Deux ans passent, le talent de Pacino reste confidentiel quand celui de Dustin Hoffman est reconnu dans le monde entier. Il tient une bonne place, avec Woody Allen, Barbra Streisand, Elliott Gould, dans le mouvement que l’on baptisera la Jew Wave, ces acteurs juifs, aux physiques typés, contredisant les canons jusqu’alors en vigueur à Hollywood – beau visage classique, allure élancée – qui prennent d’assaut le box-office à la fin des années 1960.
Cette « vague juive » ouvre la porte, dès le début des années 1970, à une autre génération d’acteurs, italo-américains, au physique tout aussi marqué, s’apprêtant à débuter son règne à Hollywood. Sauf que cette histoire reste à écrire. Al Pacino en sera le protagoniste principal. Mais, pour l’instant, il désespère d’en faire partie.
Peu après la première de L’Indien cherche le Bronx, une jeune fille accoste Pacino dans la rue pour lui demander s’il n’est pas Dustin Hoffman. Vexé, humilié même, il se contente de secouer la tête, alors la jeune fille insiste : « Allez, dis-le, tu es bien Dustin Hoffman, n’est-ce pas ? » Quand elle le retient par son tee-shirt, Pacino se demande s’il doit la frapper, puis retient son geste. Il ne veut pas insulter l’avenir. Un jour, se dit-il, quelqu’un le retiendra à nouveau par son maillot et le reconnaîtra : « Tu es Al Pacino ! »
L’Indien cherche le Bronx se joue à New York et sur la Côte est depuis 1966, souvent devant des salles à moitié vides. Israel Horovitz avait repéré Pacino alors qu’il jouait dans un appartement, devant un public de sept personnes, une pièce de Fred Vassi, Why Is a Crooked Letter. Après une représentation, Horovitz lui tend le texte de sa première pièce, persuadé que personne ne sera meilleur que ce gamin.
Pacino vit alors dans la cave d’un immeuble donnant sur la verdure de Central Park, côté ouest, dont il est le gardien et l’homme à tout faire. Pour celui qui a été élevé dans un trois-pièces exigu du Bronx par ses grands-parents et par une mère célibataire, où il n’est pas rare, solidarité familiale oblige, de se retrouver à neuf personnes, cette cave prend des allures de palais.
Pacino sert à Horovitz du café dans des gobelets en papier qui gardent la trace du jus d’orange surgelé que l’acteur a bu le matin. Les deux hommes lisent le texte ensemble, et Horovitz comprend d’emblée, entre deux gorgées de café frelaté, que ce gardien d’immeuble lui permettra de lancer sa carrière de dramaturge.
Pour perfectionner son rôle, Pacino parcourt Manhattan à pied, du nord au sud, en compagnie de l’auteur. « Il recherchait la plus grande authenticité possible, se souvient Israel Horovitz. Il repérait un type dans la rue et me disait : “Attends ! Attends !” Nous suivions alors cette personne durant des heures, juste pour observer la manière dont elle marchait. Les vêtements importaient beaucoup aussi pour Al. Il devait trouver le bon habit, répéter avec, et même dormir avec. »
Quand il obtient enfin que sa pièce soit donnée dans la salle de l’Astor Place Theatre, Horovitz doit encore convaincre la productrice que Pacino est le bon choix.
« Elle préférait un acteur blond et de plus grande taille. Elle avait un nom en tête. Je lui ai proposé d’auditionner son gars et Al, d’autres aussi si elle y tenait. Le blond a auditionné avant Al, devant une salle avantageusement remplie par d’autres comédiens venus tenter leur chance. Puis Al est monté sur scène, il a hurlé ses premières répliques et fait peur à tout le monde. La productrice était à ce point impressionnée qu’elle a hoché la tête, comme pour se rendre à l’évidence. J’ai crié à Al qu’il avait le rôle. Les autres comédiens venus auditionner sont partis en silence, sans même demander à tenter leur chance. A ce moment de notre vie, si un critique avait écrit un mauvais papier sur la pièce ou sur Al, nous serions allés chez lui pour lui casser la figure. Oui, vraiment, nous lui aurions tapé dessus. »
Jerry Schatzberg, comme tout un chacun, est secoué par l’intensité imprimée par Pacino sur scène. Son explosivité, la rage contenue, puis débordante, la violence déployée avec un tel naturel, au point de se demander s’il n’allait pas bondir sur les spectateurs, laisse penser au photographe qu’il n’a jamais croisé un tel phénomène. Schatzberg veut réaliser un film avec ce jeune homme. Et le plus tôt sera le mieux.
En 1968, le choix d’Al Pacino est simple. Au chaos de son existence il préfère l’ordre harmonieux, cohérent et galvanisant de la scène
En se rendant dans sa loge une fois la représentation terminée, Jerry Schatzberg imagine affronter une bête sauvage. Mais la scène n’est pas la vie. Dans l’espace encore plus réduit de la loge, le comédien se transforme en courant d’air. « Je vous assure, se souvient Jerry Schatzberg, ce mec ressemblait à une poule mouillée, un animal apeuré. Il avait peur de son ombre. Il m’apparaît charmant, exactement ce qu’il est dans la vie, mais introverti. Je n’ai jamais vu un contraste pareil. »
En 1968, le choix d’Al Pacino est simple. Au chaos de son existence, il préfère l’ordre harmonieux, cohérent et galvanisant de la scène. Six ans plus tôt, en 1962, sa mère meurt brutalement, à 43 ans. La cause reste mystérieuse, un suicide peut-être, à moins que ce soit la conséquence des nombreux barbituriques qu’elle ingurgite pour soigner une dépression chronique que même un traitement aux électrochocs n’a pu endiguer. Cette mère, qui a encouragé sa vocation de comédien, emmenant son fils voir l’une de ses premières pièces de théâtre, La Chatte sur un toit brûlant, de Tennessee Williams, a fini par compléter la galerie de personnages tragiques imaginés par l’écrivain originaire du Mississippi.
En 1961, juste avant la disparition de sa mère, Pacino prévoit de se rendre à une audition organisée pour le film America, America, d’Elia Kazan. Il ne vise rien de moins que le rôle principal, celui du jeune homme fuyant l’Anatolie et l’oppression du pouvoir turc, pour rejoindre cette terre promise qu’est l’Amérique.
« C’est l’un des rares fantasmes que je me sois autorisés dans mon existence, expliquera plus tard Pacino au magazine The New Yorker. L’audition se serait déroulée à merveille. Ma mère serait OK avec tout le reste, et j’aurais pu lui dire : “Maman, nous l’avons fait. Nous allons gagner de l’argent. Tout va aller pour le mieux.” » Dans les faits, Pacino arrive en retard et loupe l’audition. Depuis, le désordre s’est installé un peu plus dans sa vie, avec l’idée tout de même qu’un jour le cinéma lui permettra de trouver la règle de son jeu.
Needle Park, son territoire
Lorsque Jerry Schatzberg reçoit, en 1970, un scénario intitulé Panique à Needle Park, signé par un couple de romanciers en vogue, Joan Didion et John Gregory Dunne, et adapté du roman éponyme de James Mills, autant un reportage qu’une fiction, sur un couple d’héroïnomanes à New York, son premier réflexe est de dire non. Il a perdu trop d’amis, morts d’une overdose. Le réalisateur se voit mal poser sa caméra sur ce petit îlot de béton baptisé « Needle Park », là où Broadway coupe Amsterdam Avenue, alors que, sur une rangée de bancs usés par les intempéries, des toxicomanes attendent que leur dealeur leur indique dans quelle poubelle ou quelle cabine téléphonique a été dissimulée leur dose.
Mais Schatzberg apprend que Pacino a obtenu de tenir le rôle principal, alors il se ravise immédiatement. Comment passer à côté du privilège de diriger cet acteur, dans son premier rôle vedette, dans le contexte new-yorkais si particulier où l’acteur joue, pour ainsi dire, à domicile ? Depuis leur première rencontre, Pacino a quitté la cave de son immeuble de Central Park. Il vit désormais en couple, avec une actrice, Jill Clayburgh, dans un studio de la 90e rue. Les toilettes se trouvent sur le palier, les souris grouillent. Pacino place du fromage dans des sacs en plastique qu’il referme dès qu’un animal s’y engouffre pour ensuite le relâcher dans la rue.
C’est d’ailleurs la chose qui frappe le cinéaste quand il retrouve « son » acteur. Les deux hommes ont beau avoir grandi tous les deux dans le Bronx, Schatzberg dans un quartier relativement bourgeois, Pacino dans une des zones les plus défavorisées, gangrenée par la drogue, l’acteur possède tous ses repères dès qu’il est transplanté à Needle Park. Ce dernier estime, à raison, qu’il s’agit de son territoire.
C’est une heureuse coïncidence qu’à partir du milieu des années 1960 New York devienne le centre névralgique du cinéma américain. En novembre 1965, les habitants choisissent un nouveau maire avec un physique de star de cinéma. Grand, blond, charismatique, ambitieux, républicain mais de l’aile gauche du parti, visant la Maison Blanche, John V. Lindsay propose de transformer sa ville en un studio de cinéma à ciel ouvert, fournissant aux équipes de tournage toute l’infrastructure nécessaire, y compris des forces de police pour assurer la sécurité.
Les réalisateurs sont autant attirés par ces facilités que par l’ADN new-yorkais : une ville sale, surpeuplée, frénétique, couverte de graffitis, où il fait trop chaud ou trop froid. Une ville en proie à un chômage endémique, une criminalité record, l’expansion du trafic de drogue, alors que les files de personnes attendant de percevoir les aides sociales ne cessent de s’allonger.
Pacino tient le rôle mais les producteurs ne sont pas totalement convaincus. Perturbés par la petite taille de l’acteur, et par son jeune âge, 30 ans, ils relancent un nouveau processus de casting
Entre 1966 et 1973, le maire oppose les classes moyennes aux pauvres, les ghettos à la police, ceux qui militent contre la guerre du Vietnam à ses thuriféraires, Manhattan à ses faubourgs, et New York au reste du monde. Pour les gens modestes, parvenir à survivre dans cette ville devient une forme d’héroïsme, un tour de force, à la manière du clochard incarné par Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy (1969) ou du flic hyperviolent de French Connection (1971), immortalisé par Gene Hackman.
Pacino tient son rôle de junkie, mais les producteurs de Panique ne sont pas totalement convaincus. Perturbés par la petite taille de l’acteur, et par son jeune âge, 30 ans, ils relancent un nouveau processus de casting, ce qui en dit long sur leur frilosité. Mais l’exercice renforce la légitimité de l’acteur – aucun comédien ne lui arrive à la cheville lors des nouveaux essais.
Seul un débutant, du nom de Robert De Niro, provoque un semblant de débat. « Disons que Robert jouait très bien le rôle, se souvient Schatzberg. Mais il le jouait, alors qu’Al était le personnage. Un jour, je me trouve devant la vitrine d’un magasin de la 3e avenue, et j’entends une voix derrière moi qui me dit : “Mec, je veux vraiment le rôle”. » Je me retourne et c’est De Niro. J’avais l’air d’un lapin pris dans les phares d’une voiture, je ne sais pas quoi répondre, et puis simplement je lui dis la vérité. Il m’a regardé et a disparu. Il lui a fallu quarante ans pour me saluer à nouveau. »
L’alcool depuis l’âge de 13 ans
Schatzberg et Pacino passent six semaines ensemble avant le tournage, ensuite rejoints par Kitty Winn, la comédienne qui incarne dans Panique à Needle Park la petite amie de l’acteur et l’accompagne dans sa descente aux enfers. Le couple rencontre d’anciens toxicomanes dans des centres de traitement, s’installe à Needle Park, fréquente les salles du Roosevelt Hospital.
Pacino pensait avoir tout compris de la toxicomanie mais il doit tout recommencer de zéro, comprenant qu’il existe autant de degrés d’addiction que de toxicomanes. Quand l’un d’eux explique à l’acteur qu’il est impossible de faire l’amour après avoir pris une dose, un autre affirme que c’est le contraire. Les figurants de Panique à Needle Park sont tous choisis dans la rue, beaucoup sont encore toxicomanes et composent l’arrière-plan d’un film à la fois réaliste et sordide, d’une crudité inhabituelle.
Le premier jour du tournage de Panique à Needle Park, Michael Hadge, un ami de Pacino, qui produira en 1996 Looking for Richard, le film réalisé par l’acteur lui-même, entend quelqu’un frapper à sa porte à 7 h 30. C’est lui. « Je lui demande ce qu’il fout à une heure pareille, et il me répond qu’il tourne un film dans le quartier et se demande si je ne peux pas lui offrir le petit-déjeuner. Alors que ma femme commence à nous préparer des œufs et du bacon, il devient très nerveux, change d’avis en regardant l’assiette vide et demande à voir ce qu’il y a à boire dans mon frigo. Son petit-déjeuner se résumera à un verre de vin blanc. »
L’alcool, ingurgité si tôt dans la journée, souvent le premier verre d’une longue série, ne constitue guère une nouveauté pour un acteur qui boit avec assiduité depuis l’âge de 13 ans. « Je ne pourrais franchement pas tracer l’origine de ce problème, expliquait alors Pacino. Disons que je ne me préoccupais pas autant que d’autres de mon problème avec l’alcool. Après tout, je fonctionnais très bien en buvant. Je ne touchais pas à la drogue. Parfois aux tranquillisants ou à ce genre de trucs que je combinais avec l’alcool, mais, là, je comprenais que le mélange n’était pas heureux. Le vin vous réchauffe, facilite les choses, retire la pression dans les moments difficiles. C’est une récompense au bout d’une journée difficile. »
Des règles dictées par la retenue
Pacino impose sa loi dès son premier film. Des règles dictées par la retenue. Quand il doit se déshabiller, pour une scène où son personnage, incarcéré, doit partager sa douche avec d’autres détenus, il demande à ce que les femmes présentes quittent le plateau. Un peu plus tard, dans une séquence où il doit faire l’amour avec sa partenaire, Kitty Winn, Pacino soulève la question de la pertinence d’un tel moment à ce point de l’histoire. Après tout, souligne-t-il, les personnages de Shakespeare ne s’embrassent jamais, même dans Roméo et Juliette.
Au bout d’une longue discussion, Pacino s’en remet à la logique de son réalisateur et reconnaît le bien-fondé de cette scène. « Chez Al, se souvient Kitty Winn, le travail importait plus que le reste. Sa personne convergeait vers ce moment où, enfin, la caméra allait se mettre à tourner. Mon père me répétait qu’il fallait, si possible, trouver un partenaire meilleur que soi pour progresser au tennis. Quand j’ai vu Al, je me suis dit que c’était mon jour de chance. Ce gars était bien meilleur que moi. »
Al Pacino devient cet acteur qui n’existe jamais autant qu’en disparaissant
Il y a un moment dans Panique à Needle Park où sa compagne explique au héros qui sort de prison qu’elle a couché avec son frère. La scène est éclairée par une lumière douce et froide. Pacino est allongé sur un lit et, quand elle lui fait cet aveu, il baisse la tête. Durant les répétitions, l’acteur la baissait jusqu’à un certain point, de manière à laisser ses joues accrocher la lumière. Mais, au moment du tournage, il baisse complètement la tête pour faire disparaître son visage. Une idée brillante, tant le spectateur ressent à cet instant le malaise du personnage. Al Pacino devient cet acteur qui n’existe jamais autant qu’en disparaissant.
Quand il découvre Panique à Needle Park lors de la première new-yorkaise du film, Pacino est ivre. Il se trouve cependant talentueux, mais comprend qu’il a besoin d’aide. Le film concourt pour la Palme d’or au Festival de Cannes, en 1971, signe d’un grand intérêt en Europe, alors que l’accueil sera confidentiel aux Etats-Unis, mais c’est Kitty Winn qui obtient le Prix d’interprétation. Al Pacino s’estime trop occupé et renonce au déplacement sur la Croisette.
Peu avant de prendre l’avion pour la France, Jerry Schatzberg se balade sur Broadway Avenue. Il entend un mec qui hurle : « Chico ! » Le réalisateur trouve ça étrange, car l’un des junkies de Panique à Needle Park se prénomme Chico, mais il poursuit son chemin. Il entend à nouveau la même voix, plus stridente : « Chico ! » Alors il se retourne. Il aperçoit Al Pacino, assis sur un banc de Needle Park, en compagnie de plusieurs junkies. Ce rôle, qui lui colle à la peau, il ne souhaite ni ne peut l’abandonner, surtout pour un voyage à l’étranger. Et même pour Cannes. Al Pacino vient d’avoir 30 ans. Un âge où il est temps d’accepter que les films importent plus que la vie.
A la découverte d’Al Pacino, une bête sauvage à la gueule d’ange
Par Samuel Blumenfeld
Al Pacino en six films cultes (1/6). Après l’avoir repéré sur les planches new-yorkaises, Jerry Schatzberg offre à l’acteur explosif son premier grand rôle au cinéma, en 1971, dans « Panique à Needle Park ».[/u][/u]
Lorsqu’il prend place, en février 1968, à l’Astor Place Theatre, sur Lafayette Street, en bas de Manhattan, Jerry Schatzberg se demande encore comment l’on prononce le nom de cet acteur dont on parle tant à New York. Doit-on dire « Pa-ssi-no » ou, comme bientôt plus personne ne l’ignorera, « Peu-tchi-no » ? Davantage que le mystère du nom, le visage du jeune homme intrigue Jerry Schatzberg. Ce photographe de mode réputé, connu notamment pour ses nombreux portraits de Bob Dylan et d’Aretha Franklin, s’apprête à réaliser son premier film, Portrait d’une enfant déchue, avec Faye Dunaway.
Pacino, constate Schatzberg, va avoir 28 ans, mais il arbore un air si innocent… Son visage ne cadre pas avec le rôle d’un des deux délinquants dans la pièce qu’il doit jouer ce soir à l’Astor Place Theatre, L’Indien cherche le Bronx, écrite par un jeune dramaturge, Israel Horovitz. Pacino y harcèle puis moleste un étranger à la recherche de son chemin, d’autant plus perdu qu’il ne parvient pas à se faire comprendre en anglais. Sa taille, 1,67 m, inhabituellement petite, remarque le photographe, devrait l’empêcher d’éclipser ses partenaires sur scène.
Et puis le nez du comédien, note Schatzberg, élégamment prononcé, à la rondeur harmonieuse, et son menton rectangulaire, évoquent une ressemblance évidente avec un autre comédien, Dustin Hoffman, dont le premier film, Le Lauréat, de Mike Nichols, triomphe de manière imprévue depuis sa sortie, en décembre 1967.
Du reste, les carrières des deux comédiens suivent des cours parallèles. Hoffman et Pacino sont retenus la même année, en 1966, à l’Actors Studio, célèbre école où, selon une méthode bien définie, chaque élève doit s’imprégner des personnages incarnés pour en révéler la psychologie. Durant son audition d’admission, Pacino choisit deux monologues.
C’est contraire à l’usage, et même inédit dans l’enceinte de cette prestigieuse école, où le maestro Lee Strasberg a vu passer Marlon Brando, Montgomery Clift et James Dean. L’un des monologues est tiré de la pièce Le marchand de glace est passé, d’Eugene O’Neill, l’autre de Hamlet, de Shakespeare – un auteur qui suivra Pacino toute sa vie et qu’il connaît parfaitement. « C’était risqué, mais ce risque, je ne pouvais me permettre de ne pas le prendre », explique Pacino à Lee Strasberg. Les apprentis acteurs, présents à l’audition, acclament le candidat, brisant une autre tradition de l’Actors Studio – on n’applaudit jamais ses pairs.
La génération d’acteurs italo-américains
Deux ans passent, le talent de Pacino reste confidentiel quand celui de Dustin Hoffman est reconnu dans le monde entier. Il tient une bonne place, avec Woody Allen, Barbra Streisand, Elliott Gould, dans le mouvement que l’on baptisera la Jew Wave, ces acteurs juifs, aux physiques typés, contredisant les canons jusqu’alors en vigueur à Hollywood – beau visage classique, allure élancée – qui prennent d’assaut le box-office à la fin des années 1960.
Cette « vague juive » ouvre la porte, dès le début des années 1970, à une autre génération d’acteurs, italo-américains, au physique tout aussi marqué, s’apprêtant à débuter son règne à Hollywood. Sauf que cette histoire reste à écrire. Al Pacino en sera le protagoniste principal. Mais, pour l’instant, il désespère d’en faire partie.
Peu après la première de L’Indien cherche le Bronx, une jeune fille accoste Pacino dans la rue pour lui demander s’il n’est pas Dustin Hoffman. Vexé, humilié même, il se contente de secouer la tête, alors la jeune fille insiste : « Allez, dis-le, tu es bien Dustin Hoffman, n’est-ce pas ? » Quand elle le retient par son tee-shirt, Pacino se demande s’il doit la frapper, puis retient son geste. Il ne veut pas insulter l’avenir. Un jour, se dit-il, quelqu’un le retiendra à nouveau par son maillot et le reconnaîtra : « Tu es Al Pacino ! »
L’Indien cherche le Bronx se joue à New York et sur la Côte est depuis 1966, souvent devant des salles à moitié vides. Israel Horovitz avait repéré Pacino alors qu’il jouait dans un appartement, devant un public de sept personnes, une pièce de Fred Vassi, Why Is a Crooked Letter. Après une représentation, Horovitz lui tend le texte de sa première pièce, persuadé que personne ne sera meilleur que ce gamin.
Pacino vit alors dans la cave d’un immeuble donnant sur la verdure de Central Park, côté ouest, dont il est le gardien et l’homme à tout faire. Pour celui qui a été élevé dans un trois-pièces exigu du Bronx par ses grands-parents et par une mère célibataire, où il n’est pas rare, solidarité familiale oblige, de se retrouver à neuf personnes, cette cave prend des allures de palais.
Pacino sert à Horovitz du café dans des gobelets en papier qui gardent la trace du jus d’orange surgelé que l’acteur a bu le matin. Les deux hommes lisent le texte ensemble, et Horovitz comprend d’emblée, entre deux gorgées de café frelaté, que ce gardien d’immeuble lui permettra de lancer sa carrière de dramaturge.
Pour perfectionner son rôle, Pacino parcourt Manhattan à pied, du nord au sud, en compagnie de l’auteur. « Il recherchait la plus grande authenticité possible, se souvient Israel Horovitz. Il repérait un type dans la rue et me disait : “Attends ! Attends !” Nous suivions alors cette personne durant des heures, juste pour observer la manière dont elle marchait. Les vêtements importaient beaucoup aussi pour Al. Il devait trouver le bon habit, répéter avec, et même dormir avec. »
Quand il obtient enfin que sa pièce soit donnée dans la salle de l’Astor Place Theatre, Horovitz doit encore convaincre la productrice que Pacino est le bon choix.
« Elle préférait un acteur blond et de plus grande taille. Elle avait un nom en tête. Je lui ai proposé d’auditionner son gars et Al, d’autres aussi si elle y tenait. Le blond a auditionné avant Al, devant une salle avantageusement remplie par d’autres comédiens venus tenter leur chance. Puis Al est monté sur scène, il a hurlé ses premières répliques et fait peur à tout le monde. La productrice était à ce point impressionnée qu’elle a hoché la tête, comme pour se rendre à l’évidence. J’ai crié à Al qu’il avait le rôle. Les autres comédiens venus auditionner sont partis en silence, sans même demander à tenter leur chance. A ce moment de notre vie, si un critique avait écrit un mauvais papier sur la pièce ou sur Al, nous serions allés chez lui pour lui casser la figure. Oui, vraiment, nous lui aurions tapé dessus. »
Jerry Schatzberg, comme tout un chacun, est secoué par l’intensité imprimée par Pacino sur scène. Son explosivité, la rage contenue, puis débordante, la violence déployée avec un tel naturel, au point de se demander s’il n’allait pas bondir sur les spectateurs, laisse penser au photographe qu’il n’a jamais croisé un tel phénomène. Schatzberg veut réaliser un film avec ce jeune homme. Et le plus tôt sera le mieux.
En 1968, le choix d’Al Pacino est simple. Au chaos de son existence il préfère l’ordre harmonieux, cohérent et galvanisant de la scène
En se rendant dans sa loge une fois la représentation terminée, Jerry Schatzberg imagine affronter une bête sauvage. Mais la scène n’est pas la vie. Dans l’espace encore plus réduit de la loge, le comédien se transforme en courant d’air. « Je vous assure, se souvient Jerry Schatzberg, ce mec ressemblait à une poule mouillée, un animal apeuré. Il avait peur de son ombre. Il m’apparaît charmant, exactement ce qu’il est dans la vie, mais introverti. Je n’ai jamais vu un contraste pareil. »
En 1968, le choix d’Al Pacino est simple. Au chaos de son existence, il préfère l’ordre harmonieux, cohérent et galvanisant de la scène. Six ans plus tôt, en 1962, sa mère meurt brutalement, à 43 ans. La cause reste mystérieuse, un suicide peut-être, à moins que ce soit la conséquence des nombreux barbituriques qu’elle ingurgite pour soigner une dépression chronique que même un traitement aux électrochocs n’a pu endiguer. Cette mère, qui a encouragé sa vocation de comédien, emmenant son fils voir l’une de ses premières pièces de théâtre, La Chatte sur un toit brûlant, de Tennessee Williams, a fini par compléter la galerie de personnages tragiques imaginés par l’écrivain originaire du Mississippi.
En 1961, juste avant la disparition de sa mère, Pacino prévoit de se rendre à une audition organisée pour le film America, America, d’Elia Kazan. Il ne vise rien de moins que le rôle principal, celui du jeune homme fuyant l’Anatolie et l’oppression du pouvoir turc, pour rejoindre cette terre promise qu’est l’Amérique.
« C’est l’un des rares fantasmes que je me sois autorisés dans mon existence, expliquera plus tard Pacino au magazine The New Yorker. L’audition se serait déroulée à merveille. Ma mère serait OK avec tout le reste, et j’aurais pu lui dire : “Maman, nous l’avons fait. Nous allons gagner de l’argent. Tout va aller pour le mieux.” » Dans les faits, Pacino arrive en retard et loupe l’audition. Depuis, le désordre s’est installé un peu plus dans sa vie, avec l’idée tout de même qu’un jour le cinéma lui permettra de trouver la règle de son jeu.
Needle Park, son territoire
Lorsque Jerry Schatzberg reçoit, en 1970, un scénario intitulé Panique à Needle Park, signé par un couple de romanciers en vogue, Joan Didion et John Gregory Dunne, et adapté du roman éponyme de James Mills, autant un reportage qu’une fiction, sur un couple d’héroïnomanes à New York, son premier réflexe est de dire non. Il a perdu trop d’amis, morts d’une overdose. Le réalisateur se voit mal poser sa caméra sur ce petit îlot de béton baptisé « Needle Park », là où Broadway coupe Amsterdam Avenue, alors que, sur une rangée de bancs usés par les intempéries, des toxicomanes attendent que leur dealeur leur indique dans quelle poubelle ou quelle cabine téléphonique a été dissimulée leur dose.
Mais Schatzberg apprend que Pacino a obtenu de tenir le rôle principal, alors il se ravise immédiatement. Comment passer à côté du privilège de diriger cet acteur, dans son premier rôle vedette, dans le contexte new-yorkais si particulier où l’acteur joue, pour ainsi dire, à domicile ? Depuis leur première rencontre, Pacino a quitté la cave de son immeuble de Central Park. Il vit désormais en couple, avec une actrice, Jill Clayburgh, dans un studio de la 90e rue. Les toilettes se trouvent sur le palier, les souris grouillent. Pacino place du fromage dans des sacs en plastique qu’il referme dès qu’un animal s’y engouffre pour ensuite le relâcher dans la rue.
C’est d’ailleurs la chose qui frappe le cinéaste quand il retrouve « son » acteur. Les deux hommes ont beau avoir grandi tous les deux dans le Bronx, Schatzberg dans un quartier relativement bourgeois, Pacino dans une des zones les plus défavorisées, gangrenée par la drogue, l’acteur possède tous ses repères dès qu’il est transplanté à Needle Park. Ce dernier estime, à raison, qu’il s’agit de son territoire.
C’est une heureuse coïncidence qu’à partir du milieu des années 1960 New York devienne le centre névralgique du cinéma américain. En novembre 1965, les habitants choisissent un nouveau maire avec un physique de star de cinéma. Grand, blond, charismatique, ambitieux, républicain mais de l’aile gauche du parti, visant la Maison Blanche, John V. Lindsay propose de transformer sa ville en un studio de cinéma à ciel ouvert, fournissant aux équipes de tournage toute l’infrastructure nécessaire, y compris des forces de police pour assurer la sécurité.
Les réalisateurs sont autant attirés par ces facilités que par l’ADN new-yorkais : une ville sale, surpeuplée, frénétique, couverte de graffitis, où il fait trop chaud ou trop froid. Une ville en proie à un chômage endémique, une criminalité record, l’expansion du trafic de drogue, alors que les files de personnes attendant de percevoir les aides sociales ne cessent de s’allonger.
Pacino tient le rôle mais les producteurs ne sont pas totalement convaincus. Perturbés par la petite taille de l’acteur, et par son jeune âge, 30 ans, ils relancent un nouveau processus de casting
Entre 1966 et 1973, le maire oppose les classes moyennes aux pauvres, les ghettos à la police, ceux qui militent contre la guerre du Vietnam à ses thuriféraires, Manhattan à ses faubourgs, et New York au reste du monde. Pour les gens modestes, parvenir à survivre dans cette ville devient une forme d’héroïsme, un tour de force, à la manière du clochard incarné par Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy (1969) ou du flic hyperviolent de French Connection (1971), immortalisé par Gene Hackman.
Pacino tient son rôle de junkie, mais les producteurs de Panique ne sont pas totalement convaincus. Perturbés par la petite taille de l’acteur, et par son jeune âge, 30 ans, ils relancent un nouveau processus de casting, ce qui en dit long sur leur frilosité. Mais l’exercice renforce la légitimité de l’acteur – aucun comédien ne lui arrive à la cheville lors des nouveaux essais.
Seul un débutant, du nom de Robert De Niro, provoque un semblant de débat. « Disons que Robert jouait très bien le rôle, se souvient Schatzberg. Mais il le jouait, alors qu’Al était le personnage. Un jour, je me trouve devant la vitrine d’un magasin de la 3e avenue, et j’entends une voix derrière moi qui me dit : “Mec, je veux vraiment le rôle”. » Je me retourne et c’est De Niro. J’avais l’air d’un lapin pris dans les phares d’une voiture, je ne sais pas quoi répondre, et puis simplement je lui dis la vérité. Il m’a regardé et a disparu. Il lui a fallu quarante ans pour me saluer à nouveau. »
L’alcool depuis l’âge de 13 ans
Schatzberg et Pacino passent six semaines ensemble avant le tournage, ensuite rejoints par Kitty Winn, la comédienne qui incarne dans Panique à Needle Park la petite amie de l’acteur et l’accompagne dans sa descente aux enfers. Le couple rencontre d’anciens toxicomanes dans des centres de traitement, s’installe à Needle Park, fréquente les salles du Roosevelt Hospital.
Pacino pensait avoir tout compris de la toxicomanie mais il doit tout recommencer de zéro, comprenant qu’il existe autant de degrés d’addiction que de toxicomanes. Quand l’un d’eux explique à l’acteur qu’il est impossible de faire l’amour après avoir pris une dose, un autre affirme que c’est le contraire. Les figurants de Panique à Needle Park sont tous choisis dans la rue, beaucoup sont encore toxicomanes et composent l’arrière-plan d’un film à la fois réaliste et sordide, d’une crudité inhabituelle.
Le premier jour du tournage de Panique à Needle Park, Michael Hadge, un ami de Pacino, qui produira en 1996 Looking for Richard, le film réalisé par l’acteur lui-même, entend quelqu’un frapper à sa porte à 7 h 30. C’est lui. « Je lui demande ce qu’il fout à une heure pareille, et il me répond qu’il tourne un film dans le quartier et se demande si je ne peux pas lui offrir le petit-déjeuner. Alors que ma femme commence à nous préparer des œufs et du bacon, il devient très nerveux, change d’avis en regardant l’assiette vide et demande à voir ce qu’il y a à boire dans mon frigo. Son petit-déjeuner se résumera à un verre de vin blanc. »
L’alcool, ingurgité si tôt dans la journée, souvent le premier verre d’une longue série, ne constitue guère une nouveauté pour un acteur qui boit avec assiduité depuis l’âge de 13 ans. « Je ne pourrais franchement pas tracer l’origine de ce problème, expliquait alors Pacino. Disons que je ne me préoccupais pas autant que d’autres de mon problème avec l’alcool. Après tout, je fonctionnais très bien en buvant. Je ne touchais pas à la drogue. Parfois aux tranquillisants ou à ce genre de trucs que je combinais avec l’alcool, mais, là, je comprenais que le mélange n’était pas heureux. Le vin vous réchauffe, facilite les choses, retire la pression dans les moments difficiles. C’est une récompense au bout d’une journée difficile. »
Des règles dictées par la retenue
Pacino impose sa loi dès son premier film. Des règles dictées par la retenue. Quand il doit se déshabiller, pour une scène où son personnage, incarcéré, doit partager sa douche avec d’autres détenus, il demande à ce que les femmes présentes quittent le plateau. Un peu plus tard, dans une séquence où il doit faire l’amour avec sa partenaire, Kitty Winn, Pacino soulève la question de la pertinence d’un tel moment à ce point de l’histoire. Après tout, souligne-t-il, les personnages de Shakespeare ne s’embrassent jamais, même dans Roméo et Juliette.
Au bout d’une longue discussion, Pacino s’en remet à la logique de son réalisateur et reconnaît le bien-fondé de cette scène. « Chez Al, se souvient Kitty Winn, le travail importait plus que le reste. Sa personne convergeait vers ce moment où, enfin, la caméra allait se mettre à tourner. Mon père me répétait qu’il fallait, si possible, trouver un partenaire meilleur que soi pour progresser au tennis. Quand j’ai vu Al, je me suis dit que c’était mon jour de chance. Ce gars était bien meilleur que moi. »
Al Pacino devient cet acteur qui n’existe jamais autant qu’en disparaissant
Il y a un moment dans Panique à Needle Park où sa compagne explique au héros qui sort de prison qu’elle a couché avec son frère. La scène est éclairée par une lumière douce et froide. Pacino est allongé sur un lit et, quand elle lui fait cet aveu, il baisse la tête. Durant les répétitions, l’acteur la baissait jusqu’à un certain point, de manière à laisser ses joues accrocher la lumière. Mais, au moment du tournage, il baisse complètement la tête pour faire disparaître son visage. Une idée brillante, tant le spectateur ressent à cet instant le malaise du personnage. Al Pacino devient cet acteur qui n’existe jamais autant qu’en disparaissant.
Quand il découvre Panique à Needle Park lors de la première new-yorkaise du film, Pacino est ivre. Il se trouve cependant talentueux, mais comprend qu’il a besoin d’aide. Le film concourt pour la Palme d’or au Festival de Cannes, en 1971, signe d’un grand intérêt en Europe, alors que l’accueil sera confidentiel aux Etats-Unis, mais c’est Kitty Winn qui obtient le Prix d’interprétation. Al Pacino s’estime trop occupé et renonce au déplacement sur la Croisette.
Peu avant de prendre l’avion pour la France, Jerry Schatzberg se balade sur Broadway Avenue. Il entend un mec qui hurle : « Chico ! » Le réalisateur trouve ça étrange, car l’un des junkies de Panique à Needle Park se prénomme Chico, mais il poursuit son chemin. Il entend à nouveau la même voix, plus stridente : « Chico ! » Alors il se retourne. Il aperçoit Al Pacino, assis sur un banc de Needle Park, en compagnie de plusieurs junkies. Ce rôle, qui lui colle à la peau, il ne souhaite ni ne peut l’abandonner, surtout pour un voyage à l’étranger. Et même pour Cannes. Al Pacino vient d’avoir 30 ans. Un âge où il est temps d’accepter que les films importent plus que la vie.
Curieux de voir ce que cela va donner.
Al Pacino en six films cultes (2/6). Le chef-d’œuvre de Coppola de 1972 sort brutalement l’acteur de l’anonymat. Son interprétation atypique atteindra l’apothéose dans le second volet, en 1974.
Octobre 1970. Le moment est important. Le cinéaste américain Francis Ford Coppola projette au tout-puissant patron de la Paramount, le charismatique Robert Evans, et à ses adjoints une nouvelle série d’essais filmés d’Al Pacino, qu’il veut pour le film qu’il tournera dans quelques mois à New York : Le Parrain, d’après le best-seller écrit par l’Italien Mario Puzo. Les essais sont tournés à San Francisco, chez le metteur en scène. Ce n’est pas gagné. Lors des premières auditions, alors qu’il doit à chaque fois affronter un jury défavorable, Pacino s’en est toujours brillamment sorti. Alors pourquoi le tester encore et encore ?
L’hostilité de la Paramount est la même pour le premier nom proposé par Coppola, celui de Marlon Brando, qu’il veut pour incarner le rôle-titre de Don Vito Corleone, dit « le Parrain », chef de l’une des six familles de la mafia new-yorkaise. Plus qu’une hostilité, c’est une levée de boucliers.
A ce moment pourtant, Brando et Pacino ne boxent pas dans la même catégorie. La vedette d’Un tramway nommé désir, au théâtre puis au cinéma, est une star, mais elle est aussi considérée comme une malédiction au box-office. Dès que Coppola évoque Brando, les dirigeants de Paramount répondent : « Vous mentionnez son nom encore une fois et vous dégagez. » Il n’aura fallu qu’un seul essai avec Brando, grimé, vieilli, la voix changée, avec des boules de coton glissées à l’intérieur des joues afin de lui donner un air de bouledogue, pour qu’il inverse la tendance et impose l’évidence : il reste le plus grand acteur du monde.
La stratégie de Coppola s’assimile à un jeu d’échecs. Elle consiste à avancer, pion après pion, pour se révéler d’une imparable efficacité. Le réalisateur remporte chacune de ses parties et arrive à imposer des acteurs inconnus pour Le Parrain : James Caan hérite du rôle de Sonny Corleone, le fils colérique de Vito Corleone ; Robert Duvall incarne Tom Hagen, l’enfant adoptif de la famille, devenu le consigliere, l’avocat au service exclusif du Don ; Diane Keaton prête son visage à Kay Adams, la fiancée WASP de Michael Corleone, le plus jeune fils, qui se tient à l’écart de la « famille ».
Le rôle de Michael Corleone, sur lequel repose l’édifice du Parrain, ce héros de guerre maintenu à l’écart des trafics et de la corruption de la famille, pour devenir plus tard la parfaite réincarnation de son père, ne peut que revenir, pour Coppola, à Al Pacino.
Trop petit, trop italien
Le réalisateur découvre le comédien sur scène, dans L’Indien cherche le Bronx, pièce d’Israel Horovitz. Conquis et intrigué, il obtient, par l’entremise de son confrère Jerry Schatzberg, un montage d’une vingtaine de minutes de Panique à Needle Park pour le montrer aux producteurs du Parrain – ces derniers ne peuvent attendre la sortie du film, prévue en juillet 1971.
A chaque fois qu’il relit le roman de Puzo et tombe sur le personnage de Michael Corleone, Coppola « voit » le visage de Pacino. Il cherche un acteur crédible en Italo-Américain et Pacino, par ses origines siciliennes, répond exactement au souhait du metteur en scène. « Quand je le regarde, je vois la carte de la Sicile », s’émerveille Coppola, qui découvrira plus tard que le grand-père de l’acteur est issu du village de Corleone, dans l’île italienne.
Robert Evans, à l’instar des autres dirigeants de la Paramount, ne partage pas cet enthousiasme. Pacino est trop petit. Trop italien aussi. Le producteur pense à des acteurs plus connus, Robert Redford, Ryan O’Neal, Warren Beatty, susceptibles à ses yeux de passer pour des Italiens du Nord. Il les a même approchés, mais ils n’ont manifesté aucun intérêt pour le rôle.
En ce jour d’octobre 1970, Coppola choisit pour cet essai la séquence du mariage qui ouvrira le film, où Michael Corleone, portant encore l’uniforme de l’armée américaine, présente sa petite amie à sa famille de mafieux. Pacino incarne alors un personnage tout en retenue, incertain, pris entre son clan, issu de l’ancien monde, et le rêve américain moderne de l’après-guerre, personnifié par sa fiancée.
Sauf qu’à ce moment, Pacino maîtrise mal son texte et avale ses mots. Au point d’improviser ses répliques. C’est l’indice évident qu’il ne parvient pas à entrer dans la peau de Michael Corleone. « Quand on ne veut pas de moi, tout en me demandant de revenir, je n’ai plus envie d’apprendre mon texte, se justifiera plus tard Pacino. Je n’étais pas convaincu d’être l’acteur le mieux à même d’incarner Michael Corleone. »
Aucune alternative crédible à Pacino
La consternation dans la salle de projection est palpable. « Cette enflure autodestructrice ne connaît même pas son texte », chuchote Coppola à l’oreille du coscénariste, Mario Puzo en personne. Le patron de la Paramount, Robert Evans, résume la situation en se tournant vers le réalisateur : « Francis, tu es vraiment seul sur ce coup ! » Une manière polie, mais ferme, de signifier à l’intéressé qu’il a perdu la partie. Du moins cette manche.
Le temps qui passe, avec l’échéance du tournage du Parrain fixée à mars 1971, la réputation du roman de Mario Puzo suscitant une attente grandissante au sein du public, devient paradoxalement autant de facteurs jouant en faveur du joueur d’échecs Coppola. Aucune alternative crédible à Pacino ne se profile.
A quatre semaines du tournage, Robert Evans jette l’éponge. Il racontera plus tard : « Francis m’a dit :“On a un gros problème. Tu veux un type qui te ressemble, et je veux un type qui me ressemble.” Moi, je voulais Alain Delon, vous comprenez ? C’est comme cela qu’il était décrit dans le livre. Je me trompais. Francis a poursuivi : “Je veux Al Pacino, et c’est moi le réalisateur. Si tu ne le prends pas, je ne fais pas ce putain de film.” J’ai répondu : “D’accord. Je l’engage, ton nabot !” »
Autant que la lassitude, il semble que ce soit Marlon Brando qui ait fini de convaincre Evans lors d’une conversation téléphonique : « Pacino est un taiseux. S’il doit être mon fils, c’est exactement ce qu’il faut, parce que moi aussi, je suis un taiseux. » Réponse d’Evans : « C’est un acteur que je cherche, pas un taiseux. »
« Le nain est à toi. Fais-en ce que tu veux »
Lorsque Robert Evans contacte l’agent de Pacino pour définir les contours du contrat de son client, ce dernier se montre décontenancé. Il pensait le projet mort. Pacino, lassé d’attendre, a signé quarante-huit heures plus tôt pour une comédie, The Gang that Couldn’t Shoot Straight, de James Goldstone, produite par la MGM. S’il veut récupérer l’acteur, Evans doit négocier auprès de James Aubrey, patron de la production de ce studio. Celui-ci accueille la requête avec la compréhension d’un inspecteur des impôts. Refus définitif.
Le dirigeant de la Paramount sort sa dernière carte : il appelle son mentor, l’avocat Sidney Korshak. Ce dernier, considéré par le FBI comme l’avocat le plus puissant au monde, le plus secret aussi, reste, depuis les années 1950, la courroie de transmission entre Hollywood et le crime organisé.
Quand il possédait encore son cabinet d’avocat à Chicago, Korshak s’était occupé des intérêts des figures emblématiques de la Mafia, Al Capone, Frank Nitti, Tony Accardo ou Sam Giancana. Korshak contrôle désormais les syndicats de la construction pour toute la Côte ouest, tout comme celui des conducteurs routiers. Aucun immeuble, pas le moindre hôtel, ne peut se construire aux Etats-Unis sans son assentiment.
Prenant note de la requête d’Evans, Korshak s’empare d’un crayon et demande à ce qu’on lui épelle le nom de Pacino. Vingt minutes plus tard, Evans reçoit un coup de fil de James Aubrey, hystérique : « Le nain est à toi. Fais-en ce que tu veux. » Korshak venait d’appeler Kirk Kerkorian, le propriétaire de la MGM, alors occupé à construire plusieurs hôtels à Las Vegas, dont le plus récent, le MGM Grand, serait le plus grand du monde. Après que Korshak a formulé sa requête à Kerkorian, voici leur échange :
Korshak : « Veux-tu vraiment finir de construire ton hôtel ?
– C’est qui l’acteur ?
– Un certain Pacino.
– Comment ça s’écrit ? »
Korshak le lui épelle.
« C’est qui, celui-là ?
– Aucune idée, mais Bob Evans a besoin de lui. »
Sur son canapé, des heures durant
Al Pacino se prépare au rôle de Michael Corleone en silence, dans un complet isolement. « Je traînais avec pas mal de mecs à Brooklyn qui n’étaient pas exactement des enfants de chœur dans la vie, se souvient James Caan. Al, rien. Le néant. Le mec se trouvait dans un trou noir. »
La méthode Pacino conjugue le mouvement et l’immobilisme. Mouvement car, les semaines précédant le tournage du Parrain, l’acteur se lève tous les matins à 4 heures pour parcourir les 20 km aller-retour séparant son domicile, sur la 14e rue, et la 110e rue. Immobilisme car, chez lui, il reste assis sur son canapé, des heures durant, à la recherche d’un éventuel jaillissement qui lui permettrait de trouver la clé du personnage de Michael Corleone.
Plus tard, quand il se décidera à quitter son appartement, sur l’insistance de Marthe Keller, qui deviendra sa compagne à la fin des années 1970, après avoir joué avec lui dans Bobby Deerfield, de Sydney Pollack (1977), l’actrice suisse jettera un dernier coup d’œil sur ce canapé. « Il restait une énorme tache noire sur le mur juste au-dessus, raconte aujourd’hui Marthe Keller. Il s’agissait des milliers d’heures passées par Al, assis, la tête collée contre le mur, à réfléchir à ses rôles. »
De ce canapé, une image surgit dans la tête de l’acteur : Michael Corleone ressemble à une sculpture en glaise qui se durcit peu à peu, passant du héros de guerre innocent, décidé à rompre avec sa famille, pour devenir un monstre au sang froid, une statue du Commandeur prête à tout pour asseoir la suprématie de sa famille. Et la sienne.
Un modèle de compression, puis d’explosion
Le tournage du Parrain commence, le 29 mars 1971, à New York, par la scène où Pacino sort, avec Diane Keaton, d’un grand magasin la veille de Noël, attiré par la « une » d’un journal annonçant la tentative d’assassinat dont son père a été la cible. Est-ce parce qu’il a imaginé, à raison, Michael Corleone sur un modèle de compression puis d’explosion, concevant dans un premier temps un gamin timide et terne, énigmatique à tout le moins, pour, petit à petit, dévoiler son charisme et sa beauté maléfique ?
Toujours est-il qu’en découvrant les rushs de la scène, les dirigeants de la Paramount ne comprennent pas pourquoi le comédien se livre à une interprétation aussi hermétique. La question de son remplacement se pose sérieusement. Pacino a jusqu’à la fin de la semaine pour montrer autre chose. « Sur le plateau, certains rigolaient dès que je me retrouvais devant la caméra, racontera ensuite l’acteur. Le studio voyait toute cette pellicule arriver et ils me trouvaient plutôt insipide. J’étais foutu. »
Un très léger tic, la tête balançant vers le haut, annonce le carnage à venir tout en signalant que l’acteur prend le contrôle du plateau
Quand arrive le dernier jour de la semaine, Pacino comprend qu’il risque de tourner son ultime scène du Parrain. Celle où Michael Corleone revendique son destin familial, retrouvant, dans un restaurant du Bronx, Solozzo, le mafieux qui a ordonné l’assassinat de son père, et un capitaine de police corrompu. Ce qui doit être une réunion de réconciliation, ou plutôt la soumission des Corleone au clan adverse, devient le premier acte de l’irrésistible ascension de Michael Corleone. Et de Pacino.
La séquence est tournée la nuit, en face du métro aérien, dont le bruit des wagons couvre en partie la voix des protagonistes attablés dans un restaurant miteux dont le rideau a été tiré. Pacino arbore un visage impassible. Le plus frappant reste ce qu’il ne fait pas, et puis cette manière de garder un ton de voix uniforme au milieu d’une conversation à l’enjeu fondamental. Ses yeux se perdent dans le vague.
Un très léger tic, la tête balançant vers le haut, annonce le carnage à venir tout en signalant que l’acteur prend le contrôle du plateau. Quand il énonce ses desiderata à ses interlocuteurs, on entend un bruit métallique strident, celui des roues du wagon de métro, semblable à un hurlement. Merveilleuse juxtaposition entre la fausse passivité de Pacino et le son envahissant.
Pacte avec le diable
Après avoir tué ses deux adversaires, Pacino se lève calmement, détourne son regard de l’assistance et sort de l’établissement. Dans le film, c’est le moment où il conclut son pacte avec le diable. Dans la vie, il s’agit de l’instant où, entré sur la pointe des pieds dans un restaurant italien du Bronx, sur le territoire de son enfance, Pacino en ressort en star. « Je ne tournerai pas d’autre prise », explique-t-il à Coppola, certain de son jeu, sûr de son talent, conscient qu’une carrière lui tend les bras.
Pacino, alors qu’il avait 14 ans, découvrit Brando dans Sur les quais, le film d’Elia Kazan (1955). Alors que les lumières de la salle se rallumaient, il resta pétrifié. Il lui fallut revoir le film immédiatement. « Je suis son fils, nous sommes tous ses fils », en déduisit le jeune garçon, qui n’a pas connu son père, celui-ci ayant quitté le domicile familial quand il avait 2 ans.
Brando, lui, observe Pacino à l’œuvre dans la séquence du mariage, au moment où il explique à Diane Keaton comment son père s’y est pris pour permettre à son filleul, un chanteur de renom, de rompre son contrat d’exclusivité avec son manager, lui proposant une offre impossible à refuser : sa cervelle sur la table ou sa signature au bas du nouveau contrat.
A la fin de la scène, Brando fait remarquer au jeune acteur à quel point sa concentration l’impressionne. Alors qu’une feuille tombe d’un arbre et se pose sur son épaule, il se contente de l’écarter, sans s’interrompre. Cette délicatesse impressionne Brando. Le soir même, Pacino s’autorise à se rendre dans un bar et boit sans discontinuer. Mais il ne cherchera pas la fréquentation du maître. Son attention lui suffit.
C’est le résultat de la méthode particulière, mais si efficace, dont ne s’écarte jamais l’acteur. « Nous étions tous nerveux à l’idée d’affronter Brando, se souvient James Caan. Je m’en sortais en racontant des blagues et en lui montrant mes fesses. Robert Duvall faisait des grimaces. Al, c’était différent. Il mettait en avant sa sensibilité, restait dans son coin. »
Violence sourde
Son rôle de Michael Corleone repose sur la rétention des émotions pour mieux laisser transpirer une violence sourde. Ce choix est à l’opposé de la méthode de Lee Strasberg, dont il a pourtant suivi les cours à l’Actors Studio. Brando dans Un tramway nommé désir, ou James Dean dans A l’est d’Eden, sont envahis par leurs émotions.
Pour parvenir à jouer une tout autre partition, masquer ses sentiments, devenir une enveloppe d’être humain, Pacino s’isole du reste de l’équipe, écoute Stravinsky, afin de trouver cette humeur abstraite. « Il y avait des choses normales qui lui étaient rigoureusement étrangères, écrit Diane Keaton dans ses Mémoires, comme l’idée de prendre un repas agréable en compagnie d’autres acteurs. Il préférait manger tout seul, sans même prendre le temps de s’asseoir. Les conversations que les gens avaient autour d’une table ne voulaient rien dire pour lui. »
Le film de Coppola sort le 15 mars 1972 aux États-Unis et pulvérise les records au box-office, rapportant 134 millions de dollars pour un budget initial de 6 millions
Six mois après la fin du tournage, alors que le montage est déjà très avancé, Francis Coppola juge indispensable de tourner une scène supplémentaire pour assurer la liaison entre l’exfiltration de Michael Corleone en Sicile après avoir tué un capitaine de police et son retour en Amérique, intronisé en Don. Coppola habille Pacino en costume trois pièces, un chapeau sur la tête, sortant d’une Cadillac pour réapparaître dans la vie de Diane Keaton. Parti en clandestin, il réapparaît en majesté.
Cette scène est tournée à Ross, en Californie, près de la maison où réside le père d’Al Pacino. L’acteur ne l’a plus revu depuis qu’il a quitté la maison. En fait, il ne l’a jamais vraiment connu, n’en a aucun souvenir. Salvatore Pacino s’est remarié quatre fois, et a eu trois filles. L’acteur préfère lui rendre visite avec Diane Keaton, qui est alors sa compagne, au moment où il peut expliquer à son père qu’il est en train de devenir quelqu’un.
Ce dernier, de son côté, est ému à la perspective de retrouver son unique fils, ne faisant aucun cas du fait qu’il sera bientôt une star de cinéma. L’acteur se demande comment appeler son père. Par son prénom ? Il opte finalement pour « papa », un mot qu’il n’a jamais prononcé. « J’ai d’emblée ressenti le lien familial, expliquera Pacino, qui est la raison pour laquelle nous nous identifions si fort au Parrain. »
Le monde s’est rétréci
Le film de Coppola sort le 15 mars 1972 aux Etats-Unis et pulvérise les records au box-office, rapportant 134 millions de dollars pour un budget initial de 6 millions. La brutale sortie de Pacino de l’anonymat n’en fait pas seulement l’acteur d’un moment. Dans Le Parrain, il devient la vitrine de l’Amérique triomphante de l’immédiat après-guerre, une période d’essor qui place le pays en position dominante, à l’image de la famille Corleone.
Deux ans plus tard, dans Le Parrain II, son Michael Corleone conjugue à sa puissance débordante une paranoïa exacerbée. A l’image du président Richard Nixon et d’un pays à ce point aveuglé par sa prospérité et sa puissance qu’il se perd dans une guerre inutile et coûteuse au Vietnam.
Le Parrain et Le Parrain II sont deux chefs-d’œuvre, mais, d’un film à l’autre, Pacino change de statut. Il devient l’acteur principal, aimante l’écran, porte le projet. Ce statut de star, il éprouve les plus grandes difficultés à le gérer. « Combien de fois me suis-je trouvé dans une fête en train de discuter dans le noir avec une fille, remarque l’acteur. Lorsque la lumière se rallume, la même fille découvre Al Pacino et ne me regarde plus de la même manière. »
Dans l’effervescence qui suit la sortie du Parrain, Pacino remarque que le monde, pour lui, s’est rétréci, qu’il ne pourra plus jamais marcher dans la rue aussi tranquillement qu’il le souhaitait. Une fille l’aborde dans la rue et lui demande : « Vous êtes Al Pacino ? » Il répond : « Oui ». Elle fait : « Non ? » Pacino lui fait alors remarquer : « Il faut bien que quelqu’un soit Al Pacino. » Nous sommes en 1972 : Al Pacino décide finalement de devenir lui-même.
Merci NumeroStar 
+1 merci pour le partage, ça se lit d'une traite.
J'espère qu'ils vont aborder Serpico.
J'espère qu'ils vont aborder Serpico.
Captivant. Merci.
Comme certains philosophes qui ont déjà tout dit, il y a des acteurs qui ne peuvent pas être égalés.
Les acteurs d'aujourd'hui sont bien ternes d'ailleurs.
Comme certains philosophes qui ont déjà tout dit, il y a des acteurs qui ne peuvent pas être égalés.
Les acteurs d'aujourd'hui sont bien ternes d'ailleurs.
Par contre la pauvreté des sorties ciné cet été, c'est aberrant... à part le Tarantino évidemment. Midsommar de Ari Aster (Hérédité) éventuellement.
Je vais voir le nouveau Almodovar dimanche soir, des retours ?
Horrible.
Et j'aimais bien Almodovar mais ses deux derniers...je te la fait courte, c'est de la merde auteurisante, incroyablement chiant, ça ne raconte rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans mais il y a l'étiquette "Almodovar", alors le critique presse blasé fout un 5/5.
Horrible.
Dis-moi les autres choix que tu as, je vais te sauver vite fait ta soirée.
Horrible.
Et j'aimais bien Almodovar mais ses deux derniers...je te la fait courte, c'est de la merde auteurisante, incroyablement chiant, ça ne raconte rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans mais il y a l'étiquette "Almodovar", alors le critique presse blasé fout un 5/5.
Horrible.
Dis-moi les autres choix que tu as, je vais te sauver vite fait ta soirée.
Et j'aimais bien Almodovar mais ses deux derniers...je te la fait courte, c'est de la merde auteurisante, incroyablement chiant, ça ne raconte rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans mais il y a l'étiquette "Almodovar", alors le critique presse blasé fout un 5/5.
Horrible.
Dis-moi les autres choix que tu as, je vais te sauver vite fait ta soirée.
Ah bah ya pas d'autres choix, "on va voir le dernier Almodovar"
C’est un très grand film.
Bon bah soit tu vas adorer, soit détester 
Cruising.
Al Pacino en six films cultes (3/6). Le tournage de ce film très cru de 1980 sur le milieu gay SM de New York, de William Friedkin, a beaucoup éprouvé l’acteur. Il lui offre pourtant un de ses rôles les plus emblématiques.
New York, 2 juillet 1979, 8 heures du matin. William Friedkin attend Al Pacino devant le palais de justice de New York, pour le premier jour du tournage de Cruising. Le réalisateur de French Connection (1971) et de L’Exorciste (1973) doit filmer dans un bureau où l’officier de police incarné par Al Pacino reçoit son ordre de mission pour s’infiltrer dans les boîtes gay sadomasochistes (SM), situées dans le Meatpacking District, le quartier des entrepôts de viande. Un tueur sévit dans ces clubs très privés et vise des victimes au physique comparable à celui du policier. Il servira d’appât.
A 10 heures, toujours pas de Pacino. Affolé, William Friedkin tente de lui téléphoner à son appartement, puis il appelle son agent. Sans succès. A se demander si l’acteur n’a pas décidé de se retirer du film sans en avertir quiconque.
En 1979, Al Pacino vient d’avoir 39 ans. Si on l’observe bien, les premiers signes de vieillissement sont là : des poches sous les yeux, une peau tuméfiée, deux rides verticales qui cadrent le nez. La dureté du visage est inédite. Cette sécheresse est d’autant plus frappante que tout au long de la décennie 1970, l’acteur est passé du statut de quasi-inconnu à celui de plus grand acteur du monde, après les succès du Parrain I et II, de Francis Ford Coppola (1972 et 1974), de Serpico (1973) et d’Un après-midi de chien (1975), de Sidney Lumet. A chaque fois, la jeunesse de Pacino a frappé les esprits.
Lorsque John Travolta, en 1977, dans La Fièvre du samedi soir, se coiffe en répétant des pas de danse, il a pour référence le portrait de Pacino barbu dans Serpico. C’est le signe qu’il est à la fois une icône de la culture populaire et un modèle pour les Italo-Américains. Avec la disparition de son allure juvénile, c’est une époque dont il faut se résoudre à tourner la page, précisément l’hédonisme des années disco dont La Fièvre du samedi soir constitue le document filmé par excellence.
Pacino a d’autant plus de mal à regarder dans le rétroviseur qu’il a vécu les années 1970 à la manière d’un ouragan, sans en garder vraiment des souvenirs. Du reste, il ne peut que constater son amnésie. « Il serait honnête de reconnaître que j’étais absent, estime Pacino dans un entretien au New Yorker, en 2014. Ces bouleversements se montraient impossibles à gérer, pour moi, pour n’importe qui en fait. »
Un comportement déjà erratique
L’alcool joue un rôle-clé dans cette mémoire versatile. Pacino ne se contente pas d’être un buveur invétéré, il s’en vante. « Laurence Olivier avait raison quand il disait que la meilleure chose, au théâtre, c’est le petit verre après le spectacle », confie-t-il en 1975.
Dix ans plus tard et alors qu’il a suivi une cure de désintoxication en 1977, il tient un discours autrement plus douloureux sur son addiction : « Petit à petit, j’ai compris ce que je pouvais devenir si je décidais d’arrêter. Alors, j’ai arrêté, lentement. Et les choses se sont éclaircies. Mais juste un peu… »
Ce jeudi 2 juillet 1979, vers 10 h 30, Pacino gare sa voiture devant le palais de justice de New York. L’acteur en sort tranquillement, prend William Friedkin dans ses bras, puis demande au réalisateur ce qui est prévu. Il devrait le savoir. Il est immergé depuis des mois dans les clubs gay SM. Mais son comportement, en marge du travail de fond auquel il s’oblige pour chaque film, et qui a fait sa réputation, se révèle déjà erratique.
« Pacino logeait dans un appartement d’East Manhattan, habité auparavant par Louis Malle et Candice Bergen, se souvient Friedkin. Le lieu restait intact, les photos du réalisateur français et de l’actrice américaine étaient toujours accrochées au mur. Seuls les habits de Pacino, jetés au sol, laissaient entendre qu’il habitait ici. On aurait cru un vagabond, mais Al vivait de cette manière. Il s’est mis ensuite à débarquer chez moi, au milieu de la nuit. Je lui disais de se faire un thé et un sandwich, puis je retournais me coucher. Quand je me levais, vers 6 heures, il n’avait pas bougé de la cuisine. Il n’avait pas bu de thé, car il ne savait pas en faire. Il n’avait pas non plus pris de sandwich, ne sachant pas non plus comment couper une tranche de pain. »
Plusieurs événements réels s’entremêlent, qui vont donner naissance à Cruising. En 1979, le magazine Village Voice, sous la plume d’Arthur Bell, le journaliste qui suit alors la communauté homosexuelle de New York, rend compte d’une série de morts inexpliquées dans ce milieu, mais aussi de meurtres commis dans le West Village, dans des clubs SM du Meatpacking District. Il n’existe pas encore de nom pour qualifier le sida.
Pour une raison inconnue, le nombre de décès des homosexuels s’accroît. Les meurtres se révèlent tout aussi mystérieux. Des morceaux de cadavre, jetés dans des sacs en plastique flottant sur l’Hudson River, sont retrouvés par la police qui les étiquette, faute de mieux, « CUPPI » – acronyme pour « affaire indéterminée, enquête de police en cours ».
« Tueur aux sacs-poubelles »
William Friedkin a déjà entendu parler des clubs SM par l’intermédiaire de Randy Jurgensen, un policier à la retraite qui a commencé à travailler avec lui sur French Connection, et auquel on avait confié la mission, dans les années 1960, de s’insérer dans ces clubs, pour retrouver un tueur. Un matin, en lisant le New York Daily News, Friedkin tombe sur un article évoquant l’arrestation de Paul Bateson, affublé du surnom de « tueur aux sacs-poubelle ». Ce dernier est accusé de plusieurs meurtres d’homosexuels, dont celui d’Addison Verrill, un journaliste de cinéma travaillant pour le quotidien professionnel Variety.
Le réalisateur s’arrête d’emblée sur la photo de Paul Bateson. Non seulement il connaît ce jeune homme, mais il l’a filmé. Il symbolise l’infirmier préparant l’artériographie de la jeune fille possédée de L’Exorciste, qui souffrirait d’un désordre cérébral. « Il portait des boucles d’oreilles et un bracelet de force, se souvient Friedkin, une manière de revendiquer sa sexualité, une chose rare en 1972. »
Le réalisateur obtient l’autorisation de rendre visite au meurtrier à la prison de Rikers Island, située sur l’East River. Paul Bateson accueille Friedkin avec joie, heureux d’apprendre que L’Exorciste a été un énorme succès au box-office. Puis il lui confie qu’il a tué plusieurs personnes. Combien ? Trois sans doute, mais certainement pas les huit ou neuf meurtres qu’on lui attribue. Il a rencontré Addison Verrill au Mineshaft, une « backroom » située sur Washington Street, en plein Greenwich Village, devenue, à son échelle et dans son registre, aussi réputée que le Studio 54, la boîte disco où le Tout-New York va danser.
Le Mineshaft est fréquenté par des stars et des inconnus. Parmi eux, Andy Warhol, Keith Haring, Michel Foucault, ou le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Après sa soirée au Mineshaft, Paul Bateson ramène chez lui Addison Verrill, il l’assomme avec une poêle à frire, puis le découpe en morceaux.
Rétif devant la moindre scène de sexe
William Friedkin est persuadé de tenir une histoire hors du commun. Il reste au réalisateur de L’Exorciste à découvrir, en compagnie de Randy Jurgensen, improvisé conseiller technique, les clubs SM : le Mineshaft bien entendu, mais aussi le Ramrod, l’Eagle’s Nest, l’Anvil.
« Je n’ai jamais vu un spectacle pareil, constate le réalisateur américain. Pour entrer au Mineshaft, il fallait monter un escalier étroit au bout duquel vous attendaient deux vigiles qui vérifiaient votre identité, car il s’agissait d’un club privé. Il a fallu nous déshabiller pour ne conserver que notre slip, nos chaussettes et nos chaussures. Certains membres portaient des masques en cuir. D’autres se contentaient d’une veste ou d’un gilet toujours en cuir. Les murs étaient peints en noir, avec des lampes à ultraviolets. Cela ressemblait à une cellule de prison, avec un donjon où des hommes avaient des relations orales et anales. Un mur où certains se faisaient fouetter. Une baignoire où un type se faisait pisser dessus. Juste à côté, un homme ligoté se faisait administrer un fist-fucking. Tous les fantasmes possibles se trouvaient satisfaits. »
Le Mineshaft et l’Anvil appartenaient à un certain Matty « le Cheval » Ianniello, un membre de la famille Genovese. La plupart des clubs et bars gay à cette époque restaient propriété de la Mafia. Iannello, un admirateur de French Connection, pour lequel Friedkin avait reçu l’Oscar du meilleur film en 1972, accorde au réalisateur les autorisations de tournage et sa protection, à la condition qu’il ne soit jamais fait mention dans le film des liens entre ces clubs et la Mafia.
L’acteur Pacino peut alors effectuer sa tournée dans les clubs. Pourquoi ce comédien, connu pour son extrême pudeur, rétif devant la moindre scène de sexe, a-t-il tout mis en œuvre, contactant lui-même William Friedkin, pour obtenir le rôle principal de Cruising ?
Un acteur qui, trois ans plus tôt, après avoir lu le scénario d’Un après-midi de chien, inspiré d’un fait divers authentique, où son personnage de malfaiteur attaque une banque pour financer l’opération permettant à son amant de changer de sexe, avait refusé de tourner une scène où il devait embrasser son partenaire sur la bouche.
Pacino avait proposé à la place, au réalisateur Sidney Lumet, de jouer cette scène au téléphone, pour qu’Un après-midi de chien devienne l’histoire de deux personnes qui s’aiment sans trouver le moyen de vivre ensemble. Une idée brillante, digne d’un acteur de génie, accueillie, comme il se doit, avec enthousiasme par Sidney Lumet.
Un film radical, à la frontière de la pornographie
Au moment d’Un après-midi de chien, après Le Parrain et Serpico, situés eux aussi à New York, Pacino incarne mieux qu’aucun autre acteur les tréfonds dans lesquels cette ville continue de sombrer après le départ de son maire John Lindsay et l’élection d’Ed Koch.
Mais, entre-temps, a surgi le chauffeur de taxi, vétéran du Vietnam, incarné par Robert De Niro, sillonnant les rues de New York dans Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, qui amène la folie destructrice du personnage à un niveau rarement atteint à l’écran.
Avec Cruising, c’est comme si Al Pacino, en pleine période punk, décide de prêter son visage et son corps à un stade supérieur de l’enfer new-yorkais. Aucune star n’a jamais accepté de tourner un film aussi radical, à la frontière de la pornographie. Et aucune ne s’y est risquée depuis.
Pacino est fou de joie de retrouver Randy Jurgensen, qu’il a côtoyé sur le tournage du Parrain. C’est avec lui qu’il s’apprête à découvrir les boîtes de nuit cuir. « La conversation restait pourtant à sens unique », se souvient Jurgensen. Ce dernier commence par lui expliquer la signification des couleurs des bandanas accrochés à la poche du jean des membres des clubs SM – ce qui donnera une des scènes emblématiques de Cruising.
« Friedkin expliquait à Pacino de quelle manière il se ferait toiser, caresser, harceler par les membres du club. Pacino ne mouftait pas. Il se nourrissait du spectacle, absorbait tout. Ce mec est une éponge », Randy Jurgensen, ancien policier
Après avoir passé sa première nuit dans un club SM, le personnage joué par Pacino veut en savoir plus, entre dans un magasin d’accessoires et demande le mode d’emploi des bandanas au vendeur : « Bleu dans la poche arrière gauche : tu cherches la pipe. Poche droite : c’est toi qui la fais. Vert, à gauche : tu fais la passe. A droite : tu es client. Jaune, à gauche : tu pisses sur ton mec. A droite : c’est l’inverse. »
L’explication terminée, Randy Jurgensen découvre un Pacino secouant la tête. « Après chaque épisode, il me répétait : “Tu as vraiment fait un truc pareil ?” Il m’assaillait littéralement de questions, dont l’une revenait sans cesse : “Tu es arrivé à tenir le coup ?” En fait, non. Je ne suis pas tombé malade durant cette mission, mais je me suis perdu. Ce truc m’a vrillé la tête. Là, Pacino était inquiet. Vous pouvez voir cela dans le film, dans la scène où il se regarde dans un miroir : il secoue la tête, et essaie de comprendre qui il est. »
L’étape des travaux pratiques, c’est-à-dire la fréquentation du Mineshaft et de l’Anvil, en compagnie de Randy Jurgensen et de William Friedkin, se révèle compliquée ; comment entrer dans ces clubs, en compagnie de la plus importante star du box-office américain, mais sans garde du corps ? « Friedkin, remarque Jurgensen, expliquait à Pacino comment il le dirigerait dans le film, de quelle manière il se ferait toiser, caresser, harceler par les membres du club. Pacino ne mouftait pas. Il gardait un visage figé. Ce n’est pas qu’il s’en foutait, mais il se nourrissait du spectacle, absorbait tout. Ce mec est une éponge. »
L’un des tournages les plus agités de l’histoire du cinéma
Le plus éprouvant pour Pacino a lieu moins à l’intérieur des clubs qu’à ciel ouvert, lorsque le tournage de Cruising, au milieu de la canicule de l’été 1979, devient l’un des plus agités de l’histoire du cinéma. Dans l’édition du 16 juillet du Village Voice, Arthur Bell, le même journaliste qui avait auparavant attiré l’attention de Friedkin sur la série de meurtres commis dans les clubs SM, signe un article dévastateur appelant à une croisade contre le film :
« Cruising s’annonce comme le film le plus accablant, insultant et sectaire jamais réalisé sur l’homosexualité. J’implore les lecteurs, gay, hétérosexuels, libéraux, radicaux, athées, communistes, peu importe, de rendre à Friedkin et à son équipe la vie impossible dès que vous les verrez tourner dans votre quartier. »
Des groupes homosexuels envoient des courriers au maire de New York, Ed Koch, lui demandant de retirer au film son autorisation de tournage. Sans succès. Suivent des menaces de mort, par courrier ou au téléphone.
La plupart des scènes, tournées de nuit, ont lieu pendant que des centaines de manifestants insultent comédiens et techniciens. Aux insultes succèdent des jets de pierres et de bouteilles ; que l’équipe du film, dont des membres des clubs SM, employés comme figurants, renvoient aux manifestants. Le sommet de la bataille urbaine est atteint le 26 juillet quand plusieurs milliers de manifestants défilent dans Greenwich Village en hurlant : « Cruising doit partir ! » La manifestation est brisée par la police montée de New York, dont toutes les forces sont mobilisées à cette occasion.
« Il y a une scène, note William Friedkin, dans laquelle Pacino marche seul la nuit dans Greenwich Village. Ça, c’est devant la caméra. Derrière, vous aviez des centaines de manifestants qui hurlaient : “Pacino, espèce de trou du cul, sale petite tapette, tu vas te faire enculer.” Il devait faire comme s’il n’y avait personne, mais vous lisez la peur sur son visage. » Le cinéaste ajoute : « Je ne suis pas dingue de sa performance dans le film, je n’arrive pas à me souvenir d’un jour où il est arrivé sur le plateau en connaissant son texte, mais il parvient admirablement à contenir ce sentiment de peur que le spectateur ressent à merveille. »
Pour oublier le bruit des manifestants, Pacino s’enferme entre deux prises dans sa loge et lit à voix haute à son maquilleur La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht.
Avec le recul, le tournage de Cruising peut apparaître comme le moment où la communauté homosexuelle américaine se remobilise et se soude, d’autant qu’elle vient de fêter le dixième anniversaire des émeutes de Stonewall, acte fondateur du militantisme LGBT. « Après tout, souligne Friedkin, cette communauté mobilisait ses efforts pour obtenir sa légitimité. Elle craignait que mon film, décrivant des pratiques sexuelles marginales, la ramène plusieurs années en arrière. Elle se trompait mais, aujourd’hui, je comprends ses craintes. »
[b]Le film échappe au classement X[/b]
A la fin d’un tournage tumultueux, Friedkin poursuit son chemin de croix. Il doit affronter la commission de classification. Le réalisateur a volontairement laissé durer les scènes de sexe crues et de meurtre, sachant qu’elles seraient coupées par la suite, si bien que Cruising échappe au classement X – label attribué aux films pornographiques – pour un classement R, une interdiction moins contraignante, autorisant une distribution dans toutes les salles.
Quand il découvre le film, Pacino est décontenancé. Selon le témoignage de Friedkin, l’acteur n’y comprend rien. Il demande, sans succès, un certain nombre de coupes et dit sa désapprobation devant l’évolution de son personnage qui se révèle aussi un meurtrier, ce qui n’était pas précisé dans le scénario. Pacino se désolidarise alors de Cruising. « C’est un film qu’Al m’a fait promettre de ne jamais regarder », confie Marthe Keller, qui devient sa compagne après avoir été avec lui à l’affiche de Bobby Deerfield (1977), de Sydney Pollack.
L’accueil critique du film est accablant. Arthur Bell, dans le Village Voice, le décrit comme « le regard le plus obscène et réactionnaire jamais porté sur l’homosexualité ». Variety, la bible du show-business, conclut ainsi sa critique : « Si ça c’est un film classé R, alors il ne restera dans le genre X que les films vraiment extrêmes. » La carrière commerciale de Cruising s’avère tout aussi désastreuse. C’est le premier échec cinglant de la carrière de Pacino.
Avec les années, le film honni jouira d’une réputation grandissante. Au point de devenir l’un des rôles emblématiques de Pacino et de s’imposer comme le témoignage d’un monde disparu. Alors que la restauration de Cruising est projetée au Festival de Cannes, en 2007, William Friedkin prend un café avec Quentin Tarantino, grand admirateur du film, et lui demande comment une œuvre aussi maudite a pu gagner une légitimité et une réputation : « Le film rappelle quelque chose pour toujours perdu, explique le réalisateur de Pulp Fiction. Un monde auquel les jeunes qui sont dans le SM n’ont plus accès en claquant des doigts, car le sida est passé par là. »
En 1979, Al Pacino devient le soleil noir d’une époque sur le point d’être gagnée par le cataclysme d’une épidémie. Mais il ne s’exprimera jamais sur ce film. Ni sur son tournage. Il prétend avoir tout oublié. Quarante ans après, il est bien le seul à ne pas vouloir s’en souvenir.
Al Pacino en six films cultes (4/6). En 1983, l’acteur ne se contente plus d’incarner un personnage. Il « est » Tony Montana, un effrayant trafiquant de cocaïne aux désirs incestueux.
Fin janvier 1982, Al Pacino dîne dans un restaurant new-yorkais avec Lee Strasberg. C’est un rituel. Chaque semaine, dans la mesure du possible, il retrouve son mentor à l’Actors Studio dans le même delicatessen. Quelques jours plus tard, son professeur meurt, à 80 ans, d’un infarctus. Ce dîner sera leur dernier rendez-vous.
Après la mort, en 1978, de l’acteur John Cazale, son partenaire dans Le Parrain, Le Parrain II, de Francis Ford Coppola et Un après-midi de chien, de Sidney Lumet, un frère symbolique, Pacino perd son père de substitution, lui qui n’a quasiment pas connu le sien. Il doit faire le deuil de sa famille d’adoption.
Pacino et Strasberg évoquent ce soir-là leur besoin de tourner ensemble, ce qui est la meilleure façon de ne jamais se quitter. Et pour l’acteur le moyen de continuer à écouter les conseils du maître. La première fois qu’ils sont ensemble à l’écran, c’est dans Le Parrain II, en 1974. Strasberg n’est alors plus apparu au cinéma depuis vingt-trois ans. Pacino l’impose pour incarner son ennemi juré dans le film, le gangster Hyman Roth.
Ils sont réunis à nouveau cinq ans plus tard dans Justice pour tous, de Norman Jewison, le premier film sans relief de la filmographie de Pacino, dans lequel il incarne un avocat luttant contre la corruption au sein du système judiciaire. Il a demandé que Strasberg y incarne son grand-père. Celui-ci, pensionnaire d’une maison de retraite, perd progressivement la mémoire, tout en conservant son autorité morale. La coiffure du maître apparaît plus ébouriffée que d’ordinaire. Différente de son allure de grand sage et de redoutable stratège dans le Parrain II.
Les cheveux exceptés, Strasberg ne change pas : une masse de fonte, imperméable au temps qui passe et aux idées arrêtées. En marge du tournage de Justice pour tous, il fait remarquer à Pacino qu’il ne partage pas son purisme dans l’approche des rôles. C’est l’époque où l’acteur n’apprend plus ses textes, préférant entrer d’abord dans la peau du personnage pour, soi-disant, trouver une manière plus spontanée de dire ses dialogues.
William Friedkin déplore la même chose sur le tournage de Cruising (1980). Pacino, tout en jouant, récite son texte griffonné sur des mémos scotchés sur les murs ou collés sur le front de ses partenaires. Cette manie, il l’emprunte à Brando, qui a pris cette fâcheuse habitude depuis longtemps. « Al, apprends ton putain de texte, lui répète Strasberg. Simplement ton texte. Tu verras, après, les choses te sembleront plus simples. »
Happé par le vide
Lors de leur dernier dîner, Strasberg décrit à Pacino ce que seront ses vingt prochaines années. Son idée consiste à enseigner jusqu’à l’âge de 100 ans. Mais se pose tout de même la question de la transmission. Le maître a formé Marlon Brando. James Dean. Puis Paul Newman. Pacino enfin. Qui ensuite ? Strasberg évoque la possibilité que l’acteur du Parrain lui succède à l’Actors Studio. Mais, au moment du café, troublé par l’excès d’intensité de son poulain, son obsession de tout analyser et décortiquer, sa tendance à expérimenter au-delà du raisonnable, le professeur lui lance : « Al, tu vas devoir apprendre à te laisser aller. »
Après la mort brutale de Lee Strasberg, Pacino est happé par le vide. Dix mois plus tard, en novembre 1982, il doit commencer à Miami le tournage de Scarface, avec le cinéaste Brian De Palma. Un remake du classique éponyme d’Howard Hawks, de 1932. Il n’a plus d’autre choix que de se préparer à se laisser aller. C’est son héritage, en forme d’injonction, alors que résonne la voix de son mentor.
Il doit se laisser aller, d’autant qu’il sort de trois échecs commerciaux au cinéma. Ce rôle va lui permettre de séduire à nouveau les foules. Scarface, il le veut et il le porte depuis longtemps. Il le porte depuis qu’il a joué au théâtre, à Boston en 1975, dans la pièce de Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui. Brecht a écrit en 1941 sa parodie de l’ascension d’Hitler au pouvoir en s’inspirant des films de gangsters américains, dont le plus célèbre est Scarface.
Al Pacino dans « Scarface », réalisé par Brian De Palma. Un film à la violence exacerbée, au langage ordurier, et à l’esthétique hors norme.
Pour incarner Arturo Ui, Pacino veut visionner le classique de Hawks, avec Paul Muni dans le rôle-titre du gangster, modelé sur Al Capone. Mais le propriétaire du film, le milliardaire Howard Hughes, bloque alors toute diffusion. Ce qui explique que les metteurs en scène du nouvel Hollywood, Brian De Palma et Martin Scorsese en tête, n’aient pu le découvrir qu’au début des années 1980.
En 1981, Pacino roule sur Sunset Boulevard, à Los Angeles, et passe devant un cinéma d’art et essai programmant Scarface. Il s’arrête et entre dans la salle. Il est surpris par la violence, inhabituelle dans les années 1930, du film de Hawks. Les gangsters se distinguent par leur analphabétisme, leur puérilité, par des attitudes primaires et bestiales, si peu héroïques. Pacino remarque aussi la référence aux Borgia pour dépeindre Capone et la jalousie incestueuse que lui inspire sa sœur.
Miami, plaque tournante de la drogue aux Etats-Unis
Pacino en est convaincu. Il y a matière à réaliser une nouvelle version du classique de Hawks. Il confie cette tâche à Marty Bregman, son ancien imprésario devenu producteur. Bregman se tourne naturellement vers Sidney Lumet, qui a tourné avec l’acteur Serpico (1973) et Un après-midi de chien (1975), deux de ses plus gros succès. Lumet ne veut pas un film rétro ou fidèle au modèle mais une option contemporaine. Et pour cela il faut un sujet, une actualité.
Au printemps 1980, le régime de Fidel Castro expulse 125 000 Cubains considérés comme contre-révolutionnaires. Baptisés « marielitos », car partis du port de Mariel, à 40 kilomètres de La Havane, ils débarquent sur les côtes de la Floride. Environ un cinquième d’entre eux sont des « indésirables » : libérés des prisons cubaines ou échappés d’hôpitaux psychiatriques, ils font partie du « colis » adressé par Fidel Castro au gouvernement des Etats-Unis. Lumet, frappé de voir à quelle vitesse Miami devient la plaque tournante de la drogue aux Etats-Unis, pense tenir la trame d’une nouvelle version de Scarface, dans laquelle le trafic de cocaïne remplacerait la Prohibition, alors que les gangsters cubains se substitueraient à la pègre italienne.
« La ville affichait une statistique étrange. Alors qu’elle n’est pas un centre industriel, elle était devenue la deuxième zone bancaire au monde. » Oliver Stone, scénariste du film
Le réalisateur confie l’écriture du scénario de Scarface au scénariste de Midnight Express (1978) et futur réalisateur de Platoon (1986) et de JFK (1991), Oliver Stone. Qui se penche sur le « cas » Miami. « La ville affichait une statistique étrange, raconte aujourd’hui Oliver Stone. Alors qu’elle n’est pas un centre industriel, elle était devenue la deuxième zone bancaire au monde. Je vais rencontrer le procureur général des Etats-Unis à Washington pour comprendre. Il m’explique que l’industrie de la cocaïne génère 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an. Je le corrige, pensant qu’il veut dire 100 millions de dollars. Il me répète : “100 milliards”. »
Le scénariste se rend ensuite en Bolivie, au Pérou et en Equateur afin de comprendre comment transite la cocaïne entre l’Amérique du Sud et la Floride. Stone rencontre la nuit des trafiquants de drogue à l’allure de playboys, bardés de chaînes en or. Il leur explique qu’il est scénariste et prépare un film.
« La nuit n’est sans doute pas le meilleur moment pour rencontrer ces énergumènes à l’humeur versatile, reconnaît-il. Ils sont capables, estimant avoir trop parlé, de vous loger une balle dans la tête. Un soir, je vais chez l’un d’eux pour boire un verre, sniffer et faire la fête. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai prononcé le nom d’un ancien avocat qui m’avait aidé à Miami pour mes recherches. Les mecs ont changé de couleur. Ce nom était celui d’un indic qu’ils recherchaient. Cela signifiait que je n’étais pas un scénariste, mais un agent infiltré. J’étais dans la merde. Avoir autant sniffé m’a permis de louvoyer. Mais vous n’imaginez pas comme j’ai eu peur. Cette peur, je l’avais ressentie au Vietnam. Et cette peur est l’essence de Scarface. »
Tuer est un art qu’il faut partager
C’est à Paris qu’Oliver Stone écrit son scénario. Pour garder les idées claires. Loin de New York ou de Los Angeles, où la cocaïne est plus accessible. Mais lorsqu’il remet son texte, le metteur en scène a changé. Sidney Lumet veut un film politique, il entend souligner les liens entre la CIA et les cartels sud-américains de la drogue dans la lutte anticommuniste.
Al Pacino, au contraire, veut un film focalisé sur le personnage principal, Tony Montana, le gangster cubain devenu le baron de la drogue. L’acteur privilégie une approche brechtienne, très théâtrale, de son personnage, avec lequel les spectateurs peuvent s’identifier tout en étant horrifiés par la violence de ses actes et de ses mots. « Tony Montana est toujours perçu comme bidimensionnel, précise alors Pacino. C’est le style du film. On ne cherche jamais à expliquer pourquoi il fait ce qu’il fait. »
Ce que veut Pacino rejoint la conviction de Brian De Palma : faire un film outré, à la violence exacerbée, au langage ordurier, à l’esthétique hors norme. Le metteur en scène de Carrie (1976) et de Blow Out (1981) opte pour des couleurs vives, criardes, vulgaires, dictées par l’ambiance du sud de la Floride, l’esprit tropical des gens et des lieux, le machisme latin aussi. Tony Montana conduit une Cadillac aux sièges recouverts d’un tissu simili-léopard, porte des chemises hawaïennes, avant d’ériger un palais tout stuc et rococo avec, au centre, une piscine en marbre.
Le film de gangsters est souvent en noir et blanc, les règlements de comptes ont pour théâtre des ruelles obscures animées par des hommes de main au costume sombre. Dans Scarface, les fusillades ont lieu en plein jour et opposent des tueurs le plus souvent habillés de blanc. Tuer est une parade, un art qu’il faut partager.
Les trafiquants de drogue cubains, remarque De Palma, ne se contentent pas de tuer leurs ennemis : ils les découpent en morceaux qu’ils déposent devant la poubelle d’une épicerie. Le réalisateur américain tient à mettre en valeur le rapport particulier, pathologique, paroxystique à la violence des gangs cubains, si différent de tout ce qui a pu être montré auparavant au cinéma – et que l’on retrouve dans la guerre de la drogue au Mexique, à partir des années 2000.
Pacino veut être Tony Montana
Pacino ne veut pas incarner, mais être Tony Montana. Il a un problème de langue. Le père du personnage est américain, sa mère cubaine, et son anglais, mal maîtrisé, reste un mélange de deux accents. Pacino effectue alors le pèlerinage à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, où réside Robert Easton, un ancien acteur de série B, désormais spécialiste des accents.
Pacino constate que la seule pièce de la maison de Robert Easton qui ne soit pas envahie de livres est la chambre à coucher. Le reste de l’espace est vampirisé par des ouvrages consacrés à tous les dialectes imaginables, du créole jamaïcain au chuukois, l’une des neuf langues parlées en Macron le big bossésie.
C’est donc sur le lit de son coach que Pacino perfectionne, des semaines durant, son accent en face de cet étrange individu aux cheveux longs et à la barbe blanche, qui ressemble davantage au Gandalf du Seigneur des anneaux qu’à un professeur d’université. La détermination de l’acteur ne surprend pas De Palma :
« Je le connaissais depuis le milieu des années 1960. Je sortais alors avec Jill Clayburgh, qui deviendrait ensuite sa petite amie. Il travaillait différemment des autres acteurs, très proche dans sa méthode de Dustin Hoffman, mais avec un travail préparatoire considérable et une intensité inhabituelle. »
De Palma poursuit : « Cet investissement m’apparaissait nécessaire pour composer un gangster cubain qui était aux antipodes de la personnalité et de la culture de Pacino. »
Après avoir maîtrisé son accent, Pacino passe plusieurs mois en compagnie de son acolyte dans Scarface, l’acteur d’origine cubaine Steven Bauer, qui incarne son bras droit et son compagnon d’exil. Les deux hommes ne se quittent pour ainsi dire jamais. Grace à Bauer, Pacino s’immerge dans le Miami cubain et n’échange qu’en espagnol avec lui.
Bauer est né à La Havane le 2 décembre 1956, le jour où Fidel Castro rentre clandestinement à Cuba en provenance du Mexique avec 80 exilés, dont Che Guevara, pour ensuite marcher vers le pouvoir. Le père de Steven Bauer, sceptique sur l’instauration du communisme dans l’île, choisit l’exil aux Etats-Unis et installe sa famille à Miami.
« Le destin des “marielitos” ne m’était pas étranger, raconte Steven Bauer, même si j’appartiens à la génération qui a gagné les Etats-Unis vingt ans plus tôt. Je les ai vus agir à Miami. Ils ont été pris en tenaille entre le pouvoir répressif communiste et le prétendu rêve américain. Cela a créé une tension impossible. J’ai vu Miami se dégrader en peu de temps. J’avais la trouille. Cette vague criminelle était épouvantable. »
« Quelque chose de complètement décadent dans son jeu »
La réalité des « marielitos », rejetés par leur pays et prêts à tout risquer dans un autre, indifférents à la mort en raison de leur marginalité absolue, voilà ce que doit faire ressentir Pacino. Il le fait sans limite. « Al m’intimidait, explique Oliver Stone. Il fallait quand même voir le spectacle durant les répétitions. Le mec mettait tout le monde mal à l’aise. Je l’ai vu transformer Tony Montana en bête sauvage. Il y avait quelque chose de complètement décadent dans son jeu. »
La première scène de « Scarface » est inoubliable. Rarement un personnage n’a été aussi bien introduit dans un film
Le regard de Pacino face à un trafiquant de drogue colombien, à l’occasion d’un deal qui tourne mal, alors que ce dernier sort une tronçonneuse pour le découper, fait partie des nombreux moments de sauvagerie du film.
Pacino a bien retenu l’ultime conseil de son mentor : se laisser aller. « C’est l’une des choses formidables quand on est acteur, explique alors Al Pacino au journaliste Lawrence Grobel. Tu es soudain capable de dire à quelqu’un qui est sur le point de te trancher la tête avec une tronçonneuse qu’il peut bien se la fourrer dans le cul. »
Tony Montana est le rôle préféré de Pacino à l’écran. Cela se voit d’emblée. Le début d’un film conditionne souvent la suite. La première scène de Scarface, avec Tony Montana en chemise à fleurs, maniant mensonges et calembours, hautain et blagueur, roulant des mécaniques face aux officiers américains de l’immigration, est inoubliable. Rarement un personnage n’a été aussi bien introduit dans un film.
« Al envahit l’écran avec son visage, constate Brian De Palma. Il faut toujours s’efforcer de présenter son personnage principal de manière spectaculaire. Le visage de Pacino, sa cicatrice – une partie sur la joue, sauf qu’elle déborde aussi sur son œil, une idée d’Al pour signifier sa sauvagerie –, sa manière unique de bouger, sont révélés en un seul gros plan. Son arrogance, son machisme latin exubérant s’imposent en une seconde. C’est ce qui s’appelle une star de cinéma. »
Combat contre la censure américaine
Une fois le tournage terminé, à Los Angeles et à Miami, un autre combat attend l’acteur et son cinéaste. Celui contre la censure américaine. Les censeurs sont décontenancés par la violence du film, en particulier par la séquence où, sous le regard hébété de Pacino, l’un de ses complices est découpé à la tronçonneuse dans une baignoire. De cette scène, on ne voit que le visage de Pacino aspergé de sang, quand la censure prétend qu’on voit aussi l’homme mis en pièces.
Plusieurs montages successifs sont proposés, pour alléger un peu le film, mais les censeurs maintiennent le classement « X ». La carrière commerciale de Scarface est compromise. De Palma, soutenu par Martin Scorsese, décide alors de plaider sa cause dans la presse, puis à nouveau devant la commission de censure. Il obtient le label « R », moins restrictif que le « X », ce qui permet aux moins de 17 ans de voir le film à condition d’être accompagnés par un adulte. C’est la première version de Scarface, la plus violente, qui est proposée au public.
Le film arrive sur les écrans en décembre 1983, et l’accueil critique et commercial est très mauvais. L’interprétation de Al Pacino, considérée comme outrée, est visée. Il y a une autre raison, politique. Dans les années 1970, l’opinion accepte, voire juge souhaitable, qu’il incarne le New York décadent, un pays vacillant entre le Vietnam, le Watergate et la crise économique. En revanche, elle accepte moins de le voir dénoncer les excès des années Reagan, et même de livrer une version dégénérée du rêve américain avec son libéralisme débridé. La phrase de Tony Montana : « le capitalisme, c’est enculer les gens » résume bien l’affaire.
Des phrases-chocs comme celle-ci, Pacino en balance par dizaines dans Scarface. Par exemple : « Tout ce que j’ai, dans ma vie, ce sont mes couilles et ma parole. » Les mots, leur contenu et leur sonorité, sont déterminants dans la renaissance du film, lui offrant même un succès inespéré. D’abord, à la fin des années 1980, l’œuvre connaît une carrière retentissante en vidéo – les acheteurs se recrutent chez ceux qui n’ont pas osé aller en salle. Mais l’essentiel se passe au début des années 1990, avec un mouvement inattendu, qui va transformer Scarface en film culte.
Sur le tournage, Pacino est attaqué par un chien. En temps normal, il part en courant, mais là, il le frappe sur le museau pour l’assommer à coups de poing
La génération hip-hop, en pleine ascension, adopte le film avec un ensemble incroyable. Dans son premier album, Illmatic (1994), considéré comme un des plus importants de la décennie pour cette musique des mots, le rappeur américain Nas dit « The world is yours » (« le monde est à toi ») en référence au ballon dirigeable affichant cette phrase magique qu’observe, de son balcon, un Tony Montana au faîte de son pouvoir.
Sean Combs, alias « Puff Daddy », raconte avoir vu le film 63 fois « pour mieux apprendre la vie ». Le rappeur Snoop Dog s’impose encore à ce jour un visionnage de Scarface chaque mois : « Je pense, explique-t-il, que n’importe quel brother qui le regarde peut saisir ce que le personnage endure. » Le groupe pop punk californien Blink-182 tire son nom du nombre de fois où Tony Montana prononce le mot « fuck » dans le film.
Les années passant, Brian De Palma est frappé par le nombre d’acteurs qui, par la suite, singent le Pacino de Scarface : « Bruce Willis est excellent quand il imite Tony Montana, Tom Cruise se révèle même génial. C’est comme lorsqu’on imitait le Brando de Sur les quais. »
Sur le tournage, Pacino est attaqué par un chien. En temps normal, il part en courant, mais là, il le frappe sur le museau pour l’assommer à coups de poing. Avec sa chemise à fleurs, il n’est plus Pacino, il est Tony Montana, et il n’a peur de rien. Il se laisse aller. Depuis sa prestation, cette manière de se laisser aller est devenue une référence de l’art dramatique.
Al Pacino en six films cultes (3/6). Le tournage de ce film très cru de 1980 sur le milieu gay SM de New York, de William Friedkin, a beaucoup éprouvé l’acteur. Il lui offre pourtant un de ses rôles les plus emblématiques.
New York, 2 juillet 1979, 8 heures du matin. William Friedkin attend Al Pacino devant le palais de justice de New York, pour le premier jour du tournage de Cruising. Le réalisateur de French Connection (1971) et de L’Exorciste (1973) doit filmer dans un bureau où l’officier de police incarné par Al Pacino reçoit son ordre de mission pour s’infiltrer dans les boîtes gay sadomasochistes (SM), situées dans le Meatpacking District, le quartier des entrepôts de viande. Un tueur sévit dans ces clubs très privés et vise des victimes au physique comparable à celui du policier. Il servira d’appât.
A 10 heures, toujours pas de Pacino. Affolé, William Friedkin tente de lui téléphoner à son appartement, puis il appelle son agent. Sans succès. A se demander si l’acteur n’a pas décidé de se retirer du film sans en avertir quiconque.
En 1979, Al Pacino vient d’avoir 39 ans. Si on l’observe bien, les premiers signes de vieillissement sont là : des poches sous les yeux, une peau tuméfiée, deux rides verticales qui cadrent le nez. La dureté du visage est inédite. Cette sécheresse est d’autant plus frappante que tout au long de la décennie 1970, l’acteur est passé du statut de quasi-inconnu à celui de plus grand acteur du monde, après les succès du Parrain I et II, de Francis Ford Coppola (1972 et 1974), de Serpico (1973) et d’Un après-midi de chien (1975), de Sidney Lumet. A chaque fois, la jeunesse de Pacino a frappé les esprits.
Lorsque John Travolta, en 1977, dans La Fièvre du samedi soir, se coiffe en répétant des pas de danse, il a pour référence le portrait de Pacino barbu dans Serpico. C’est le signe qu’il est à la fois une icône de la culture populaire et un modèle pour les Italo-Américains. Avec la disparition de son allure juvénile, c’est une époque dont il faut se résoudre à tourner la page, précisément l’hédonisme des années disco dont La Fièvre du samedi soir constitue le document filmé par excellence.
Pacino a d’autant plus de mal à regarder dans le rétroviseur qu’il a vécu les années 1970 à la manière d’un ouragan, sans en garder vraiment des souvenirs. Du reste, il ne peut que constater son amnésie. « Il serait honnête de reconnaître que j’étais absent, estime Pacino dans un entretien au New Yorker, en 2014. Ces bouleversements se montraient impossibles à gérer, pour moi, pour n’importe qui en fait. »
Un comportement déjà erratique
L’alcool joue un rôle-clé dans cette mémoire versatile. Pacino ne se contente pas d’être un buveur invétéré, il s’en vante. « Laurence Olivier avait raison quand il disait que la meilleure chose, au théâtre, c’est le petit verre après le spectacle », confie-t-il en 1975.
Dix ans plus tard et alors qu’il a suivi une cure de désintoxication en 1977, il tient un discours autrement plus douloureux sur son addiction : « Petit à petit, j’ai compris ce que je pouvais devenir si je décidais d’arrêter. Alors, j’ai arrêté, lentement. Et les choses se sont éclaircies. Mais juste un peu… »
Ce jeudi 2 juillet 1979, vers 10 h 30, Pacino gare sa voiture devant le palais de justice de New York. L’acteur en sort tranquillement, prend William Friedkin dans ses bras, puis demande au réalisateur ce qui est prévu. Il devrait le savoir. Il est immergé depuis des mois dans les clubs gay SM. Mais son comportement, en marge du travail de fond auquel il s’oblige pour chaque film, et qui a fait sa réputation, se révèle déjà erratique.
« Pacino logeait dans un appartement d’East Manhattan, habité auparavant par Louis Malle et Candice Bergen, se souvient Friedkin. Le lieu restait intact, les photos du réalisateur français et de l’actrice américaine étaient toujours accrochées au mur. Seuls les habits de Pacino, jetés au sol, laissaient entendre qu’il habitait ici. On aurait cru un vagabond, mais Al vivait de cette manière. Il s’est mis ensuite à débarquer chez moi, au milieu de la nuit. Je lui disais de se faire un thé et un sandwich, puis je retournais me coucher. Quand je me levais, vers 6 heures, il n’avait pas bougé de la cuisine. Il n’avait pas bu de thé, car il ne savait pas en faire. Il n’avait pas non plus pris de sandwich, ne sachant pas non plus comment couper une tranche de pain. »
Plusieurs événements réels s’entremêlent, qui vont donner naissance à Cruising. En 1979, le magazine Village Voice, sous la plume d’Arthur Bell, le journaliste qui suit alors la communauté homosexuelle de New York, rend compte d’une série de morts inexpliquées dans ce milieu, mais aussi de meurtres commis dans le West Village, dans des clubs SM du Meatpacking District. Il n’existe pas encore de nom pour qualifier le sida.
Pour une raison inconnue, le nombre de décès des homosexuels s’accroît. Les meurtres se révèlent tout aussi mystérieux. Des morceaux de cadavre, jetés dans des sacs en plastique flottant sur l’Hudson River, sont retrouvés par la police qui les étiquette, faute de mieux, « CUPPI » – acronyme pour « affaire indéterminée, enquête de police en cours ».
« Tueur aux sacs-poubelles »
William Friedkin a déjà entendu parler des clubs SM par l’intermédiaire de Randy Jurgensen, un policier à la retraite qui a commencé à travailler avec lui sur French Connection, et auquel on avait confié la mission, dans les années 1960, de s’insérer dans ces clubs, pour retrouver un tueur. Un matin, en lisant le New York Daily News, Friedkin tombe sur un article évoquant l’arrestation de Paul Bateson, affublé du surnom de « tueur aux sacs-poubelle ». Ce dernier est accusé de plusieurs meurtres d’homosexuels, dont celui d’Addison Verrill, un journaliste de cinéma travaillant pour le quotidien professionnel Variety.
Le réalisateur s’arrête d’emblée sur la photo de Paul Bateson. Non seulement il connaît ce jeune homme, mais il l’a filmé. Il symbolise l’infirmier préparant l’artériographie de la jeune fille possédée de L’Exorciste, qui souffrirait d’un désordre cérébral. « Il portait des boucles d’oreilles et un bracelet de force, se souvient Friedkin, une manière de revendiquer sa sexualité, une chose rare en 1972. »
Le réalisateur obtient l’autorisation de rendre visite au meurtrier à la prison de Rikers Island, située sur l’East River. Paul Bateson accueille Friedkin avec joie, heureux d’apprendre que L’Exorciste a été un énorme succès au box-office. Puis il lui confie qu’il a tué plusieurs personnes. Combien ? Trois sans doute, mais certainement pas les huit ou neuf meurtres qu’on lui attribue. Il a rencontré Addison Verrill au Mineshaft, une « backroom » située sur Washington Street, en plein Greenwich Village, devenue, à son échelle et dans son registre, aussi réputée que le Studio 54, la boîte disco où le Tout-New York va danser.
Le Mineshaft est fréquenté par des stars et des inconnus. Parmi eux, Andy Warhol, Keith Haring, Michel Foucault, ou le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Après sa soirée au Mineshaft, Paul Bateson ramène chez lui Addison Verrill, il l’assomme avec une poêle à frire, puis le découpe en morceaux.
Rétif devant la moindre scène de sexe
William Friedkin est persuadé de tenir une histoire hors du commun. Il reste au réalisateur de L’Exorciste à découvrir, en compagnie de Randy Jurgensen, improvisé conseiller technique, les clubs SM : le Mineshaft bien entendu, mais aussi le Ramrod, l’Eagle’s Nest, l’Anvil.
« Je n’ai jamais vu un spectacle pareil, constate le réalisateur américain. Pour entrer au Mineshaft, il fallait monter un escalier étroit au bout duquel vous attendaient deux vigiles qui vérifiaient votre identité, car il s’agissait d’un club privé. Il a fallu nous déshabiller pour ne conserver que notre slip, nos chaussettes et nos chaussures. Certains membres portaient des masques en cuir. D’autres se contentaient d’une veste ou d’un gilet toujours en cuir. Les murs étaient peints en noir, avec des lampes à ultraviolets. Cela ressemblait à une cellule de prison, avec un donjon où des hommes avaient des relations orales et anales. Un mur où certains se faisaient fouetter. Une baignoire où un type se faisait pisser dessus. Juste à côté, un homme ligoté se faisait administrer un fist-fucking. Tous les fantasmes possibles se trouvaient satisfaits. »
Le Mineshaft et l’Anvil appartenaient à un certain Matty « le Cheval » Ianniello, un membre de la famille Genovese. La plupart des clubs et bars gay à cette époque restaient propriété de la Mafia. Iannello, un admirateur de French Connection, pour lequel Friedkin avait reçu l’Oscar du meilleur film en 1972, accorde au réalisateur les autorisations de tournage et sa protection, à la condition qu’il ne soit jamais fait mention dans le film des liens entre ces clubs et la Mafia.
L’acteur Pacino peut alors effectuer sa tournée dans les clubs. Pourquoi ce comédien, connu pour son extrême pudeur, rétif devant la moindre scène de sexe, a-t-il tout mis en œuvre, contactant lui-même William Friedkin, pour obtenir le rôle principal de Cruising ?
Un acteur qui, trois ans plus tôt, après avoir lu le scénario d’Un après-midi de chien, inspiré d’un fait divers authentique, où son personnage de malfaiteur attaque une banque pour financer l’opération permettant à son amant de changer de sexe, avait refusé de tourner une scène où il devait embrasser son partenaire sur la bouche.
Pacino avait proposé à la place, au réalisateur Sidney Lumet, de jouer cette scène au téléphone, pour qu’Un après-midi de chien devienne l’histoire de deux personnes qui s’aiment sans trouver le moyen de vivre ensemble. Une idée brillante, digne d’un acteur de génie, accueillie, comme il se doit, avec enthousiasme par Sidney Lumet.
Un film radical, à la frontière de la pornographie
Au moment d’Un après-midi de chien, après Le Parrain et Serpico, situés eux aussi à New York, Pacino incarne mieux qu’aucun autre acteur les tréfonds dans lesquels cette ville continue de sombrer après le départ de son maire John Lindsay et l’élection d’Ed Koch.
Mais, entre-temps, a surgi le chauffeur de taxi, vétéran du Vietnam, incarné par Robert De Niro, sillonnant les rues de New York dans Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, qui amène la folie destructrice du personnage à un niveau rarement atteint à l’écran.
Avec Cruising, c’est comme si Al Pacino, en pleine période punk, décide de prêter son visage et son corps à un stade supérieur de l’enfer new-yorkais. Aucune star n’a jamais accepté de tourner un film aussi radical, à la frontière de la pornographie. Et aucune ne s’y est risquée depuis.
Pacino est fou de joie de retrouver Randy Jurgensen, qu’il a côtoyé sur le tournage du Parrain. C’est avec lui qu’il s’apprête à découvrir les boîtes de nuit cuir. « La conversation restait pourtant à sens unique », se souvient Jurgensen. Ce dernier commence par lui expliquer la signification des couleurs des bandanas accrochés à la poche du jean des membres des clubs SM – ce qui donnera une des scènes emblématiques de Cruising.
« Friedkin expliquait à Pacino de quelle manière il se ferait toiser, caresser, harceler par les membres du club. Pacino ne mouftait pas. Il se nourrissait du spectacle, absorbait tout. Ce mec est une éponge », Randy Jurgensen, ancien policier
Après avoir passé sa première nuit dans un club SM, le personnage joué par Pacino veut en savoir plus, entre dans un magasin d’accessoires et demande le mode d’emploi des bandanas au vendeur : « Bleu dans la poche arrière gauche : tu cherches la pipe. Poche droite : c’est toi qui la fais. Vert, à gauche : tu fais la passe. A droite : tu es client. Jaune, à gauche : tu pisses sur ton mec. A droite : c’est l’inverse. »
L’explication terminée, Randy Jurgensen découvre un Pacino secouant la tête. « Après chaque épisode, il me répétait : “Tu as vraiment fait un truc pareil ?” Il m’assaillait littéralement de questions, dont l’une revenait sans cesse : “Tu es arrivé à tenir le coup ?” En fait, non. Je ne suis pas tombé malade durant cette mission, mais je me suis perdu. Ce truc m’a vrillé la tête. Là, Pacino était inquiet. Vous pouvez voir cela dans le film, dans la scène où il se regarde dans un miroir : il secoue la tête, et essaie de comprendre qui il est. »
L’étape des travaux pratiques, c’est-à-dire la fréquentation du Mineshaft et de l’Anvil, en compagnie de Randy Jurgensen et de William Friedkin, se révèle compliquée ; comment entrer dans ces clubs, en compagnie de la plus importante star du box-office américain, mais sans garde du corps ? « Friedkin, remarque Jurgensen, expliquait à Pacino comment il le dirigerait dans le film, de quelle manière il se ferait toiser, caresser, harceler par les membres du club. Pacino ne mouftait pas. Il gardait un visage figé. Ce n’est pas qu’il s’en foutait, mais il se nourrissait du spectacle, absorbait tout. Ce mec est une éponge. »
L’un des tournages les plus agités de l’histoire du cinéma
Le plus éprouvant pour Pacino a lieu moins à l’intérieur des clubs qu’à ciel ouvert, lorsque le tournage de Cruising, au milieu de la canicule de l’été 1979, devient l’un des plus agités de l’histoire du cinéma. Dans l’édition du 16 juillet du Village Voice, Arthur Bell, le même journaliste qui avait auparavant attiré l’attention de Friedkin sur la série de meurtres commis dans les clubs SM, signe un article dévastateur appelant à une croisade contre le film :
« Cruising s’annonce comme le film le plus accablant, insultant et sectaire jamais réalisé sur l’homosexualité. J’implore les lecteurs, gay, hétérosexuels, libéraux, radicaux, athées, communistes, peu importe, de rendre à Friedkin et à son équipe la vie impossible dès que vous les verrez tourner dans votre quartier. »
Des groupes homosexuels envoient des courriers au maire de New York, Ed Koch, lui demandant de retirer au film son autorisation de tournage. Sans succès. Suivent des menaces de mort, par courrier ou au téléphone.
La plupart des scènes, tournées de nuit, ont lieu pendant que des centaines de manifestants insultent comédiens et techniciens. Aux insultes succèdent des jets de pierres et de bouteilles ; que l’équipe du film, dont des membres des clubs SM, employés comme figurants, renvoient aux manifestants. Le sommet de la bataille urbaine est atteint le 26 juillet quand plusieurs milliers de manifestants défilent dans Greenwich Village en hurlant : « Cruising doit partir ! » La manifestation est brisée par la police montée de New York, dont toutes les forces sont mobilisées à cette occasion.
« Il y a une scène, note William Friedkin, dans laquelle Pacino marche seul la nuit dans Greenwich Village. Ça, c’est devant la caméra. Derrière, vous aviez des centaines de manifestants qui hurlaient : “Pacino, espèce de trou du cul, sale petite tapette, tu vas te faire enculer.” Il devait faire comme s’il n’y avait personne, mais vous lisez la peur sur son visage. » Le cinéaste ajoute : « Je ne suis pas dingue de sa performance dans le film, je n’arrive pas à me souvenir d’un jour où il est arrivé sur le plateau en connaissant son texte, mais il parvient admirablement à contenir ce sentiment de peur que le spectateur ressent à merveille. »
Pour oublier le bruit des manifestants, Pacino s’enferme entre deux prises dans sa loge et lit à voix haute à son maquilleur La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht.
Avec le recul, le tournage de Cruising peut apparaître comme le moment où la communauté homosexuelle américaine se remobilise et se soude, d’autant qu’elle vient de fêter le dixième anniversaire des émeutes de Stonewall, acte fondateur du militantisme LGBT. « Après tout, souligne Friedkin, cette communauté mobilisait ses efforts pour obtenir sa légitimité. Elle craignait que mon film, décrivant des pratiques sexuelles marginales, la ramène plusieurs années en arrière. Elle se trompait mais, aujourd’hui, je comprends ses craintes. »
[b]Le film échappe au classement X[/b]
A la fin d’un tournage tumultueux, Friedkin poursuit son chemin de croix. Il doit affronter la commission de classification. Le réalisateur a volontairement laissé durer les scènes de sexe crues et de meurtre, sachant qu’elles seraient coupées par la suite, si bien que Cruising échappe au classement X – label attribué aux films pornographiques – pour un classement R, une interdiction moins contraignante, autorisant une distribution dans toutes les salles.
Quand il découvre le film, Pacino est décontenancé. Selon le témoignage de Friedkin, l’acteur n’y comprend rien. Il demande, sans succès, un certain nombre de coupes et dit sa désapprobation devant l’évolution de son personnage qui se révèle aussi un meurtrier, ce qui n’était pas précisé dans le scénario. Pacino se désolidarise alors de Cruising. « C’est un film qu’Al m’a fait promettre de ne jamais regarder », confie Marthe Keller, qui devient sa compagne après avoir été avec lui à l’affiche de Bobby Deerfield (1977), de Sydney Pollack.
L’accueil critique du film est accablant. Arthur Bell, dans le Village Voice, le décrit comme « le regard le plus obscène et réactionnaire jamais porté sur l’homosexualité ». Variety, la bible du show-business, conclut ainsi sa critique : « Si ça c’est un film classé R, alors il ne restera dans le genre X que les films vraiment extrêmes. » La carrière commerciale de Cruising s’avère tout aussi désastreuse. C’est le premier échec cinglant de la carrière de Pacino.
Avec les années, le film honni jouira d’une réputation grandissante. Au point de devenir l’un des rôles emblématiques de Pacino et de s’imposer comme le témoignage d’un monde disparu. Alors que la restauration de Cruising est projetée au Festival de Cannes, en 2007, William Friedkin prend un café avec Quentin Tarantino, grand admirateur du film, et lui demande comment une œuvre aussi maudite a pu gagner une légitimité et une réputation : « Le film rappelle quelque chose pour toujours perdu, explique le réalisateur de Pulp Fiction. Un monde auquel les jeunes qui sont dans le SM n’ont plus accès en claquant des doigts, car le sida est passé par là. »
En 1979, Al Pacino devient le soleil noir d’une époque sur le point d’être gagnée par le cataclysme d’une épidémie. Mais il ne s’exprimera jamais sur ce film. Ni sur son tournage. Il prétend avoir tout oublié. Quarante ans après, il est bien le seul à ne pas vouloir s’en souvenir.
Al Pacino en six films cultes (4/6). En 1983, l’acteur ne se contente plus d’incarner un personnage. Il « est » Tony Montana, un effrayant trafiquant de cocaïne aux désirs incestueux.
Fin janvier 1982, Al Pacino dîne dans un restaurant new-yorkais avec Lee Strasberg. C’est un rituel. Chaque semaine, dans la mesure du possible, il retrouve son mentor à l’Actors Studio dans le même delicatessen. Quelques jours plus tard, son professeur meurt, à 80 ans, d’un infarctus. Ce dîner sera leur dernier rendez-vous.
Après la mort, en 1978, de l’acteur John Cazale, son partenaire dans Le Parrain, Le Parrain II, de Francis Ford Coppola et Un après-midi de chien, de Sidney Lumet, un frère symbolique, Pacino perd son père de substitution, lui qui n’a quasiment pas connu le sien. Il doit faire le deuil de sa famille d’adoption.
Pacino et Strasberg évoquent ce soir-là leur besoin de tourner ensemble, ce qui est la meilleure façon de ne jamais se quitter. Et pour l’acteur le moyen de continuer à écouter les conseils du maître. La première fois qu’ils sont ensemble à l’écran, c’est dans Le Parrain II, en 1974. Strasberg n’est alors plus apparu au cinéma depuis vingt-trois ans. Pacino l’impose pour incarner son ennemi juré dans le film, le gangster Hyman Roth.
Ils sont réunis à nouveau cinq ans plus tard dans Justice pour tous, de Norman Jewison, le premier film sans relief de la filmographie de Pacino, dans lequel il incarne un avocat luttant contre la corruption au sein du système judiciaire. Il a demandé que Strasberg y incarne son grand-père. Celui-ci, pensionnaire d’une maison de retraite, perd progressivement la mémoire, tout en conservant son autorité morale. La coiffure du maître apparaît plus ébouriffée que d’ordinaire. Différente de son allure de grand sage et de redoutable stratège dans le Parrain II.
Les cheveux exceptés, Strasberg ne change pas : une masse de fonte, imperméable au temps qui passe et aux idées arrêtées. En marge du tournage de Justice pour tous, il fait remarquer à Pacino qu’il ne partage pas son purisme dans l’approche des rôles. C’est l’époque où l’acteur n’apprend plus ses textes, préférant entrer d’abord dans la peau du personnage pour, soi-disant, trouver une manière plus spontanée de dire ses dialogues.
William Friedkin déplore la même chose sur le tournage de Cruising (1980). Pacino, tout en jouant, récite son texte griffonné sur des mémos scotchés sur les murs ou collés sur le front de ses partenaires. Cette manie, il l’emprunte à Brando, qui a pris cette fâcheuse habitude depuis longtemps. « Al, apprends ton putain de texte, lui répète Strasberg. Simplement ton texte. Tu verras, après, les choses te sembleront plus simples. »
Happé par le vide
Lors de leur dernier dîner, Strasberg décrit à Pacino ce que seront ses vingt prochaines années. Son idée consiste à enseigner jusqu’à l’âge de 100 ans. Mais se pose tout de même la question de la transmission. Le maître a formé Marlon Brando. James Dean. Puis Paul Newman. Pacino enfin. Qui ensuite ? Strasberg évoque la possibilité que l’acteur du Parrain lui succède à l’Actors Studio. Mais, au moment du café, troublé par l’excès d’intensité de son poulain, son obsession de tout analyser et décortiquer, sa tendance à expérimenter au-delà du raisonnable, le professeur lui lance : « Al, tu vas devoir apprendre à te laisser aller. »
Après la mort brutale de Lee Strasberg, Pacino est happé par le vide. Dix mois plus tard, en novembre 1982, il doit commencer à Miami le tournage de Scarface, avec le cinéaste Brian De Palma. Un remake du classique éponyme d’Howard Hawks, de 1932. Il n’a plus d’autre choix que de se préparer à se laisser aller. C’est son héritage, en forme d’injonction, alors que résonne la voix de son mentor.
Il doit se laisser aller, d’autant qu’il sort de trois échecs commerciaux au cinéma. Ce rôle va lui permettre de séduire à nouveau les foules. Scarface, il le veut et il le porte depuis longtemps. Il le porte depuis qu’il a joué au théâtre, à Boston en 1975, dans la pièce de Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui. Brecht a écrit en 1941 sa parodie de l’ascension d’Hitler au pouvoir en s’inspirant des films de gangsters américains, dont le plus célèbre est Scarface.
Al Pacino dans « Scarface », réalisé par Brian De Palma. Un film à la violence exacerbée, au langage ordurier, et à l’esthétique hors norme.
Pour incarner Arturo Ui, Pacino veut visionner le classique de Hawks, avec Paul Muni dans le rôle-titre du gangster, modelé sur Al Capone. Mais le propriétaire du film, le milliardaire Howard Hughes, bloque alors toute diffusion. Ce qui explique que les metteurs en scène du nouvel Hollywood, Brian De Palma et Martin Scorsese en tête, n’aient pu le découvrir qu’au début des années 1980.
En 1981, Pacino roule sur Sunset Boulevard, à Los Angeles, et passe devant un cinéma d’art et essai programmant Scarface. Il s’arrête et entre dans la salle. Il est surpris par la violence, inhabituelle dans les années 1930, du film de Hawks. Les gangsters se distinguent par leur analphabétisme, leur puérilité, par des attitudes primaires et bestiales, si peu héroïques. Pacino remarque aussi la référence aux Borgia pour dépeindre Capone et la jalousie incestueuse que lui inspire sa sœur.
Miami, plaque tournante de la drogue aux Etats-Unis
Pacino en est convaincu. Il y a matière à réaliser une nouvelle version du classique de Hawks. Il confie cette tâche à Marty Bregman, son ancien imprésario devenu producteur. Bregman se tourne naturellement vers Sidney Lumet, qui a tourné avec l’acteur Serpico (1973) et Un après-midi de chien (1975), deux de ses plus gros succès. Lumet ne veut pas un film rétro ou fidèle au modèle mais une option contemporaine. Et pour cela il faut un sujet, une actualité.
Au printemps 1980, le régime de Fidel Castro expulse 125 000 Cubains considérés comme contre-révolutionnaires. Baptisés « marielitos », car partis du port de Mariel, à 40 kilomètres de La Havane, ils débarquent sur les côtes de la Floride. Environ un cinquième d’entre eux sont des « indésirables » : libérés des prisons cubaines ou échappés d’hôpitaux psychiatriques, ils font partie du « colis » adressé par Fidel Castro au gouvernement des Etats-Unis. Lumet, frappé de voir à quelle vitesse Miami devient la plaque tournante de la drogue aux Etats-Unis, pense tenir la trame d’une nouvelle version de Scarface, dans laquelle le trafic de cocaïne remplacerait la Prohibition, alors que les gangsters cubains se substitueraient à la pègre italienne.
« La ville affichait une statistique étrange. Alors qu’elle n’est pas un centre industriel, elle était devenue la deuxième zone bancaire au monde. » Oliver Stone, scénariste du film
Le réalisateur confie l’écriture du scénario de Scarface au scénariste de Midnight Express (1978) et futur réalisateur de Platoon (1986) et de JFK (1991), Oliver Stone. Qui se penche sur le « cas » Miami. « La ville affichait une statistique étrange, raconte aujourd’hui Oliver Stone. Alors qu’elle n’est pas un centre industriel, elle était devenue la deuxième zone bancaire au monde. Je vais rencontrer le procureur général des Etats-Unis à Washington pour comprendre. Il m’explique que l’industrie de la cocaïne génère 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an. Je le corrige, pensant qu’il veut dire 100 millions de dollars. Il me répète : “100 milliards”. »
Le scénariste se rend ensuite en Bolivie, au Pérou et en Equateur afin de comprendre comment transite la cocaïne entre l’Amérique du Sud et la Floride. Stone rencontre la nuit des trafiquants de drogue à l’allure de playboys, bardés de chaînes en or. Il leur explique qu’il est scénariste et prépare un film.
« La nuit n’est sans doute pas le meilleur moment pour rencontrer ces énergumènes à l’humeur versatile, reconnaît-il. Ils sont capables, estimant avoir trop parlé, de vous loger une balle dans la tête. Un soir, je vais chez l’un d’eux pour boire un verre, sniffer et faire la fête. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai prononcé le nom d’un ancien avocat qui m’avait aidé à Miami pour mes recherches. Les mecs ont changé de couleur. Ce nom était celui d’un indic qu’ils recherchaient. Cela signifiait que je n’étais pas un scénariste, mais un agent infiltré. J’étais dans la merde. Avoir autant sniffé m’a permis de louvoyer. Mais vous n’imaginez pas comme j’ai eu peur. Cette peur, je l’avais ressentie au Vietnam. Et cette peur est l’essence de Scarface. »
Tuer est un art qu’il faut partager
C’est à Paris qu’Oliver Stone écrit son scénario. Pour garder les idées claires. Loin de New York ou de Los Angeles, où la cocaïne est plus accessible. Mais lorsqu’il remet son texte, le metteur en scène a changé. Sidney Lumet veut un film politique, il entend souligner les liens entre la CIA et les cartels sud-américains de la drogue dans la lutte anticommuniste.
Al Pacino, au contraire, veut un film focalisé sur le personnage principal, Tony Montana, le gangster cubain devenu le baron de la drogue. L’acteur privilégie une approche brechtienne, très théâtrale, de son personnage, avec lequel les spectateurs peuvent s’identifier tout en étant horrifiés par la violence de ses actes et de ses mots. « Tony Montana est toujours perçu comme bidimensionnel, précise alors Pacino. C’est le style du film. On ne cherche jamais à expliquer pourquoi il fait ce qu’il fait. »
Ce que veut Pacino rejoint la conviction de Brian De Palma : faire un film outré, à la violence exacerbée, au langage ordurier, à l’esthétique hors norme. Le metteur en scène de Carrie (1976) et de Blow Out (1981) opte pour des couleurs vives, criardes, vulgaires, dictées par l’ambiance du sud de la Floride, l’esprit tropical des gens et des lieux, le machisme latin aussi. Tony Montana conduit une Cadillac aux sièges recouverts d’un tissu simili-léopard, porte des chemises hawaïennes, avant d’ériger un palais tout stuc et rococo avec, au centre, une piscine en marbre.
Le film de gangsters est souvent en noir et blanc, les règlements de comptes ont pour théâtre des ruelles obscures animées par des hommes de main au costume sombre. Dans Scarface, les fusillades ont lieu en plein jour et opposent des tueurs le plus souvent habillés de blanc. Tuer est une parade, un art qu’il faut partager.
Les trafiquants de drogue cubains, remarque De Palma, ne se contentent pas de tuer leurs ennemis : ils les découpent en morceaux qu’ils déposent devant la poubelle d’une épicerie. Le réalisateur américain tient à mettre en valeur le rapport particulier, pathologique, paroxystique à la violence des gangs cubains, si différent de tout ce qui a pu être montré auparavant au cinéma – et que l’on retrouve dans la guerre de la drogue au Mexique, à partir des années 2000.
Pacino veut être Tony Montana
Pacino ne veut pas incarner, mais être Tony Montana. Il a un problème de langue. Le père du personnage est américain, sa mère cubaine, et son anglais, mal maîtrisé, reste un mélange de deux accents. Pacino effectue alors le pèlerinage à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, où réside Robert Easton, un ancien acteur de série B, désormais spécialiste des accents.
Pacino constate que la seule pièce de la maison de Robert Easton qui ne soit pas envahie de livres est la chambre à coucher. Le reste de l’espace est vampirisé par des ouvrages consacrés à tous les dialectes imaginables, du créole jamaïcain au chuukois, l’une des neuf langues parlées en Macron le big bossésie.
C’est donc sur le lit de son coach que Pacino perfectionne, des semaines durant, son accent en face de cet étrange individu aux cheveux longs et à la barbe blanche, qui ressemble davantage au Gandalf du Seigneur des anneaux qu’à un professeur d’université. La détermination de l’acteur ne surprend pas De Palma :
« Je le connaissais depuis le milieu des années 1960. Je sortais alors avec Jill Clayburgh, qui deviendrait ensuite sa petite amie. Il travaillait différemment des autres acteurs, très proche dans sa méthode de Dustin Hoffman, mais avec un travail préparatoire considérable et une intensité inhabituelle. »
De Palma poursuit : « Cet investissement m’apparaissait nécessaire pour composer un gangster cubain qui était aux antipodes de la personnalité et de la culture de Pacino. »
Après avoir maîtrisé son accent, Pacino passe plusieurs mois en compagnie de son acolyte dans Scarface, l’acteur d’origine cubaine Steven Bauer, qui incarne son bras droit et son compagnon d’exil. Les deux hommes ne se quittent pour ainsi dire jamais. Grace à Bauer, Pacino s’immerge dans le Miami cubain et n’échange qu’en espagnol avec lui.
Bauer est né à La Havane le 2 décembre 1956, le jour où Fidel Castro rentre clandestinement à Cuba en provenance du Mexique avec 80 exilés, dont Che Guevara, pour ensuite marcher vers le pouvoir. Le père de Steven Bauer, sceptique sur l’instauration du communisme dans l’île, choisit l’exil aux Etats-Unis et installe sa famille à Miami.
« Le destin des “marielitos” ne m’était pas étranger, raconte Steven Bauer, même si j’appartiens à la génération qui a gagné les Etats-Unis vingt ans plus tôt. Je les ai vus agir à Miami. Ils ont été pris en tenaille entre le pouvoir répressif communiste et le prétendu rêve américain. Cela a créé une tension impossible. J’ai vu Miami se dégrader en peu de temps. J’avais la trouille. Cette vague criminelle était épouvantable. »
« Quelque chose de complètement décadent dans son jeu »
La réalité des « marielitos », rejetés par leur pays et prêts à tout risquer dans un autre, indifférents à la mort en raison de leur marginalité absolue, voilà ce que doit faire ressentir Pacino. Il le fait sans limite. « Al m’intimidait, explique Oliver Stone. Il fallait quand même voir le spectacle durant les répétitions. Le mec mettait tout le monde mal à l’aise. Je l’ai vu transformer Tony Montana en bête sauvage. Il y avait quelque chose de complètement décadent dans son jeu. »
La première scène de « Scarface » est inoubliable. Rarement un personnage n’a été aussi bien introduit dans un film
Le regard de Pacino face à un trafiquant de drogue colombien, à l’occasion d’un deal qui tourne mal, alors que ce dernier sort une tronçonneuse pour le découper, fait partie des nombreux moments de sauvagerie du film.
Pacino a bien retenu l’ultime conseil de son mentor : se laisser aller. « C’est l’une des choses formidables quand on est acteur, explique alors Al Pacino au journaliste Lawrence Grobel. Tu es soudain capable de dire à quelqu’un qui est sur le point de te trancher la tête avec une tronçonneuse qu’il peut bien se la fourrer dans le cul. »
Tony Montana est le rôle préféré de Pacino à l’écran. Cela se voit d’emblée. Le début d’un film conditionne souvent la suite. La première scène de Scarface, avec Tony Montana en chemise à fleurs, maniant mensonges et calembours, hautain et blagueur, roulant des mécaniques face aux officiers américains de l’immigration, est inoubliable. Rarement un personnage n’a été aussi bien introduit dans un film.
« Al envahit l’écran avec son visage, constate Brian De Palma. Il faut toujours s’efforcer de présenter son personnage principal de manière spectaculaire. Le visage de Pacino, sa cicatrice – une partie sur la joue, sauf qu’elle déborde aussi sur son œil, une idée d’Al pour signifier sa sauvagerie –, sa manière unique de bouger, sont révélés en un seul gros plan. Son arrogance, son machisme latin exubérant s’imposent en une seconde. C’est ce qui s’appelle une star de cinéma. »
Combat contre la censure américaine
Une fois le tournage terminé, à Los Angeles et à Miami, un autre combat attend l’acteur et son cinéaste. Celui contre la censure américaine. Les censeurs sont décontenancés par la violence du film, en particulier par la séquence où, sous le regard hébété de Pacino, l’un de ses complices est découpé à la tronçonneuse dans une baignoire. De cette scène, on ne voit que le visage de Pacino aspergé de sang, quand la censure prétend qu’on voit aussi l’homme mis en pièces.
Plusieurs montages successifs sont proposés, pour alléger un peu le film, mais les censeurs maintiennent le classement « X ». La carrière commerciale de Scarface est compromise. De Palma, soutenu par Martin Scorsese, décide alors de plaider sa cause dans la presse, puis à nouveau devant la commission de censure. Il obtient le label « R », moins restrictif que le « X », ce qui permet aux moins de 17 ans de voir le film à condition d’être accompagnés par un adulte. C’est la première version de Scarface, la plus violente, qui est proposée au public.
Le film arrive sur les écrans en décembre 1983, et l’accueil critique et commercial est très mauvais. L’interprétation de Al Pacino, considérée comme outrée, est visée. Il y a une autre raison, politique. Dans les années 1970, l’opinion accepte, voire juge souhaitable, qu’il incarne le New York décadent, un pays vacillant entre le Vietnam, le Watergate et la crise économique. En revanche, elle accepte moins de le voir dénoncer les excès des années Reagan, et même de livrer une version dégénérée du rêve américain avec son libéralisme débridé. La phrase de Tony Montana : « le capitalisme, c’est enculer les gens » résume bien l’affaire.
Des phrases-chocs comme celle-ci, Pacino en balance par dizaines dans Scarface. Par exemple : « Tout ce que j’ai, dans ma vie, ce sont mes couilles et ma parole. » Les mots, leur contenu et leur sonorité, sont déterminants dans la renaissance du film, lui offrant même un succès inespéré. D’abord, à la fin des années 1980, l’œuvre connaît une carrière retentissante en vidéo – les acheteurs se recrutent chez ceux qui n’ont pas osé aller en salle. Mais l’essentiel se passe au début des années 1990, avec un mouvement inattendu, qui va transformer Scarface en film culte.
Sur le tournage, Pacino est attaqué par un chien. En temps normal, il part en courant, mais là, il le frappe sur le museau pour l’assommer à coups de poing
La génération hip-hop, en pleine ascension, adopte le film avec un ensemble incroyable. Dans son premier album, Illmatic (1994), considéré comme un des plus importants de la décennie pour cette musique des mots, le rappeur américain Nas dit « The world is yours » (« le monde est à toi ») en référence au ballon dirigeable affichant cette phrase magique qu’observe, de son balcon, un Tony Montana au faîte de son pouvoir.
Sean Combs, alias « Puff Daddy », raconte avoir vu le film 63 fois « pour mieux apprendre la vie ». Le rappeur Snoop Dog s’impose encore à ce jour un visionnage de Scarface chaque mois : « Je pense, explique-t-il, que n’importe quel brother qui le regarde peut saisir ce que le personnage endure. » Le groupe pop punk californien Blink-182 tire son nom du nombre de fois où Tony Montana prononce le mot « fuck » dans le film.
Les années passant, Brian De Palma est frappé par le nombre d’acteurs qui, par la suite, singent le Pacino de Scarface : « Bruce Willis est excellent quand il imite Tony Montana, Tom Cruise se révèle même génial. C’est comme lorsqu’on imitait le Brando de Sur les quais. »
Sur le tournage, Pacino est attaqué par un chien. En temps normal, il part en courant, mais là, il le frappe sur le museau pour l’assommer à coups de poing. Avec sa chemise à fleurs, il n’est plus Pacino, il est Tony Montana, et il n’a peur de rien. Il se laisse aller. Depuis sa prestation, cette manière de se laisser aller est devenue une référence de l’art dramatique.
Horrible.
Et j'aimais bien Almodovar mais ses deux derniers...je te la fait courte, c'est de la merde auteurisante, incroyablement chiant, ça ne raconte rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans mais il y a l'étiquette "Almodovar", alors le critique presse blasé fout un 5/5.
Horrible.
Dis-moi les autres choix que tu as, je vais te sauver vite fait ta soirée.
Et j'aimais bien Almodovar mais ses deux derniers...je te la fait courte, c'est de la merde auteurisante, incroyablement chiant, ça ne raconte rien, il n'y a pas de cinéma là-dedans mais il y a l'étiquette "Almodovar", alors le critique presse blasé fout un 5/5.
Horrible.
Dis-moi les autres choix que tu as, je vais te sauver vite fait ta soirée.
+1. J'ai dormi devant.
De toute façon c’est évident qu’Averell va détester. 
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
