Version complète : [SPOILERS] Star Wars Ep VII-VIII-IX
Forum de Culture PSG > Les forums du Bas : Parce que la communauté ne parle pas que de foot > Forum Sports et Loisirs
Super déçu du film, aucune originalité.
J'ai vu le film pour la seconde fois hier, hors frénésie du premier jour.
Toujours pas déçu perso, si ce n'est par son côté "grosse intro" plus que film qui se tient seul. Ca et quelques ficelles un peu grosses comme R2 qui se réveille au bon moment sans plus d'explication que ça. Il suffisait de 5-10min de plus au global pour rendre ça moins facile et c'est dommage.
Le film représente globalement mes attentes. Il garde les défauts de narration qu'on pu avoir quasi tous les épisodes, mais je n'ai pas moins de raison de les tolérer ici que sur les anciens. Je pense d'ailleurs préférer cet épisode à l'épisode VI, même si ce dernier conserve l'attrait de la plus belle bataille spatiale de la saga.
Revoir le film m'a aussi permis de remettre en perspective deux-trois points que j'avais un peu loupé/pris de travers la première fois du type :
- Han Solo dit explicitement à Finn que sa présence n'est pas due au hasard et que lui et Chewie traçaient le Faucon depuis un moment. Certes on peut dire que c'est un peu grossier que ça tombe pile poil à ce moment là, mais ça casse aussi un peu l'idée que tout n'est dû qu'au hasard.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
- Rey est loin de dominer le combat final autant qu'on veut bien le dire. Elle ne fait que reculer pendant 90% du combat et ne réagit face à un Kylo Ren déjà bien handicapé (par Chewbacca au laser et par Finn au sabre) que lorsque ce dernier lui parle de la Force. Le seul moment vraiment too much du combat d'ailleurs, lorsqu'elle prend le temps de fermer les yeux 10sec pour se concentrer alors qu'elle est à moitié dans le vide. Kylo peut l'achever à ce moment-là, mais vu son propos du moment, on peut penser qu'il espère l'amener du côté obscur plutôt que l'achever. Sans l'apport de la Force, elle ne fait en tout cas pas long feu.
En dehors de ça, elle montre déjà un minimum de capacités au combat en début de film. Puis j'ai vraiment tendance à penser que Rey a aussi un début de formation dans son enfance mais qu'elle a été stoppée après que Kylo ait tout sabordé, les padawans étant alors dispersés dans la galaxie pour les protéger et éviter de nouveaux débordements. Mais bon là c'est de l'extrapolation plus qu'autre chose mais d'autant plus crédible si c'est une descendante de la famille Skywalker.
Et on voit aussi que les Stormtroopers sont entraînés au combat rapproché avec leur espèce de tonfa électrique. Donc Finn sait aussi un minimum manier ce genre d'engin, ou du moins a les réflexes de défense adéquat.
- la musique de la première apparition de Snoke est effectivement celle de la scène de l'opéra dans l'épisode III. Ce qui va dans le sens qu'il s'agit bien de Darth Plagueis. Mais cela dit on ré-entend quelques notes plus tard dans le film de ce même thème je crois alors qu'il n'y a que Rey à l'écran.
- les visions au moment de la découverte du sabre prennent un autre sens lorsqu'on entend distinctement les voix de Yoda, Obi-Wan (version McGregor et un mot d'Alec Guinness) et même celle de Mark Hamill. On comprend donc que ce n'est pas tant le sabre qui appelle Rey que les Jedis qui tentent d'entrer en contact avec elle via la Force.
Lors de mon premier visionnage, je n'ai pas tellement fait attention aux voix et pensait du coup que c'était la Force qui parlait à travers le sabre ou un truc du genre.
Bref, ça n'empêche pas le film d'avoir certains défauts et je comprends qu'il puisse décevoir certains par son manque d'originalité au global, mais pour moi c'est une remise en place réussie. Et qui a de bonnes chances de bénéficier de la suite par les multiples pistes qu'elle ouvre.
Toujours pas déçu perso, si ce n'est par son côté "grosse intro" plus que film qui se tient seul. Ca et quelques ficelles un peu grosses comme R2 qui se réveille au bon moment sans plus d'explication que ça. Il suffisait de 5-10min de plus au global pour rendre ça moins facile et c'est dommage.
Le film représente globalement mes attentes. Il garde les défauts de narration qu'on pu avoir quasi tous les épisodes, mais je n'ai pas moins de raison de les tolérer ici que sur les anciens. Je pense d'ailleurs préférer cet épisode à l'épisode VI, même si ce dernier conserve l'attrait de la plus belle bataille spatiale de la saga.
Revoir le film m'a aussi permis de remettre en perspective deux-trois points que j'avais un peu loupé/pris de travers la première fois du type :
- Han Solo dit explicitement à Finn que sa présence n'est pas due au hasard et que lui et Chewie traçaient le Faucon depuis un moment. Certes on peut dire que c'est un peu grossier que ça tombe pile poil à ce moment là, mais ça casse aussi un peu l'idée que tout n'est dû qu'au hasard.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
- Rey est loin de dominer le combat final autant qu'on veut bien le dire. Elle ne fait que reculer pendant 90% du combat et ne réagit face à un Kylo Ren déjà bien handicapé (par Chewbacca au laser et par Finn au sabre) que lorsque ce dernier lui parle de la Force. Le seul moment vraiment too much du combat d'ailleurs, lorsqu'elle prend le temps de fermer les yeux 10sec pour se concentrer alors qu'elle est à moitié dans le vide. Kylo peut l'achever à ce moment-là, mais vu son propos du moment, on peut penser qu'il espère l'amener du côté obscur plutôt que l'achever. Sans l'apport de la Force, elle ne fait en tout cas pas long feu.
En dehors de ça, elle montre déjà un minimum de capacités au combat en début de film. Puis j'ai vraiment tendance à penser que Rey a aussi un début de formation dans son enfance mais qu'elle a été stoppée après que Kylo ait tout sabordé, les padawans étant alors dispersés dans la galaxie pour les protéger et éviter de nouveaux débordements. Mais bon là c'est de l'extrapolation plus qu'autre chose mais d'autant plus crédible si c'est une descendante de la famille Skywalker.
Et on voit aussi que les Stormtroopers sont entraînés au combat rapproché avec leur espèce de tonfa électrique. Donc Finn sait aussi un minimum manier ce genre d'engin, ou du moins a les réflexes de défense adéquat.
- la musique de la première apparition de Snoke est effectivement celle de la scène de l'opéra dans l'épisode III. Ce qui va dans le sens qu'il s'agit bien de Darth Plagueis. Mais cela dit on ré-entend quelques notes plus tard dans le film de ce même thème je crois alors qu'il n'y a que Rey à l'écran.
- les visions au moment de la découverte du sabre prennent un autre sens lorsqu'on entend distinctement les voix de Yoda, Obi-Wan (version McGregor et un mot d'Alec Guinness) et même celle de Mark Hamill. On comprend donc que ce n'est pas tant le sabre qui appelle Rey que les Jedis qui tentent d'entrer en contact avec elle via la Force.
Lors de mon premier visionnage, je n'ai pas tellement fait attention aux voix et pensait du coup que c'était la Force qui parlait à travers le sabre ou un truc du genre.
Bref, ça n'empêche pas le film d'avoir certains défauts et je comprends qu'il puisse décevoir certains par son manque d'originalité au global, mais pour moi c'est une remise en place réussie. Et qui a de bonnes chances de bénéficier de la suite par les multiples pistes qu'elle ouvre.
J'ai vu le film pour la seconde fois hier, hors frénésie du premier jour.
Toujours pas déçu perso, si ce n'est par son côté "grosse intro" plus que film qui se tient seul. Ca et quelques ficelles un peu grosses comme R2 qui se réveille au bon moment sans plus d'explication que ça. Il suffisait de 5-10min de plus au global pour rendre ça moins facile et c'est dommage.
Le film représente globalement mes attentes. Il garde les défauts de narration qu'on pu avoir quasi tous les épisodes, mais je n'ai pas moins de raison de les tolérer ici que sur les anciens. Je pense d'ailleurs préférer cet épisode à l'épisode VI, même si ce dernier conserve l'attrait de la plus belle bataille spatiale de la saga.
Revoir le film m'a aussi permis de remettre en perspective deux-trois points que j'avais un peu loupé/pris de travers la première fois du type :
- Han Solo dit explicitement à Finn que sa présence n'est pas due au hasard et que lui et Chewie traçaient le Faucon depuis un moment. Certes on peut dire que c'est un peu grossier que ça tombe pile poil à ce moment là, mais ça casse aussi un peu l'idée que tout n'est dû qu'au hasard.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
- Rey est loin de dominer le combat final autant qu'on veut bien le dire. Elle ne fait que reculer pendant 90% du combat et ne réagit face à un Kylo Ren déjà bien handicapé (par Chewbacca au laser et par Finn au sabre) que lorsque ce dernier lui parle de la Force. Le seul moment vraiment too much du combat d'ailleurs, lorsqu'elle prend le temps de fermer les yeux 10sec pour se concentrer alors qu'elle est à moitié dans le vide. Kylo peut l'achever à ce moment-là, mais vu son propos du moment, on peut penser qu'il espère l'amener du côté obscur plutôt que l'achever. Sans l'apport de la Force, elle ne fait en tout cas pas long feu.
En dehors de ça, elle montre déjà un minimum de capacités au combat en début de film. Puis j'ai vraiment tendance à penser que Rey a aussi un début de formation dans son enfance mais qu'elle a été stoppée après que Kylo ait tout sabordé, les padawans étant alors dispersés dans la galaxie pour les protéger et éviter de nouveaux débordements. Mais bon là c'est de l'extrapolation plus qu'autre chose mais d'autant plus crédible si c'est une descendante de la famille Skywalker.
Et on voit aussi que les Stormtroopers sont entraînés au combat rapproché avec leur espèce de tonfa électrique. Donc Finn sait aussi un minimum manier ce genre d'engin, ou du moins a les réflexes de défense adéquat.
- la musique de la première apparition de Snoke est effectivement celle de la scène de l'opéra dans l'épisode III. Ce qui va dans le sens qu'il s'agit bien de Darth Plagueis. Mais cela dit on ré-entend quelques notes plus tard dans le film de ce même thème je crois alors qu'il n'y a que Rey à l'écran.
- les visions au moment de la découverte du sabre prennent un autre sens lorsqu'on entend distinctement les voix de Yoda, Obi-Wan (version McGregor et un mot d'Alec Guinness) et même celle de Mark Hamill. On comprend donc que ce n'est pas tant le sabre qui appelle Rey que les Jedis qui tentent d'entrer en contact avec elle via la Force.
Lors de mon premier visionnage, je n'ai pas tellement fait attention aux voix et pensait du coup que c'était la Force qui parlait à travers le sabre ou un truc du genre.
Bref, ça n'empêche pas le film d'avoir certains défauts et je comprends qu'il puisse décevoir certains par son manque d'originalité au global, mais pour moi c'est une remise en place réussie. Et qui a de bonnes chances de bénéficier de la suite par les multiples pistes qu'elle ouvre.
Toujours pas déçu perso, si ce n'est par son côté "grosse intro" plus que film qui se tient seul. Ca et quelques ficelles un peu grosses comme R2 qui se réveille au bon moment sans plus d'explication que ça. Il suffisait de 5-10min de plus au global pour rendre ça moins facile et c'est dommage.
Le film représente globalement mes attentes. Il garde les défauts de narration qu'on pu avoir quasi tous les épisodes, mais je n'ai pas moins de raison de les tolérer ici que sur les anciens. Je pense d'ailleurs préférer cet épisode à l'épisode VI, même si ce dernier conserve l'attrait de la plus belle bataille spatiale de la saga.
Revoir le film m'a aussi permis de remettre en perspective deux-trois points que j'avais un peu loupé/pris de travers la première fois du type :
- Han Solo dit explicitement à Finn que sa présence n'est pas due au hasard et que lui et Chewie traçaient le Faucon depuis un moment. Certes on peut dire que c'est un peu grossier que ça tombe pile poil à ce moment là, mais ça casse aussi un peu l'idée que tout n'est dû qu'au hasard.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
- Rey est loin de dominer le combat final autant qu'on veut bien le dire. Elle ne fait que reculer pendant 90% du combat et ne réagit face à un Kylo Ren déjà bien handicapé (par Chewbacca au laser et par Finn au sabre) que lorsque ce dernier lui parle de la Force. Le seul moment vraiment too much du combat d'ailleurs, lorsqu'elle prend le temps de fermer les yeux 10sec pour se concentrer alors qu'elle est à moitié dans le vide. Kylo peut l'achever à ce moment-là, mais vu son propos du moment, on peut penser qu'il espère l'amener du côté obscur plutôt que l'achever. Sans l'apport de la Force, elle ne fait en tout cas pas long feu.
En dehors de ça, elle montre déjà un minimum de capacités au combat en début de film. Puis j'ai vraiment tendance à penser que Rey a aussi un début de formation dans son enfance mais qu'elle a été stoppée après que Kylo ait tout sabordé, les padawans étant alors dispersés dans la galaxie pour les protéger et éviter de nouveaux débordements. Mais bon là c'est de l'extrapolation plus qu'autre chose mais d'autant plus crédible si c'est une descendante de la famille Skywalker.
Et on voit aussi que les Stormtroopers sont entraînés au combat rapproché avec leur espèce de tonfa électrique. Donc Finn sait aussi un minimum manier ce genre d'engin, ou du moins a les réflexes de défense adéquat.
- la musique de la première apparition de Snoke est effectivement celle de la scène de l'opéra dans l'épisode III. Ce qui va dans le sens qu'il s'agit bien de Darth Plagueis. Mais cela dit on ré-entend quelques notes plus tard dans le film de ce même thème je crois alors qu'il n'y a que Rey à l'écran.
- les visions au moment de la découverte du sabre prennent un autre sens lorsqu'on entend distinctement les voix de Yoda, Obi-Wan (version McGregor et un mot d'Alec Guinness) et même celle de Mark Hamill. On comprend donc que ce n'est pas tant le sabre qui appelle Rey que les Jedis qui tentent d'entrer en contact avec elle via la Force.
Lors de mon premier visionnage, je n'ai pas tellement fait attention aux voix et pensait du coup que c'était la Force qui parlait à travers le sabre ou un truc du genre.
Bref, ça n'empêche pas le film d'avoir certains défauts et je comprends qu'il puisse décevoir certains par son manque d'originalité au global, mais pour moi c'est une remise en place réussie. Et qui a de bonnes chances de bénéficier de la suite par les multiples pistes qu'elle ouvre.
Par rapport à ça, on m'a parlé d'une théorie : Rey pourrait être une descente de... Palpatine. J'ai lu quelques trucs dessus ensuite sur internet et ça parle d'un style de combat très similaire entre les deux.
Par rapport à ça, on m'a parlé d'une théorie : Rey pourrait être une descente de... Palpatine. J'ai lu quelques trucs dessus ensuite sur internet et ça parle d'un style de combat très similaire entre les deux.
Et en même son véritable thème est quand même super proche de celui de Luke.
De toute façon les pistes sont sûrement volontairement un peu brouillées concernant sa paternité.
La majeure partie des points laisse penser qu'elle est la fille de Luke. Mais on peut tout aussi bien penser que sa faculté à canaliser rapidement la Force en fait une "élue" comme l'était Anakin. Et l'étreinte finale avec Leïa peut aussi laisser penser que Rey et Kylo sont frères et sœur.
- Han Solo dit explicitement à Finn que sa présence n'est pas due au hasard et que lui et Chewie traçaient le Faucon depuis un moment. Certes on peut dire que c'est un peu grossier que ça tombe pile poil à ce moment là, mais ça casse aussi un peu l'idée que tout n'est dû qu'au hasard.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
En réalité il n'y en a pas beaucoup plus que dans l'épisode IV où et R2 qui tombe chez Luke Skywalker par un concours de circonstance encore plus improbable qu'ici ou Qui Gon qui entre forcément du premier coup dans le magasin de pièces détachées où travaille Anakin et croise ensuite par hasard Jar-Jar qui apportera indirectement l'armée nécessaire à la République pour contrer les droïdes de la Fédération.
Là grande différence dans cet épisode sur la gestion du hasard, c'est que t'as pas de jedi pour faire un laïus sur la force et le hasard qui n'existe pas. Autrement c'est pareil.
- la musique de la première apparition de Snoke est effectivement celle de la scène de l'opéra dans l'épisode III. Ce qui va dans le sens qu'il s'agit bien de Darth Plagueis. Mais cela dit on ré-entend quelques notes plus tard dans le film de ce même thème je crois alors qu'il n'y a que Rey à l'écran.
Pas forcément étonnant. Je suis en train de les revoir là, et dans le II pendant les premières phases de la transformation d'Anakin, t'as plusieurs fois la marche de l'empereur même s'il n'est pas à l'écran.
Je pense que derrière l'idée c'est que le plan et/ou la transformation est en cours même si le personnage directement impliqué n'apparaît pas à l'écran.
Mais globalement d'accord avec toi. Ma seule petite déception c'est que ça manque un peu de prise de risque, mais pour un retour après 10 ans et le premier de l'ère Disney ça aurait été compliqué.
Mais globalement d'accord avec toi. Ma seule petite déception c'est que ça manque un peu de prise de risque, mais pour un retour après 10 ans et le premier de l'ère Disney ça aurait été compliqué.
Voilà pour moi c'est à partir du prochain qu'ils peuvent et doivent vraiment se démarquer. Là, le film est trop tiraillé entre le fait de devoir faire plaisir aux fans de la première heure et la présentation d'une nouvelle génération susceptible de séduire les plus jeunes qui n'ont pas grandi avec Star Wars.
S'ils avaient choisi de faire fi du fan service, des anciens et de partir sur un truc vraiment neuf d'emblée, on leur aurait sans doute reprocher de dénaturer voire tuer la saga. Le curseur n'est vraiment pas simple à positionner et en ce sens une variation (plutôt que remake) de l'histoire originale parait être un choix logique, même si je comprends qu'elle puisse déranger.
Le schéma global était d'ailleurs le même pour l'épisode I déjà. Juste à la place de l'Etoile Noire, il y avait une base plus petite à éliminer. Lucas avait par contre un peu plus fait évoluer la forme donc ça gênait moins (sur cet aspect précis parce que l'épisode a déplu sur plein d'autres points).
Aujourd'hui ils se mettent suffisamment de fans dans la poche après ce premier film pour pouvoir se permettre plus de choses dans les suites. Maintenant il faut qu'ils le fassent. Ca reste à voir.
j'ai vu ça hier, content de voir que ça reste une histoire de famille sur fond de parricide.
Vu aujourd'hui et comme prévu c'est du fan boy service et de l'introduction de personnage.
Comme tout le monde, je trouve que Kylo Ren fait franchement de la peine tellement il est mauvais et la présence d'Han Solo c'est juste pour dire au gens qui arrivent pas à suivre "c'est mon fils hein! Moi je suis le père lui c'est le fils, ok ? compris?" et paf the end
La meilleure scène du film reste tout de même cela:
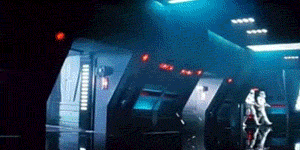
Après, personnellement, je ne suis pas sortie spécialement déçu du cinéma, à part Kylo Ren qu'on nous a teasé comme le gros méchant et qui a finalement le mental de Yoann Gourcuff, j'ai eu ce dont je m'attendais en espèrant rentrer pour de bon dans l'histoire à l'épisode VIII
Comme tout le monde, je trouve que Kylo Ren fait franchement de la peine tellement il est mauvais et la présence d'Han Solo c'est juste pour dire au gens qui arrivent pas à suivre "c'est mon fils hein! Moi je suis le père lui c'est le fils, ok ? compris?" et paf the end
La meilleure scène du film reste tout de même cela:
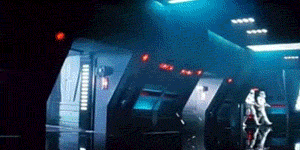
Après, personnellement, je ne suis pas sortie spécialement déçu du cinéma, à part Kylo Ren qu'on nous a teasé comme le gros méchant et qui a finalement le mental de Yoann Gourcuff, j'ai eu ce dont je m'attendais en espèrant rentrer pour de bon dans l'histoire à l'épisode VIII
En même temps quand ils ont fait original lors de La Menace Fantôme, ca a gueulé alors qu'il est juste trois niveaux au dessus de la trilogie originale.
J'ai revu la menace fantôme, c'est 15 crans au dessus. 100% innovation, beaucoup plus de cohérence.
Le giff au dessus résume à lui seul le film, film pour ado à la hunger game.
Obligé d'inventer des histoires/théories sur des liens de famille pour justifier l'absence totale de scénario du film.
Sinon en parlant de musique, la musique à 1min20 on la retrouve ou? je trouve que des extraits dans des musiques bidons, alors que c'est la meilleure.
J'ai revu la menace fantôme, c'est 15 crans au dessus. 100% innovation, beaucoup plus de cohérence.
Le giff au dessus résume à lui seul le film, film pour ado à la hunger game.
Obligé d'inventer des histoires/théories sur des liens de famille pour justifier l'absence totale de scénario du film.
Sinon en parlant de musique, la musique à 1min20 on la retrouve ou? je trouve que des extraits dans des musiques bidons, alors que c'est la meilleure.
Le giff au dessus résume à lui seul le film, film pour ado à la hunger game.
Obligé d'inventer des histoires/théories sur des liens de famille pour justifier l'absence totale de scénario du film.
Sinon en parlant de musique, la musique à 1min20 on la retrouve ou? je trouve que des extraits dans des musiques bidons, alors que c'est la meilleure.
L'humour c'est pour ado ?
Tu découvres Star Wars ou quoi ? L'humour y est présent depuis le tout premier film en 77.
Concernant les théories, tu découvres le cinéma ou les sagas ? Y'a toujours eu des théories sur tout (et pas qu'au cinéma), rien à voir avec une soit disante absence de scénario.
Sinon La Menace Fantôme 15 cran au dessus de la trilogie originale... No comment.
Menace fantôme 15 crans au dessus du 7.
Film pour ado.
Film pour ado.
Film pour ado.
C'est vrai que La Menace Fantôme était vachement plus adulte avec Jar-Jar, ses potes Gungans qui jouent à la guerre et Anakin qui déboîte tout le monde à la course de pod du haut de ses 9 ans.
L'Attaque des Clones n'était pas non plus ado du tout avec son amourette à deux balles et les crises d'hystérie sans raison d'Anakin.
Sans parler de l'épisode VI où les stormtroopers se font latter par des peluches.
C'est juste la tonalité habituelle de la saga, l'épisode V faisant un peu office d'exception. Et encore...
Après, c'est sûr que le film ne s'adresse plus tout à fait aux mêmes jeunes qu'il y a 40 ans, mais encore heureux.
L'âge qu'on a change concrètement la façon dont on apprécie un film.
Au delà du fait que dans le 1, on a quelque chose de neuf, d'innovant... C'est surtout les méchants qui ont bien plus de classe que ceux qu'on a dans le 7 (pas dur tu me diras...). Maul, il a vraiment quelque chose, Palpatine aussi. Snoke et Kylo, nada. Que dalle.
Puis bon, faut aussi souligner le fait que c'est encore un film où ils doivent détruire une étoile de la mort, certes plus grosses, mais avec les mêmes armes et quasiment de la même manière. C'est barbant.
Au delà du fait que dans le 1, on a quelque chose de neuf, d'innovant... C'est surtout les méchants qui ont bien plus de classe que ceux qu'on a dans le 7 (pas dur tu me diras...). Maul, il a vraiment quelque chose, Palpatine aussi. Snoke et Kylo, nada. Que dalle.
Puis bon, faut aussi souligner le fait que c'est encore un film où ils doivent détruire une étoile de la mort, certes plus grosses, mais avec les mêmes armes et quasiment de la même manière. C'est barbant.
La question des méchants est vraiment importante.
Dans le 7, ils sont ridicules. Tu ne fais pas un film réussi avec des méchants ridicules.
Et pourtant, ça commence bien. La première scène de Kylo Ren dans le village, je le trouve franchement impressionnant, sa voix, ses pouvoirs.
Par contre, il enlève son masque, c'est l'idée la plus débile de la saga, loin devant Jar Jar.
Dans le 7, ils sont ridicules. Tu ne fais pas un film réussi avec des méchants ridicules.
Et pourtant, ça commence bien. La première scène de Kylo Ren dans le village, je le trouve franchement impressionnant, sa voix, ses pouvoirs.
Par contre, il enlève son masque, c'est l'idée la plus débile de la saga, loin devant Jar Jar.
Oui Kylo Ren en tant que tel est pas ridicule, c'est le fait d'avoir viré son masque qui l'est. Tout comme Vador aurait largement perdu de sa classe dans la trilogie s'il avait retiré son casque. Après, Anakin était énormément critiqué pour des raisons similaires et avait fini par faire un méchant crédible dans l'épisode 3, donc patience.
Après, ici comme ailleurs je vois quand même pas mal de réactions en mode vieux con, des fans de la première heure qui s'attendaient à ce que la magie soit la même qu'il y a 20 ou 30 ans... compréhensible mais ça n'avait quasiment aucune chance de se produire.
Après, ici comme ailleurs je vois quand même pas mal de réactions en mode vieux con, des fans de la première heure qui s'attendaient à ce que la magie soit la même qu'il y a 20 ou 30 ans... compréhensible mais ça n'avait quasiment aucune chance de se produire.
Je trouve que Kylo est une des réussites du film. Le mec n'est pas un grand méchant bad ass et débile, il a ses questionnements, sa fragilité et un grand potentiel pour la suite je trouve. D'un côté ou de l'autre de la Force.
Petite question pour ceux qui ont détesté Kylo Ren : vous avez vu le film en VF ? Parce que l'un des aspects les plus intéressants de cet acteur, depuis la première que je l'avais vu y'a quelques années dans Girls, c'est sa voix hyper grave et profonde qui lui donne toute sa singularité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il faisait un très bon successeur à Vader.
Il y a des choses que je trouve ridicules dans le personnage de Kylo Ren, notament quand il tape sa crise d'ado et se met à tout casser avec son sabre laser, mais en même temps ça reste très Star Wars (les cacas nerveux de Luke contre son oncle et sa tante dans le premier Star Wars avec la voix qui part dans les aigus, Anakin qui joue son rebelle amoureux dans le prequel...).
Il y a des choses que je trouve ridicules dans le personnage de Kylo Ren, notament quand il tape sa crise d'ado et se met à tout casser avec son sabre laser, mais en même temps ça reste très Star Wars (les cacas nerveux de Luke contre son oncle et sa tante dans le premier Star Wars avec la voix qui part dans les aigus, Anakin qui joue son rebelle amoureux dans le prequel...).
Je trouve que Kylo est une des réussites du film. Le mec n'est pas un grand méchant bad ass et débile, il a ses questionnements, sa fragilité et un grand potentiel pour la suite je trouve. D'un côté ou de l'autre de la Force.
D'ailleurs on reproche beaucoup (à raison) à l'épisode 7 d'être très largement inspiré du 4, mais ils ont aussi pioché assez allègrement dans les bouquins non ? Je sais plus lequel exactement vu la quantité qu'il y a, mais il me semble qu'un pan énorme de l'univers étendu portait sur Jacen Solo, fils de, qui basculait lui aussi du côté obscur.

Petite question pour ceux qui ont détesté Kylo Ren : vous avez vu le film en VF ? Parce que l'un des aspects les plus intéressants de cet acteur, depuis la première que je l'avais vu y'a quelques années dans Girls, c'est sa voix hyper grave et profonde qui lui donne toute sa singularité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il faisait un très bon successeur à Vader.
Il y a des choses que je trouve ridicules dans le personnage de Kylo Ren, notament quand il tape sa crise d'ado et se met à tout casser avec son sabre laser, mais en même temps ça reste très Star Wars (les cacas nerveux de Luke contre son oncle et sa tante dans le premier Star Wars avec la voix qui part dans les aigus, Anakin qui joue son rebelle amoureux dans le prequel...).
Il y a des choses que je trouve ridicules dans le personnage de Kylo Ren, notament quand il tape sa crise d'ado et se met à tout casser avec son sabre laser, mais en même temps ça reste très Star Wars (les cacas nerveux de Luke contre son oncle et sa tante dans le premier Star Wars avec la voix qui part dans les aigus, Anakin qui joue son rebelle amoureux dans le prequel...).
Oui mais faut un minimum de cohérence.
Un film, c'est deux heures, un méchant peut pas être à la fois impressionnant et réussi et de l'autre puéril et sans nuance. Moi ça me gêne, c'est comme si dans Seven, on voyait Kevin Spacey expliqué en se faisant arrêter qu'il avait été victime de violence et de maltraitance plus jeune...On s'en balance, faut garder une part d'ombre, faire fonctionner l'imagination du spectateur.
C'est un gâchis terrible ce personnage pour moi. Sinon, oui, sa voix est un gros point fort, mais le physique...Cette tête de grand ado falot...
Je trouve que Kylo est une des réussites du film. Le mec n'est pas un grand méchant bad ass et débile, il a ses questionnements, sa fragilité et un grand potentiel pour la suite je trouve. D'un côté ou de l'autre de la Force.
Pareil moi je trouve juste justement que l'intérêt de Kylo Ren arrive lorsqu'il retire son masque.
Il l'aurait gardé tout du long, il serait resté à tout jamais un sous Darth Vader sans possibilité d'évoluer et le masque ne serait resté qu'un simple artifice allant en ce sens.
Alors que là on sent certes un vilain encore psychologiquement en rodage (et encore pas dit qu'il reste tout le temps du mauvais côté), mais il va apporter quelque chose de neuf à la saga avec son côté miroir d'Anakin voire Luke.
Puis j'aime bien Adam Driver à la base, même s'il était sûr que le fait que ce ne soit pas spécialement un beau gosse allait faire réagir au moment où il vire le masque.
Puis faut pas oublier non plus que prendre la suite de Vader et Palpatine, soit deux des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, n'a rien de simple. Faut laisser le temps de construire. Vader dans le premier film n'est pas si extraordinaire que ça d'ailleurs. A part étrangler ses sous-fifres il ne faisait pas grand chose.
D'ailleurs on reproche beaucoup (à raison) à l'épisode 7 d'être très largement inspiré du 4, mais ils ont aussi pioché assez allègrement dans les bouquins non ? Je sais plus lequel exactement vu la quantité qu'il y a, mais il me semble qu'un pan énorme de l'univers étendu portait sur Jacen Solo, fils de, qui basculait lui aussi du côté obscur.
Oui. Et il y a aussi un fils qui s'appelle Ben. Mais c'est celui de Luke.
Fascinant de voir qu'un film lambda ce ferait tailler en pièce parce qu'il ne tient pas debout tout seul, alors que là, un Star Wars avec 6 films derrière lui, plus bouquin et série animés pour l'épauler il lui faut 2 films supplémentaires pour le juger pour ce qu'il est. Je trouve ça fascinant.
Kylo et Finn, c'est peut être la seule nouveauté de ce film par rapport au 4. C'est a dire des méchants pas forcement ohlala je suis trop trop méchant, ca casse un peu avec le manichéisme dégoulinant et barbant de Lucas, et il a fallu que ce soit Disney qui s'en charge  . Alors c'est pas grand chose, mais j'ai trouve ca intéressant le fait qu'un stormtrooper se rebelle et de voir que le grand méchant cote obscur a lui aussi ses doutes.
. Alors c'est pas grand chose, mais j'ai trouve ca intéressant le fait qu'un stormtrooper se rebelle et de voir que le grand méchant cote obscur a lui aussi ses doutes.
Apres, le fait que Kylo ait une tete d'ado en pleine crise, c'est pas mal pour moi parce que justement, c'est un ado en pleine crise. Oui il essaie de construire sa carapace de gros dur (le masque) mais ca reste un gamin perturbe qui sait pas trop de quel cote de la force il doit aller. Il s'est fait monter le bourrichon par le gros Gollum, mais tu sens bien que c'est pas trop son truc en fait. Pour moi ses crises de rage, bien que ridicules, montrent justement ce tiraillement.
Sinon, pour le coup de Rey qui contrôle la force en deux secondes et qui défonce Kylo je me demande s'ils vont pas partir ur un truc genre elle a été entraînée par Luke mais pour la protéger de Kylo ou de Snoke il lui a fait un truc de Jedi qui a bloque sa memoire et pour la débouquer fallait qu'elle entre en contact avec son sabre laser. C'est un peu tire par les cheveux mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que c'est la soeur de Kylo et donc Luke a peut être aussi bloque la memoire de Leia et Han pour garantir la sécurité de Rey.
Apres, le fait que Kylo ait une tete d'ado en pleine crise, c'est pas mal pour moi parce que justement, c'est un ado en pleine crise. Oui il essaie de construire sa carapace de gros dur (le masque) mais ca reste un gamin perturbe qui sait pas trop de quel cote de la force il doit aller. Il s'est fait monter le bourrichon par le gros Gollum, mais tu sens bien que c'est pas trop son truc en fait. Pour moi ses crises de rage, bien que ridicules, montrent justement ce tiraillement.
Sinon, pour le coup de Rey qui contrôle la force en deux secondes et qui défonce Kylo je me demande s'ils vont pas partir ur un truc genre elle a été entraînée par Luke mais pour la protéger de Kylo ou de Snoke il lui a fait un truc de Jedi qui a bloque sa memoire et pour la débouquer fallait qu'elle entre en contact avec son sabre laser. C'est un peu tire par les cheveux mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que c'est la soeur de Kylo et donc Luke a peut être aussi bloque la memoire de Leia et Han pour garantir la sécurité de Rey.
Je trouve que Kylo est une des réussites du film. Le mec n'est pas un grand méchant bad ass et débile, il a ses questionnements, sa fragilité et un grand potentiel pour la suite je trouve. D'un côté ou de l'autre de la Force.
Tellement +1. Pas besoin d'un gros méchant badass qui défonce tout pour que le film soit réussi. Là on a un méchant pas encore complètement formé, qui se donne + d'importance et de pouvoir qu'il n'en a réellement. Ce côté "ado" que tout le monde semble critiqué est complètement assumé et plutôt bien utilisé. Comme toi ou Next, ça promet beaucoup pour la suite, qu'il reste du côté obscur ou qu'il bascule vers la lumière.
Tellement +1. Pas besoin d'un gros méchant badass qui défonce tout pour que le film soit réussi. Là on a un méchant pas encore complètement formé, qui se donne + d'importance et de pouvoir qu'il n'en a réellement. Ce côté "ado" que tout le monde semble critiqué est complètement assumé et plutôt bien utilisé. Comme toi ou Next, ça promet beaucoup pour la suite, qu'il reste du côté obscur ou qu'il bascule vers la lumière.
Non mais l'idée peut être intéressante, après c'est quand même super pourri son questionnement et la façon dont c'est fait.
Franchement entre ses crises d'ado "j'pète tout dans ma piaule" et la mort de Solo, c'est juste très très mal fait.
Ca m'a gêné.
Non mais l'idée peut être intéressante, après c'est quand même super pourri son questionnement et la façon dont c'est fait.
Franchement entre ses crises d'ado "j'pète tout dans ma piaule" et la mort de Solo, c'est juste très très mal fait.
Ca m'a gêné.
Franchement entre ses crises d'ado "j'pète tout dans ma piaule" et la mort de Solo, c'est juste très très mal fait.
Ca m'a gêné.
Pour Solo je suis d'accord, la scène est prévisible et assez ratée. Pour le reste, je trouve pas son questionnement ridicule.
Pour Solo je suis d'accord, la scène est prévisible et assez ratée. Pour le reste, je trouve pas son questionnement ridicule.
C'est peut être une erreur de perception de ma part mais tu as l'impression d'un type qui a déjà des pouvoirs (au sens rôle qui lui est confié), tu vois un type sans trop de scrupules pour rayer un village et ses habitants de la carte puis d'un coup, il s'écroule en se questionnant. Et de manière un poil grotesque.
Ca m'a gêné.
Pareil l'instant où il ôte son masque. A la base, pourquoi pas? Ca change. Mais je ne sais pas si c'est le physique du mec, ça m'a destabilisé. Y a rien qui se dégage.
C'est ça le hic, tu as l'impression d'un stagiaire en fait sauf que c'est le méchant. Même niveau baston, pas compris que ça dure avec Finn alors que l'autre ne doit pas savoir tenir un sabre et n'est pas grand chose. Il pourrait le péter en 2 secondes mais non.
Pour Rey, je me suis dit qu'il ne veut pas trop l'esquinter pour l'emmener de son côté, ce qu'il essaie rapidement.
Donc dans un sens, s'il avait déjà été "vador", cela aurait été pourri parce que trop proche des autres épisodes.
Mais là, j'ai pas trouvé cela si bien mené.
Je trouve qu'il y a peut-être un souci de gestion du temps dans ce film.
Tu passes de Kylo Ren, sans aucune pitié, capable de stopper un Laser et le stabiliser à un type qui pleure dans sa chambre.
Tu passes d'une Rey qui découvre ce qu'est la force et parvient en peu de temps à manipuler un garde et maîtriser le sabre...
Que le mec doute et se questionne c'est intéressant mais être le "méchant" et galérer avec son sabre pour taper un trooper et une gonzesse qui n'ont jamais tenu un sabre c'est pas sérieux
Finn est quand même un minimum entraîné aux armes blanches, vu qu'on voit un stormtrooper manier le tonfa à un moment comme tout bon CRS galactique qui se respecte.
Justement le fait qu'il se fasse boloss par Rey (qui sait également se battre, cf au début) ça montre que pour l'instant il est juste bon à faire le fou contre des plots et à la limite faire le malin en arrêtant des tirs de blaster à condition qu'il les ait vus partir. Globalement c'est pas loin d'être un stagiaire ouais, d'ailleurs contrairement à Vador qui était craint par tout le monde, là tu vois le commandant de l'étoile noire bis qui a aucun scrupule à lui tenir tête en mode keskia. Et Darth Gollum à la fin qui est genre "bon envoyez moi le boloss faut que je finisse sa formation", là encore ça montre bien qu'il est loin du compte. Et c'est d'ailleurs probablement à cause de ses hésitations qu'il arrive pas à franchir un cap, contrairement à Vador qui en avait déjà plus rien à foutre depuis longtemps.
Bref il essaie de devenir Vador mais à aucun moment le film essaie de prétendre qu'il l'est. C'est dit assez clairement qu'il débute et qu'il lui reste beaucoup à apprendre, difficile de comparer les deux vu qu'ils nous sont pas montrés au même stade de leur "progression" du côté obscur.
Justement le fait qu'il se fasse boloss par Rey (qui sait également se battre, cf au début) ça montre que pour l'instant il est juste bon à faire le fou contre des plots et à la limite faire le malin en arrêtant des tirs de blaster à condition qu'il les ait vus partir. Globalement c'est pas loin d'être un stagiaire ouais, d'ailleurs contrairement à Vador qui était craint par tout le monde, là tu vois le commandant de l'étoile noire bis qui a aucun scrupule à lui tenir tête en mode keskia. Et Darth Gollum à la fin qui est genre "bon envoyez moi le boloss faut que je finisse sa formation", là encore ça montre bien qu'il est loin du compte. Et c'est d'ailleurs probablement à cause de ses hésitations qu'il arrive pas à franchir un cap, contrairement à Vador qui en avait déjà plus rien à foutre depuis longtemps.
Bref il essaie de devenir Vador mais à aucun moment le film essaie de prétendre qu'il l'est. C'est dit assez clairement qu'il débute et qu'il lui reste beaucoup à apprendre, difficile de comparer les deux vu qu'ils nous sont pas montrés au même stade de leur "progression" du côté obscur.
Ouais enfin il débute mais il a déjà massacré tous les jedi de Luke, l'a poussé à un exil, il est capable de faire des trucs avec la Force qu'on avait jamais vu avant, c'est un Skywalker. Y'a absolument rien qui laisse penser que Kylo est un faible. Pour moi on est plus dans le domaine de la mauvaise écriture qu'autre chose.
Les méchants ont toujours été l'aspect le plus fascinant de la saga Star Wars, Vader, Palpatine, Dark Maul, même un personnage secondaire comme Boba Fett avait marqué les esprits. Kylo Ren, comme tous les autres d'ailleurs (Phasma ) ne leur arrive pas à la cheville et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer dans le prochain épisode sauf pirouettes scénaristique. C'est du Disney quoi, le méchant allait pas avoir la vedette, par contre l'héroïne surpuissante qui découvre la Force en fermant les yeux 10 secondes là pas de problèmes.
) ne leur arrive pas à la cheville et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer dans le prochain épisode sauf pirouettes scénaristique. C'est du Disney quoi, le méchant allait pas avoir la vedette, par contre l'héroïne surpuissante qui découvre la Force en fermant les yeux 10 secondes là pas de problèmes.
Bref, qui avait sérieusement envie de voir Darth Ado en guise de méchant pour la nouvelle trilogie ?
Les méchants ont toujours été l'aspect le plus fascinant de la saga Star Wars, Vader, Palpatine, Dark Maul, même un personnage secondaire comme Boba Fett avait marqué les esprits. Kylo Ren, comme tous les autres d'ailleurs (Phasma
Bref, qui avait sérieusement envie de voir Darth Ado en guise de méchant pour la nouvelle trilogie ?
Après le schéma est quand même bizarre.
D'ordinaire, tu as le sens je vais du bien vers le mal sans le vouloir, ça te bouffe, tu glisses vers le fameux côté obscur et après on redescend vers la rédemption.
Là, on a un gamin qui veut devenir méchant, c'est son projet. Soit.
Mais il n'arrive pas à être trop vilain.
C'est un peu particulier comme idée quelque part: "Oh non, j'arrive pas à être vraiment méchant "
"
Et comment Snoke peut réellement lui faire confiance alors qu'il galère? Il y voit un réel potentiel?
Y a quelque chose de bancal.
D'ordinaire, tu as le sens je vais du bien vers le mal sans le vouloir, ça te bouffe, tu glisses vers le fameux côté obscur et après on redescend vers la rédemption.
Là, on a un gamin qui veut devenir méchant, c'est son projet. Soit.
Mais il n'arrive pas à être trop vilain.
C'est un peu particulier comme idée quelque part: "Oh non, j'arrive pas à être vraiment méchant
Et comment Snoke peut réellement lui faire confiance alors qu'il galère? Il y voit un réel potentiel?
Y a quelque chose de bancal.
Je viens de lire qu'Harrison Ford aurait touché 24M€ pour jouer dans SW7 
De quoi être dégoutter de mourir des le premier épisode de la trilogie
edit:
De quoi être dégoutter de mourir des le premier épisode de la trilogie
edit:
Spoiler :
Ouais enfin il débute mais il a déjà massacré tous les jedi de Luke, l'a poussé à un exil, il est capable de faire des trucs avec la Force qu'on avait jamais vu avant, c'est un Skywalker. Y'a absolument rien qui laisse penser que Kylo est un faible. Pour moi on est plus dans le domaine de la mauvaise écriture qu'autre chose.
Les méchants ont toujours été l'aspect le plus fascinant de la saga Star Wars, Vader, Palpatine, Dark Maul, même un personnage secondaire comme Boba Fett avait marqué les esprits. Kylo Ren, comme tous les autres d'ailleurs (Phasma ) ne leur arrive pas à la cheville et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer dans le prochain épisode sauf pirouettes scénaristique. C'est du Disney quoi, le méchant allait pas avoir la vedette, par contre l'héroïne surpuissante qui découvre la Force en fermant les yeux 10 secondes là pas de problèmes.
) ne leur arrive pas à la cheville et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer dans le prochain épisode sauf pirouettes scénaristique. C'est du Disney quoi, le méchant allait pas avoir la vedette, par contre l'héroïne surpuissante qui découvre la Force en fermant les yeux 10 secondes là pas de problèmes.
Bref, qui avait sérieusement envie de voir Darth Ado en guise de méchant pour la nouvelle trilogie ?
Les méchants ont toujours été l'aspect le plus fascinant de la saga Star Wars, Vader, Palpatine, Dark Maul, même un personnage secondaire comme Boba Fett avait marqué les esprits. Kylo Ren, comme tous les autres d'ailleurs (Phasma
Bref, qui avait sérieusement envie de voir Darth Ado en guise de méchant pour la nouvelle trilogie ?
Je pense que vous ne comprenez pas vraiment le traitement du personnage de Kylo Ren.
Pour l'héroïne "surpuissante", t'as une mauvaise perception de la chose. Elle ne découvre pas la Force à ce moment là, Maz Kanata lui en parle un petit moment avant, elle s'en sert déjà une première fois contre Kylo Ren quand il veut lire ses pensées et l'utilise une nouvelle fois sur James Bond. Ensuite pendant le combat, elle n'en mène pas large, elle tient un peu tête à Kylo Ren (qui est blessé et pas totalement formé), mais il reste au dessus. Ensuite elle se souvient de ce que lui a dit Maz Kanata et utilise la Force encore une fois. Elle à ce moment là une fulgurance qui lui permet de prendre le dessus sur un Kylo Ren blessé (encore une fois) et s'en sort. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'elle reste surpuissante pour toujours. Ca a été une fulgurance et elle doit être entraînée.
Pour ce qui est de Finn, comme l'a dit Ashura, et d'autres, il est entraîné au combat depuis son enfance, oui il utilise le sabre laser, mais il est pas hyper doué avec non plus. Il galère contre le stormtrooper et sans Han Solo il se fait tuer, et ensuite dans le combat contre Kylo Ren (blessé encore une fois) il recule plus qu'autre chose et se fait défoncer.
Après le schéma est quand même bizarre.
D'ordinaire, tu as le sens je vais du bien vers le mal sans le vouloir, ça te bouffe, tu glisses vers le fameux côté obscur et après on redescend vers la rédemption.
Là, on a un gamin qui veut devenir méchant, c'est son projet. Soit.
Mais il n'arrive pas à être trop vilain.
C'est un peu particulier comme idée quelque part: "Oh non, j'arrive pas à être vraiment méchant "
"
Et comment Snoke peut réellement lui faire confiance alors qu'il galère? Il y voit un réel potentiel?
Y a quelque chose de bancal.
D'ordinaire, tu as le sens je vais du bien vers le mal sans le vouloir, ça te bouffe, tu glisses vers le fameux côté obscur et après on redescend vers la rédemption.
Là, on a un gamin qui veut devenir méchant, c'est son projet. Soit.
Mais il n'arrive pas à être trop vilain.
C'est un peu particulier comme idée quelque part: "Oh non, j'arrive pas à être vraiment méchant
Et comment Snoke peut réellement lui faire confiance alors qu'il galère? Il y voit un réel potentiel?
Y a quelque chose de bancal.
Bien sûr qu'il y voit un potentiel, et Han Solo l'explique qu'il se sert de lui. Faut pas oublier que Kylo Ren est un skywalker, son descendant est Dark Vador, le potentiel est là.
C'est pas vraiment qu'il arrive pas à être trop vilain, il est vilain, il veut l'être, il l'est même par moment (début du film, massacre des élèves Jedi, meurtre de son père), mais il a simplement pas encore tous les pouvoirs pour. Il veut être à la hauteur de Vador (d'où la "copie" de l'étoile noire), il veut le surpasser (d'où la taille de cette planète, 10 fois plus grande que l'étoile noire), montrer qu'il est le meilleur. Il "n'arrive pas" à être méchant parce qu'il en a pas encore les pouvoirs, et parce qu'il doute, évidemment, mais il le veut. J'y vois pas vraiment quelque chose de bancal perso, je trouve le personnage assez cohérent dans son ensemble.
Bien sûr qu'il y voit un potentiel, et Han Solo l'explique qu'il se sert de lui. Faut pas oublier que Kylo Ren est un skywalker, son descendant est Dark Vador, le potentiel est là.
C'est pas vraiment qu'il arrive pas à être trop vilain, il est vilain, il veut l'être, il l'est même par moment (début du film, massacre des élèves Jedi, meurtre de son père), mais il a simplement pas encore tous les pouvoirs pour. Il veut être à la hauteur de Vador (d'où la "copie" de l'étoile noire), il veut le surpasser (d'où la taille de cette planète, 10 fois plus grande que l'étoile noire), montrer qu'il est le meilleur. Il "n'arrive pas" à être méchant parce qu'il en a pas encore les pouvoirs, et parce qu'il doute, évidemment, mais il le veut. J'y vois pas vraiment quelque chose de bancal perso, je trouve le personnage assez cohérent dans son ensemble.
C'est pas vraiment qu'il arrive pas à être trop vilain, il est vilain, il veut l'être, il l'est même par moment (début du film, massacre des élèves Jedi, meurtre de son père), mais il a simplement pas encore tous les pouvoirs pour. Il veut être à la hauteur de Vador (d'où la "copie" de l'étoile noire), il veut le surpasser (d'où la taille de cette planète, 10 fois plus grande que l'étoile noire), montrer qu'il est le meilleur. Il "n'arrive pas" à être méchant parce qu'il en a pas encore les pouvoirs, et parce qu'il doute, évidemment, mais il le veut. J'y vois pas vraiment quelque chose de bancal perso, je trouve le personnage assez cohérent dans son ensemble.
Ce que je trouve bancal c'est justement ce cheminement "Je veux être le mal mais j'y arrive pas", faudrait inviter Ikki dans la discussion.
Je ne sais pas c'est bizarre comme truc.
Anakin a basculé, il ne se pose pas de question, il est bouffé petit à petit par le côté obscur. Luke a "failli", c'est ce que l'empereur essayait de faire, faire monter la colère en lui.
Je ne sais pas si tu te poses vraiment des questions si tu veux être la pire ordure de la galaxie. Le côté obscur est toujours le plus facile, c'est la philosophie de la saga mais même ça, il n'y arrive finalement pas.
C'est un putain de loser.
A moins que la théorie de l'infiltré ne prenne le pas. Mais j'en doute.
Je pense que vous ne comprenez pas vraiment le traitement du personnage de Kylo Ren.
Pour l'héroïne "surpuissante", t'as une mauvaise perception de la chose. Elle ne découvre pas la Force à ce moment là, Maz Kanata lui en parle un petit moment avant, elle s'en sert déjà une première fois contre Kylo Ren quand il veut lire ses pensées et l'utilise une nouvelle fois sur James Bond. Ensuite pendant le combat, elle n'en mène pas large, elle tient un peu tête à Kylo Ren (qui est blessé et pas totalement formé), mais il reste au dessus. Ensuite elle se souvient de ce que lui a dit Maz Kanata et utilise la Force encore une fois. Elle à ce moment là une fulgurance qui lui permet de prendre le dessus sur un Kylo Ren blessé (encore une fois) et s'en sort. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'elle reste surpuissante pour toujours. Ca a été une fulgurance et elle doit être entraînée.
Pour l'héroïne "surpuissante", t'as une mauvaise perception de la chose. Elle ne découvre pas la Force à ce moment là, Maz Kanata lui en parle un petit moment avant, elle s'en sert déjà une première fois contre Kylo Ren quand il veut lire ses pensées et l'utilise une nouvelle fois sur James Bond. Ensuite pendant le combat, elle n'en mène pas large, elle tient un peu tête à Kylo Ren (qui est blessé et pas totalement formé), mais il reste au dessus. Ensuite elle se souvient de ce que lui a dit Maz Kanata et utilise la Force encore une fois. Elle à ce moment là une fulgurance qui lui permet de prendre le dessus sur un Kylo Ren blessé (encore une fois) et s'en sort. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'elle reste surpuissante pour toujours. Ca a été une fulgurance et elle doit être entraînée.
T'oublies que Kylo Ren se fait déjà humilier par Rey lors de l'interrogatoire, et qu'à ce moment il est ni blessé, ni affaibli, ni quoi que ce soit.
Et Rey dans la foulée qui arrive à contrôler le stormtrooper, c'est parce qu'elle a tapé la discute 2 min avec Maz ?
Y'a un gros décalage entre comment Kylo évolue au cours du film (il est surpuissant au début avant de croiser la route des gentils et se transformer en paillasson) et les gentils qui ont une progression éclair totalement improbable, j'veux dire soyons réaliste, même blessé, t'introduis pas le bad guy de ta trilogie en le montrant en train de se faire savater par 2 noob dans une forêt. Il va lui rester quoi pour le prochain film alors que Rey a l'issue du premier film a l'air presque aussi forte que Luke dans le Retour du jedi.
Enfin bon Kylo Ren fait juste pas rêver en nouveau méchant de la saga, si il pouvait au moins se rendre utile une dernière fois en nous débarrassant de Carrie Fisher ça serait déjà un bon début. Quelle horrible actrice
T'oublies que Kylo Ren se fait déjà humilier par Rey lors de l'interrogatoire, et qu'à ce moment il est ni blessé, ni affaibli, ni quoi que ce soit.
Il n'a probablement jamais non plus eu face à lui quelqu'un lui oppose une résistance liée à la Force.
La scène équivalente avec Poe Dameron plus tôt dans le film est là pour le montrer. Ce dernier est un des meilleurs résistants de la galaxie mais ne peut opposer la moindre résistance. Et c'est à ce type de mec que Kylo Ren a toujours à faire, des personnes qui ne sont pas en mesure de lutter.
Et comme le mec est plutôt faible mentalement, il se fait avoir comme un bleu qu'il est le jour où enfin il se retrouve face à quelqu'un à sa mesure.
Vader utilisait son costume pour combler ses carences physiques/médicales. Alors que Kylo Ren l'utilise pour se donner la prestance et l'illusion d'une Force qu'il ne maîtrise pas (encore).
Il est clairement un simulacre de bad guy sur cet épisode oui, autant pour le spectateur que les personnages du film. Un pion de Snoke utilisé pour semer la terreur par son apparence. D'ailleurs, ce dernier lui-même fait plus confiance à Hux qu'à son apprenti lorsqu'il s'agit de prendre de réelles décisions.
Mais jusque là, sa formation très limite suffisait amplement vu qu'ils sont de toute façon dans une galaxie où le seul Jedi s'est terré depuis des lustres. Il n'y avait pas vraiment d'opposition.
Je comprends que ça puisse décevoir, mais moi ça me fait kiffer ce genre de contre-pied.
Je vois des gens qui essayent de se rassurer plus qu'ils n'essayent d'exprimer leur véritable sentiment vis à vis du film.
Le nombre d'incohérence et de mauvais choix... Ce qui a toujours fait le plus fantasmé les fans, c'est à dire la force et le coté obscur est carrément galvaudé. Kylo Ren a pas (encore?) ce qu'il faut pour être le vrai méchant. Et tu fais pas un bon film sans bon méchant. On a zéro approche politique, pourquoi est ce qu'il y a encore une resistance ? Où est la république ? Comment Luke (et les jédi qu'il a formé) ont pu être vaincu par un gosse ?
Finn... putain... Je veux bien qu'il ai une prise de conscience mais merde, c'est hyper mal amené... Pourquoi va t-il sauver Poe ?
Je vois pas pourquoi on devrait attendre de voir les prochains épisode pour pouvoir jugé ce film tel qu'il est. Un film moyen.
Le nombre d'incohérence et de mauvais choix... Ce qui a toujours fait le plus fantasmé les fans, c'est à dire la force et le coté obscur est carrément galvaudé. Kylo Ren a pas (encore?) ce qu'il faut pour être le vrai méchant. Et tu fais pas un bon film sans bon méchant. On a zéro approche politique, pourquoi est ce qu'il y a encore une resistance ? Où est la république ? Comment Luke (et les jédi qu'il a formé) ont pu être vaincu par un gosse ?
Finn... putain... Je veux bien qu'il ai une prise de conscience mais merde, c'est hyper mal amené... Pourquoi va t-il sauver Poe ?
Je vois pas pourquoi on devrait attendre de voir les prochains épisode pour pouvoir jugé ce film tel qu'il est. Un film moyen.
Finn... putain... Je veux bien qu'il ai une prise de conscience mais merde, c'est hyper mal amené... Pourquoi va t-il sauver Poe ?
Je vois pas pourquoi on devrait attendre de voir les prochains épisode pour pouvoir jugé ce film tel qu'il est. Un film moyen.
Je vois pas pourquoi on devrait attendre de voir les prochains épisode pour pouvoir jugé ce film tel qu'il est. Un film moyen.
il y a un dialogue entre les 2, finn avoue qu'il veut se barrer, et le seul moyen c'est de piloter un des engins. Lui ne le sait pas faire donc il fait évader un mec qui en a les compétences, notamment parce que poe est considéré comme le meilleur pilote de la résistance.
Ils vont pas te raconter toute l'histoire de a à z, sinon à quoi bon faire une suite ? Si tu sors d'un film où tu sais pertinemment qu'il y a deux autres derrière, sans un sentiment de "j'ai envie de voir la suite pour tel ou tel raison", c'est qu'ils ont raté leur boulot.
Et encore une fois, tes critiques valent pour la trilogie 4 5 6, est ce que ces films sont mauvais d'après toi ?
D'après la novélisation du livre, une entrevue entre Phasma et Finn le pousse à fuir, il doit passer en reconditionnement et à priori, il y a une relation particulière entre Finn et Phasma (particulière comment ????).
Le livre nous explique aussi que le meurtre de Han Solo par Kylo Ren n’a pas eu les effets escompter sur lui, au lieu de le libérer ça l’a au contraire hébéter… C’est pourquoi il ne sent pas le tir de Chewie arriver et qu’il se fait toucher pendant ses duels contre Finn et Rey.
En gros, d’après le livre, il n’avait ni la condition physique, ni la condition psychique pour combattre.
Le livre nous apprend aussi qu’une voix conseille à Rey d’achever Kylo Ren quand il est à terre, peut-être la voix de Snoke….
Le livre nous explique aussi que le meurtre de Han Solo par Kylo Ren n’a pas eu les effets escompter sur lui, au lieu de le libérer ça l’a au contraire hébéter… C’est pourquoi il ne sent pas le tir de Chewie arriver et qu’il se fait toucher pendant ses duels contre Finn et Rey.
En gros, d’après le livre, il n’avait ni la condition physique, ni la condition psychique pour combattre.
Le livre nous apprend aussi qu’une voix conseille à Rey d’achever Kylo Ren quand il est à terre, peut-être la voix de Snoke….
Ça sort d'où ça ?
De l'adaptation en roman du film.
Bon, film vu hier soir.
A la sortie de la salle de ciné, exactement le même sentiment que pour l'episode I : mitigé.
Mais si la fin de cette trilogie est comme la revanche des Sith
A la sortie de la salle de ciné, exactement le même sentiment que pour l'episode I : mitigé.
Mais si la fin de cette trilogie est comme la revanche des Sith
De l'adaptation en roman du film.
Donc c'est "officiel" ?
Sinon je viens aussi de revoir l'épisode 3, et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout.
Déjà il n'y a pas Jar Jar, et puis même la relation Anakin / Padmé n'est pas trop pénible à suivre comme dans le 2.
il y a un dialogue entre les 2, finn avoue qu'il veut se barrer, et le seul moyen c'est de piloter un des engins. Lui ne le sait pas faire donc il fait évader un mec qui en a les compétences, notamment parce que poe est considéré comme le meilleur pilote de la résistance.
Ils vont pas te raconter toute l'histoire de a à z, sinon à quoi bon faire une suite ? Si tu sors d'un film où tu sais pertinemment qu'il y a deux autres derrière, sans un sentiment de "j'ai envie de voir la suite pour tel ou tel raison", c'est qu'ils ont raté leur boulot.
Et encore une fois, tes critiques valent pour la trilogie 4 5 6, est ce que ces films sont mauvais d'après toi ?
Ils vont pas te raconter toute l'histoire de a à z, sinon à quoi bon faire une suite ? Si tu sors d'un film où tu sais pertinemment qu'il y a deux autres derrière, sans un sentiment de "j'ai envie de voir la suite pour tel ou tel raison", c'est qu'ils ont raté leur boulot.
Et encore une fois, tes critiques valent pour la trilogie 4 5 6, est ce que ces films sont mauvais d'après toi ?
C'est un stormstrooper, il est censé être entraîné et endoctriné depuis sa naissance. Poe, qui n'a jamais mis les pieds dans un de ces vaisseaux le conduit comme Vador ? Pourquoi est ce qu'il attend tout simplement pas une possibilité moins risqué pour déserté ? En mission, par exemple... Là, j'ai envie de voir la suite parce que le premier est raté. Pas parce que je suis particulièrement curieux de ce qui peux leur arriver sachant qu'aucun perso m'a vraiment marquer. Si c'était pas un star wars, j'me poserai pas toutes ses questions.
Et c'est pas pareil dans la 1 ère trilogie. Déjà, les méchants ont bien plus de classe, font bien plus peur. Tu découvres la saga, y'a une deuxième étoile de la mort, certes.
Citation
UN NOUVEAU DÉSESPOIR
Posté le 29 décembre 2015 par Rafik DJOUMI
Il paraît qu’un nouveau STAR WARS est visible dans les salles depuis le 16 décembre dernier. Impossible de passer à côté de l’évènement (même en allant faire ses courses au rayon papier toilettes), donc voici notre critique de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE signé J.J. Abrams et les 8734 actionnaires de Disney. On prévient les quelques étourdis qui n’ont pas encore vu la chose : ça spoile sévère !
Malgré un accueil démesurément enthousiaste de la part de la critique dite institutionnelle, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE affronte depuis sa sortie un mur de résistance sur Internet émanant de ceux qu’on appelle « les fans », une communauté en réalité difficilement identifiable si on ne prend pas le temps de déterminer ce qui lui confère ce statut dans un monde où tout le monde est plus ou moins « fan de STAR WARS ». Et à y regarder de près, une grande partie des reproches formulés par ces « fans » à l’encontre de ce nouveau film (comédiens parfois en roue libre, intrigue simpliste, multiples incohérences, recours à trop de Deus Ex machina, etc.) pourraient être retrouvés à l’identique dans la presse de 1977. Ce qui aurait changé en quatre décennies est la répartition des rôles, avec une institution qui promeut ce nouveau film que la fanbase écarte avec dédain. Ce qui n’est certainement pas hasardeux. La critique la plus impartiale de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE ne pourrait être conçue que par une personne n’ayant jamais vu LA GUERRE DES ÉTOILES mais qui soit tout de même familière des techniques et de l’Histoire du cinéma. Or, les probabilités qu’une telle personne puisse exister sur Terre sont quasi-nulles. C’est bien ce qui rend la contextualisation absolument incontournable lorsqu’on approche la critique de n’importe quel film de cette saga. Car malgré la dizaine de milliers de mensonges (par ignorance) commis chaque année par les médias, LA GUERRE DES ÉTOILES reste à jamais le plus grand succès « spontané » en salles de tous les temps et très certainement le film le plus vu par les deux dernières générations ; une œuvre qui engage plus que sa simple qualité de film puisqu’elle définit automatiquement, avec une dizaine d’autres films, l’idée même de cinéma à l’échelle de la planète.
Cette contextualisation oblige donc à rappeler ce qu’est à l’origine cette spontanéité de LA GUERRE DES ÉTOILES : un film non attendu, non évènementiel car parfaitement anachronique à l’époque qui le vit naître. Le caprice d’un jeune auteur réputé expérimental et qui fut originellement budgété à 3,5 millions de dollars, avant dépassements. Un « truc à la Flash Gordon » comme l’appelait Ned Tannen chez Universal, qui refusa ce projet si peu conforme aux attentes du public. Un « film de Noël avec un chien géant » comme le surnommèrent certains cadres dubitatifs de la 20th Century Fox. Ce n’est qu’en ayant bien à l’esprit sa « petitesse » et son « insignifiance » originelle que l’on peut commencer à mesurer l’anomalie que représente le « phénomène STAR WARS ». Le succès de l’année 1977 pour la Fox aurait dû être DE L’AUTRE CÔTÉ DE MINUIT, avec Marie-France Pisier, et certainement pas une histoire de conflit galactique. Si LA GUERRE DES ÉTOILES est souvent cité comme une date-clé, une sorte d’année zéro de la culture geek, c’est parce que l’éclosion anormale de son succès à la fin-mai, l’affluence stupéfiante des premiers jours, mit en lumière cette communauté de fadas d’informatique, de maths, d’astronomie et de fantasy, qui existait sous le radar depuis une dizaine d’années. Qu’on le veuille ou non, LA GUERRE DES ÉTOILES en tant que phénomène leur appartient. Il fut leur tract, leur banderole, le film qui chantait leurs aspirations en rupture brutale avec l’époque. L’immense public qui vint en salle durant l’été 1977 ne fit que suivre le buzz initié par cette manifestation. Et ce que la presse de l’époque ne parvenait pas à saisir, même avec la meilleure volonté (pas plus qu’elle ne semble l’avoir pleinement saisi aujourd’hui), c’était précisément la nature de cette aspiration. Pourquoi cette résurgence triomphale des aspects les plus « campy », les plus désuets, de la culture pulp des années 20 et 30 ? L’Amérique du Vietnam et du Watergate avait remisé ses John Carter, ses Buck Rogers et ses Flash Gordon au fond du jardin, dans la caisse des idéaux fantaisistes d’un autre temps. LA GUERRE DES ÉTOILES les ravivait avec force.
Entre les 37 écrans qui accueillirent le film de George Lucas en mai 1977 et les 4000 et quelques écrans réservés au premier week-end de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, quatre décennies se sont écoulées à travers lesquelles ces aspirations se sont inscrites dans la réalité du monde. Le rôle historique de ces geeks, qui firent émerger LA GUERRE DES ÉTOILES de son terrier, aura été d’assurer la transition entre le XXème et le XXIème siècle, en concevant sur le plan pratique la révolution informatique et la société de l’information et, sur le plan idéologique, le goût pour l’exploration de vastes univers imaginaires comme terreaux d’expérimentation des possibles ainsi qu’un aperçu des univers parallèles et de la pensée analogique que cette nouvelle société nous impose. Malheureusement, comme tout groupe culturel dont l’impact sur le monde est quantifiable, les geeks contemplent aujourd’hui le renversement de valeurs auquel a mené leur révolution. Leur rêve d’un « power to the people » assuré par le protocole de machines interconnectées ne dépendant pas d’un pouvoir central a fini par générer une concentration délirante du pouvoir en son centre. Leur élan new-age vers une libération de la parole se conclut par la plus effroyable machine de surveillance des masses jamais imaginée. Il était inévitable que, par analogie, la saga STAR WARS épouse ce retournement.
Avant d’aller plus loin, il est important d’identifier les cibles. Dès l’annonce de l’écriture de cet ÉPISODE VII, il était évident que la productrice Kathleen Kennedy et que le réalisateur J.J. Abrams ne bénéficieraient que d’une marge de manœuvre abominablement réduite. La franchise STAR WARS a été acquise à hauteur de quelques milliards de dollars par le studio Disney dans le but avoué d’en calquer l’exploitation sur le modèle des adaptations des super-héros Marvel, c’est-à-dire une mainmise absolue et transmédiatique sur tout cet univers avec pour seul objectif le contentement des actionnaires, autrement dit une rentabilité massive et immédiate qui se doit de multiplier au moins par deux ou trois les résultats plutôt décevants de STAR WARS : ÉPISODE II – L’ATTAQUE DES CLONES et STAR WARS : ÉPISODE III – LA REVANCHE DES SITH. Quels que soient les désirs éventuels de fanboy de J.J. Abrams, ils ne sont qu’une cinquième roue du carrosse. L’orientation créative de cet épisode ne peut se faire qu’avec le nouveau format des études de marché. Autrement dit, chaque fantasme, chaque prise de bec, chaque délire des fans sur les forums Internet (anglo-saxons) y devient un commandement ; et l’on imagine Lawrence Kasdan googliser frénétiquement pour savoir comment Han Solo ou la Princesse Leïa, des personnages qu’il a lui-même contribué à définir, sont censés s’exprimer pour satisfaire l’omniscience autoproclamée de la fanbase. Si tant de spectateurs ont eu la sensation d’avoir affaire à une fan-fiction en découvrant STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, c’est une tare qui était inscrite génétiquement dans le projet avant même sa mise en œuvre. De toute évidence, l’attachement des fans au « used space » du design de Ralph McQuarrie, leur méfiance vis-à-vis du bestiaire numérique, sont des aspects fanboy que J.J. Abrams partage explicitement. Car la détestation de la prélogie s’est en effet cristallisée autour de ces deux aspects finalement secondaires (le design et le numérique) plutôt que de reconnaître avec simplicité que les épisodes I, II et III étaient d’abord monstrueusement cons et condamnaient de fait n’importe quel design ou effet spécial à participer de l’hérésie ambiante. Mais le recours au « used space » ou aux animatroniques dans ce nouvel épisode n’est plus un choix créatif dépendant des attentes commerciales. Il s’inscrit directement dans la stratégie nostalgique du studio Disney qu’on pourrait qualifier de « cinéma doudou » (©L’ouvreuse) et destiné à couvrir tout film contemporain d’un assaisonnement à base de portion d’enfance fantasmée. L’essentiel de la fan-fiction fonctionne sur ce mouvement régressif, mais ce rôle n’est théoriquement pas dévolu aux fictions censées nourrir les fans.
LA GUERRE DES ÉTOILES, comme nous l’avons vu, était un film d’auteur par défaut, livré à lui-même par un studio qui s’en désintéressait et n’attendait de lui aucun exploit. Plus important, les épisodes V, VI et I, II, III étaient des productions in-dé-pen-dantes, un aspect fondamental à la compréhension de l’univers STAR WARS dans l’enceinte hollywoodienne, et qui a été trop peu souvent rappelé par les médias tant il ne cadrait pas avec leur vision binaire de cette industrie. Ainsi, lorsque George Lucas « commet » la prélogie, il n’y a aucune hiérarchie pour lui imposer des directions. En tant qu’auteur, réalisateur et producteur, il a effectivement toute liberté pour partir en vrille, trahir ses fans, désoler les actionnaires de la Fox et laisser les grandes surfaces se sur-stocker de millions de figurines qui ne se vendront jamais. Lui seul peut être tenu pour responsable de la déroute artistique. Alors que contractuellement, historiquement, et commercialement, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE est le premier STAR WARS entièrement planifié dans ses moindres recoins par les intérêts d’une major. Kathleen Kennedy et J.J. Abrams ne peuvent être tenus pour les principaux responsables de cet état de fait, tout au plus des complices plus ou moins consentants. Il demeure un aspect qui n’est pas forcément un problème dans le cadre d’une franchise comme STAR WARS mais qu’il est tout de même nécessaire de rappeler : J.J. Abrams n’est pas un cinéaste. Sur le plan créatif, il est originellement un showrunner, quelqu’un qui pense en termes de récit et d’orientation globale (un rôle plus souvent attribué au producteur dans le cinéma hollywoodien) mais chez qui la mise en images se résume à cela : de la simple mise en images. C’est ce que l’on appelle un shooter. Depuis l’époque de la série ALIAS, son style de mise-en-scène n’a pas évolué d’un iota car il n’en a pas besoin. Héritier des techniques de couverture optimale enseignée dans les bonnes écoles, la méthode d’Abrams a vocation exclusive à servir la Bible que constitue le scénario, d’une façon économe et dynamique, sans que jamais n’interfère le moindre sous-texte ou double sens périphérique. C’est pourquoi de nombreuses séquences de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, peu signifiantes sur le plan scénaristique, auront été déjà vues à l’identique dans ses films précédents. Les plans de Rey filant sur son vaisseau le long des carcasses de destroyers géants étaient déjà visibles dans STAR TREK (pour ceux qui s’en souviennent). La course effrénée de Rey et Finn pour échapper au bombardement du marché de Jakku reprend des travellings de MISSION : IMPOSSIBLE 3 (pour ceux qui s’en souviennent). Le premier vol du faucon millénaire, poursuivi par des chasseurs TIE dans les entrailles du Destroyer, rappelle une séquence de STAR TREK : INTO DARKNESS (pour ceux qui s’en souviennent). Les deux plans-séquence qui rythment le passage sur la planète Takodana (l’arrivée dans la simili-cantina et le vol circulaire du X-wing autour du champ de bataille) ne dépassent pas, en ambition et en chorégraphie, la pauvreté scénique de SUPER 8 (pour ceux qui s’en souviennent). Quant à l’horrible très longue focale en hélicoptère qui conclut le film en unissant Rey à Luke, elle avait déjà été affreusement utilisée par George Lucas sur STAR WARS – ÉPISODE II : L’ATTAQUE DES CLONES et elle fait écho rien moins qu’à une centaine de documentaires montagnards paresseux. Cette énumération n’a pas vocation à accabler Abrams de tous les maux mais à expliquer le fait qu’il ne puisse se détacher du commandement de sa hiérarchie en faisant dérailler une œuvre pré-calculée grâce à une mise en scène subtile ou à double-fond (comme l’ont fait autrefois tant de cinéastes mavericks dans l’enceinte rigide des studios). Si la prélogie de Lucas nous avait infligé une mise en scène scolaire et passéiste à base de plans d’ensemble-plans rapprochés-champs/contrechamps, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE ne nous inflige rien de plus ou de moins que ce que à quoi nous a habitué le cahier des charges télévisuel de ces dernières années.
Et pourtant, quelque chose semblait timidement se produire, d’un point de vue scénaristique et scénographique, dans les toutes premières minutes du film. Le plan iconique d’ouverture sur un destroyer s’amuse à dialoguer avec son illustre ancêtre en un effet d’éclipse suffisamment inattendu pour ne pas être déférent. La présentation du personnage de Poe devisant avec Lor San Tekka n’a rien de stupéfiant en soi mais elle génère certains des mini-frissons que pouvaient provoquer la découverte de nouveaux protagonistes dans les romans de l’Univers étendu. Enfin, l’identité et le conflit intérieur du Stormtrooper Finn sont caractérisés par une triple marque de sang qu’il porte sur son casque (peut-être la seule idée réellement cinématographique du film). Toute cette première séquence d’invasion et d’attaque du hameau par les troupes du Premier Ordre ont d’étranges réminiscences de l’œuvre d’Osamu Tezuka, à la fois dans la radicalité du massacre d’innocents et dans la fantasmagorie du Mal implacable suggéré par l’armure rutilante du Captain Phasma. On se souvient que George Lucas avait calqué la structure de son récit originel sur LA FORTERESSE CACHÉE d’Akira Kurosawa. On se surprend alors à imaginer que la nouvelle équipe se soit à son tour ingénieusement tournée vers le Japon et sa pléthore de modèles narratifs trop rarement importés. Et si Rey, dans son exploration patiente des tréfonds de vaisseaux du passé, émulait le personnage de NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT ? Et si la tentative d’évasion foireuse de Poe et Finn nous menait au comique palpitant d’un CONAN, LE FILS DU FUTUR ? Et si le besoin impérieux qu’a l’ouvrier Finn de protéger Rey d’un danger qu’il a encore mal identifié émulait le brave Pazu du CHÂTEAU DANS LE CIEL ? Faux espoirs.
La seule « nouveauté » à laquelle nous invite alors le récit est d’ordre strictement sociologique (et donc périphérique au récit). « Les héros de STAR WARS seront dorénavant une femme et un black » semble nous dire avec fierté l’équipe de Disney. Or, cette héroïne féminine avait déjà été évoquée par Gary Kurtz et George Lucas, en vue d’un hypothétique ÉPISODE VII, à l’époque de leur conception de REVENGE OF THE JEDI. Cette héroïne aurait dû être la sœur cachée de Luke Skywalker et les traits, les activités de scavenger et l’accoutrement de Rey semblent directement issues de ces réunions de travail (après le clash et le départ de Gary Kurtz, Lucas décidera de faire de Leïa la sœur de Luke dans le retitré LE RETOUR DU JEDI, initiant un sous-texte incestueux dont on se serait bien passés). Enfin l’annonce du personnage black de Finn entraîna en début d’année une polémique débile dans les provinces consanguines aux USA, où personne n’a jamais entendu parler de Lando Calrissian. Toujours est-il que sur le plan sociologique (et donc périphérique au récit), cette « nouveauté » s’avère bien plus embarrassante que prévue. Finn se révèle être une sorte d’esclave en fuite, réduit à plonger sa tête dans un abreuvoir à bestiaux, et que nos héros soupçonneront d’abord d’avoir volé un blouson à l’homme blanc (?)… bref un Kunta Kinté… dans un blockbuster de 2015… Quant à Rey, une fois passées les présentations miyazakiennes évoquées ci-dessus, elle se révèle être probablement l’un des pires lead-characters de ces vingt dernières années. Zéro conflit, zéro choix moral, zéro erreur, elle se verra condamnée durant tout le reste du métrage à subir des évènements qu’elle n’a jamais initiés, avec pour seule promesse d’arc narratif un pauvre flashback directement hérité des séries télé qui ne savent pas du tout où elles vont. Ses seules impulsions consistent à trop kiffer de rencontrer des gens célèbres et à s’inscrire dans une quête permanente de la validation paternelle en prouvant à Han Solo ses compétences de pilote mécanicienne. En résumé : Kunta Kinté et une potiche ballotée par les évènements. Étonnant de voir que les curés des réseaux sociaux, toujours prompts à condamner le racisme et la misogynie de la production hollywoodienne, ne se soient pas sentis foudroyés par ce doublé (et par simple politesse, nous éviterons de nous attarder sur le sort parfaitement débile réservé au personnage féminin pourtant prometteur de Phasma).
Le plus embarrassant est pourtant à venir. Dès l’apparition de Han Solo et de Chewbacca, le film se met définitivement sur les rails du Doudouland cher au studio Disney. Passons sur le coup de bol qui autorise cette rencontre entre les héros et le légendaire mercenaire (le film est truffé de tels raccourcis et LA GUERRE DES ÉTOILES en usait déjà sans que cela nuise à son déroulé) pour plutôt s’appesantir sur l’incapacité des auteurs à réinventer ce personnage, jusqu’à le rétrograder au rang de ses lointains descendants, en l’occurrence le Peter Quill des GARDIENS DE LA GALAXIE. La gêne intense qui s’empare de nous dans la séquence, parfaitement inutile voire sinistrement mal foutue, qui s’ensuit (scénographie à deux portes et monstres incompréhensibles), est un peu l’équivalent de ce que ressentirait un fan de James Bond en voyant l’agent 007 tenter d’imiter Austin Powers. Si l’on pouvait craindre jusque-là que les auteurs ne pêchent par excès de déférence et de fanboyisme, voici qu’ils nous indiquent soudain ne pas comprendre grand chose à l’univers qu’ils souhaitent faire revivre. Cette sensation de gêne acide grandira avec la révélation progressive du cercle familial Han Solo / Leïa / Kylo Ren, en un absurde mélodrame où un couple de post-soixante-huitards divorcés (les versions galactiques d’André Dussolier et Sabine Azéma) se désespèrent de l’immaturité de leur fils unique, Tanguy le colérique. Et la confirmation de ce plus-qu’à-peu-près thématique s’imposera dans la séquence de maîtrise expresse de la Force dont fait preuve Rey, quelques minutes après avoir entendu son évocation. À cet instant, le spectateur lambda est en droit de se demander si quelqu’un parmi l’équipe de ce nouvel épisode a déjà vu un film de la saga STAR WARS. Peut-être pas les films en entier mais des bribes, des bandes-annonces, des pochettes de figurines, tant la servilité à reproduire des « images-clés » ne donne même plus lieu à de l’étonnement : une planète désertique, une planète enneigée, une planète forestière. Voilà pour le dépaysement galactique ! La saga qui a ouvert en grand l’imaginaire d’au moins trois générations, en générant un vaste univers à explorer, se retrouve réduite à deux-trois niveaux obligatoires, tel le moins imaginatif des jeux de plateforme.
Tony Zhou, ou ce qui est arrivé de mieux à la cinéphilie internaute ces dernières années, a expliqué très clairement en quoi ce nouveau STAR WARS ressemblait surtout à une tentative de réparer LE RETOUR DU JEDI, film qui scellait la mainmise régressive de George Lucas sur son univers et qui préfigurait avec vingt ans d’avance la déroute narrative de la prélogie. En offrant à Han Solo la mort qu’il aurait dû connaître lorsque Gary Kurtz était encore sur le projet, J.J. Abrams et Lawrence Kasdan semblent faire un remake du parcours de ce personnage dans un film sorti il y a plus de trente ans, avec pour seul objectif émotionnel cette séquence de mort autrefois promise à Harrison Ford et inconsciemment attendue par les fans ; une séquence évidemment superfétatoire aujourd’hui. Or non seulement ce pic émotionnel n’en est pas un, la faute à une narration indécise qui n’a jamais choisi ses priorités dans les séquences précédentes, mais la scène se permet en plus d’en appeler à la mémoire qu’a le public d’un autre moment d’émotion, à savoir la mort de Gandalf dans LE SEIGNEUR DES ANNEAUX – LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU. La topographie est respectée : le pont de Kazad-dum, le gouffre de la Moria, Kylo Ren dans le rôle du Balrog, jusqu’au cri de révolte de Rey / Frodon face à ce corps qui chute, et à qui il ne manque plus que le ralenti. D’une façon plus globale, on pourrait presque s’amuser à décrypter tout STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE comme une tentative d’auto-légitimation de J.J. Abrams, à qui l’on vient de confier un monument de cette culture pop dans laquelle il s’est développé et qui choisit de se confondre en excès d’humilité : le côté ébahi de Rey découvrant ses idoles ; l’impuissance adolescente de Kylo Ren à se hisser à la hauteur de son modèle de vilain ; ou même la petite portion de carte que BB-8 vient ajouter à la grande carte d’un R2D2 qui le domine ; tous ces éléments pourront faire la joie des décryptages auteurisants mais ils ne feront que rajouter quelques clous à un cercueil déjà bien scellé, celui d’un échec opérant à de multiples niveaux qui dépassent celui de son principal signataire.
Car en définitive, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, premier STAR WARS entièrement déterminé par le désir d’une major, n’a qu’une seule fonction : celle d’être une publicité pour la marque STAR WARS ©, une tentative de « réveil » de la fanbase par la stimulation nostalgique en vue de préparer la déferlante transmédiatique de ces dix prochaines années. Et comme toute publicité, le film n’a rien d’autre à proposer que du concept dénué de substance : une Force qui ne l’est que parce qu’on l’a nommée ainsi, ou encore des sabres-laser qui transforment ceux qui les touchent en de redoutables escrimeurs, c’est-à-dire de purs simulacres ou, pour paraphraser le nihilisme selon Baudrillard « des croix qui suggèreraient, au fond, que Dieu n’a jamais existé ». Ce n’est pas une erreur de parcours, un échec isolé, mais bel et bien la confirmation que l’anomalie que représentait originellement STAR WARS a parfaitement été digérée par toute l’institution qu’il avait autrefois mise en échec. Pour preuve préalable, les six dernières années du box-office international, quasi-intégralement constituées de « franchises geeks », sont devenus l’antichambre de l’Enfer et la destruction méthodique de l’imaginaire que beaucoup des gourous de cette culture avaient prophétisé. Des « franchises geeks » à ce point soutenues par le cynisme des chiffres et la régression fœtale de toute une société qu’elles asphyxient les meilleurs créateurs et étranglent jusqu’à l’évocation des sources pulp de toute cette culture. Et s’il se trouve des spectateurs qui auront sincèrement apprécié le film de J.J. Abrams en dehors de tout contexte, il reste que STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE, du studio Disney, est ontologiquement une négation de STAR WARS ainsi que le symbole d’une réelle capitulation.
Posté le 29 décembre 2015 par Rafik DJOUMI
Il paraît qu’un nouveau STAR WARS est visible dans les salles depuis le 16 décembre dernier. Impossible de passer à côté de l’évènement (même en allant faire ses courses au rayon papier toilettes), donc voici notre critique de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE signé J.J. Abrams et les 8734 actionnaires de Disney. On prévient les quelques étourdis qui n’ont pas encore vu la chose : ça spoile sévère !
Malgré un accueil démesurément enthousiaste de la part de la critique dite institutionnelle, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE affronte depuis sa sortie un mur de résistance sur Internet émanant de ceux qu’on appelle « les fans », une communauté en réalité difficilement identifiable si on ne prend pas le temps de déterminer ce qui lui confère ce statut dans un monde où tout le monde est plus ou moins « fan de STAR WARS ». Et à y regarder de près, une grande partie des reproches formulés par ces « fans » à l’encontre de ce nouveau film (comédiens parfois en roue libre, intrigue simpliste, multiples incohérences, recours à trop de Deus Ex machina, etc.) pourraient être retrouvés à l’identique dans la presse de 1977. Ce qui aurait changé en quatre décennies est la répartition des rôles, avec une institution qui promeut ce nouveau film que la fanbase écarte avec dédain. Ce qui n’est certainement pas hasardeux. La critique la plus impartiale de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE ne pourrait être conçue que par une personne n’ayant jamais vu LA GUERRE DES ÉTOILES mais qui soit tout de même familière des techniques et de l’Histoire du cinéma. Or, les probabilités qu’une telle personne puisse exister sur Terre sont quasi-nulles. C’est bien ce qui rend la contextualisation absolument incontournable lorsqu’on approche la critique de n’importe quel film de cette saga. Car malgré la dizaine de milliers de mensonges (par ignorance) commis chaque année par les médias, LA GUERRE DES ÉTOILES reste à jamais le plus grand succès « spontané » en salles de tous les temps et très certainement le film le plus vu par les deux dernières générations ; une œuvre qui engage plus que sa simple qualité de film puisqu’elle définit automatiquement, avec une dizaine d’autres films, l’idée même de cinéma à l’échelle de la planète.
Cette contextualisation oblige donc à rappeler ce qu’est à l’origine cette spontanéité de LA GUERRE DES ÉTOILES : un film non attendu, non évènementiel car parfaitement anachronique à l’époque qui le vit naître. Le caprice d’un jeune auteur réputé expérimental et qui fut originellement budgété à 3,5 millions de dollars, avant dépassements. Un « truc à la Flash Gordon » comme l’appelait Ned Tannen chez Universal, qui refusa ce projet si peu conforme aux attentes du public. Un « film de Noël avec un chien géant » comme le surnommèrent certains cadres dubitatifs de la 20th Century Fox. Ce n’est qu’en ayant bien à l’esprit sa « petitesse » et son « insignifiance » originelle que l’on peut commencer à mesurer l’anomalie que représente le « phénomène STAR WARS ». Le succès de l’année 1977 pour la Fox aurait dû être DE L’AUTRE CÔTÉ DE MINUIT, avec Marie-France Pisier, et certainement pas une histoire de conflit galactique. Si LA GUERRE DES ÉTOILES est souvent cité comme une date-clé, une sorte d’année zéro de la culture geek, c’est parce que l’éclosion anormale de son succès à la fin-mai, l’affluence stupéfiante des premiers jours, mit en lumière cette communauté de fadas d’informatique, de maths, d’astronomie et de fantasy, qui existait sous le radar depuis une dizaine d’années. Qu’on le veuille ou non, LA GUERRE DES ÉTOILES en tant que phénomène leur appartient. Il fut leur tract, leur banderole, le film qui chantait leurs aspirations en rupture brutale avec l’époque. L’immense public qui vint en salle durant l’été 1977 ne fit que suivre le buzz initié par cette manifestation. Et ce que la presse de l’époque ne parvenait pas à saisir, même avec la meilleure volonté (pas plus qu’elle ne semble l’avoir pleinement saisi aujourd’hui), c’était précisément la nature de cette aspiration. Pourquoi cette résurgence triomphale des aspects les plus « campy », les plus désuets, de la culture pulp des années 20 et 30 ? L’Amérique du Vietnam et du Watergate avait remisé ses John Carter, ses Buck Rogers et ses Flash Gordon au fond du jardin, dans la caisse des idéaux fantaisistes d’un autre temps. LA GUERRE DES ÉTOILES les ravivait avec force.
Entre les 37 écrans qui accueillirent le film de George Lucas en mai 1977 et les 4000 et quelques écrans réservés au premier week-end de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, quatre décennies se sont écoulées à travers lesquelles ces aspirations se sont inscrites dans la réalité du monde. Le rôle historique de ces geeks, qui firent émerger LA GUERRE DES ÉTOILES de son terrier, aura été d’assurer la transition entre le XXème et le XXIème siècle, en concevant sur le plan pratique la révolution informatique et la société de l’information et, sur le plan idéologique, le goût pour l’exploration de vastes univers imaginaires comme terreaux d’expérimentation des possibles ainsi qu’un aperçu des univers parallèles et de la pensée analogique que cette nouvelle société nous impose. Malheureusement, comme tout groupe culturel dont l’impact sur le monde est quantifiable, les geeks contemplent aujourd’hui le renversement de valeurs auquel a mené leur révolution. Leur rêve d’un « power to the people » assuré par le protocole de machines interconnectées ne dépendant pas d’un pouvoir central a fini par générer une concentration délirante du pouvoir en son centre. Leur élan new-age vers une libération de la parole se conclut par la plus effroyable machine de surveillance des masses jamais imaginée. Il était inévitable que, par analogie, la saga STAR WARS épouse ce retournement.
Avant d’aller plus loin, il est important d’identifier les cibles. Dès l’annonce de l’écriture de cet ÉPISODE VII, il était évident que la productrice Kathleen Kennedy et que le réalisateur J.J. Abrams ne bénéficieraient que d’une marge de manœuvre abominablement réduite. La franchise STAR WARS a été acquise à hauteur de quelques milliards de dollars par le studio Disney dans le but avoué d’en calquer l’exploitation sur le modèle des adaptations des super-héros Marvel, c’est-à-dire une mainmise absolue et transmédiatique sur tout cet univers avec pour seul objectif le contentement des actionnaires, autrement dit une rentabilité massive et immédiate qui se doit de multiplier au moins par deux ou trois les résultats plutôt décevants de STAR WARS : ÉPISODE II – L’ATTAQUE DES CLONES et STAR WARS : ÉPISODE III – LA REVANCHE DES SITH. Quels que soient les désirs éventuels de fanboy de J.J. Abrams, ils ne sont qu’une cinquième roue du carrosse. L’orientation créative de cet épisode ne peut se faire qu’avec le nouveau format des études de marché. Autrement dit, chaque fantasme, chaque prise de bec, chaque délire des fans sur les forums Internet (anglo-saxons) y devient un commandement ; et l’on imagine Lawrence Kasdan googliser frénétiquement pour savoir comment Han Solo ou la Princesse Leïa, des personnages qu’il a lui-même contribué à définir, sont censés s’exprimer pour satisfaire l’omniscience autoproclamée de la fanbase. Si tant de spectateurs ont eu la sensation d’avoir affaire à une fan-fiction en découvrant STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, c’est une tare qui était inscrite génétiquement dans le projet avant même sa mise en œuvre. De toute évidence, l’attachement des fans au « used space » du design de Ralph McQuarrie, leur méfiance vis-à-vis du bestiaire numérique, sont des aspects fanboy que J.J. Abrams partage explicitement. Car la détestation de la prélogie s’est en effet cristallisée autour de ces deux aspects finalement secondaires (le design et le numérique) plutôt que de reconnaître avec simplicité que les épisodes I, II et III étaient d’abord monstrueusement cons et condamnaient de fait n’importe quel design ou effet spécial à participer de l’hérésie ambiante. Mais le recours au « used space » ou aux animatroniques dans ce nouvel épisode n’est plus un choix créatif dépendant des attentes commerciales. Il s’inscrit directement dans la stratégie nostalgique du studio Disney qu’on pourrait qualifier de « cinéma doudou » (©L’ouvreuse) et destiné à couvrir tout film contemporain d’un assaisonnement à base de portion d’enfance fantasmée. L’essentiel de la fan-fiction fonctionne sur ce mouvement régressif, mais ce rôle n’est théoriquement pas dévolu aux fictions censées nourrir les fans.
LA GUERRE DES ÉTOILES, comme nous l’avons vu, était un film d’auteur par défaut, livré à lui-même par un studio qui s’en désintéressait et n’attendait de lui aucun exploit. Plus important, les épisodes V, VI et I, II, III étaient des productions in-dé-pen-dantes, un aspect fondamental à la compréhension de l’univers STAR WARS dans l’enceinte hollywoodienne, et qui a été trop peu souvent rappelé par les médias tant il ne cadrait pas avec leur vision binaire de cette industrie. Ainsi, lorsque George Lucas « commet » la prélogie, il n’y a aucune hiérarchie pour lui imposer des directions. En tant qu’auteur, réalisateur et producteur, il a effectivement toute liberté pour partir en vrille, trahir ses fans, désoler les actionnaires de la Fox et laisser les grandes surfaces se sur-stocker de millions de figurines qui ne se vendront jamais. Lui seul peut être tenu pour responsable de la déroute artistique. Alors que contractuellement, historiquement, et commercialement, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE est le premier STAR WARS entièrement planifié dans ses moindres recoins par les intérêts d’une major. Kathleen Kennedy et J.J. Abrams ne peuvent être tenus pour les principaux responsables de cet état de fait, tout au plus des complices plus ou moins consentants. Il demeure un aspect qui n’est pas forcément un problème dans le cadre d’une franchise comme STAR WARS mais qu’il est tout de même nécessaire de rappeler : J.J. Abrams n’est pas un cinéaste. Sur le plan créatif, il est originellement un showrunner, quelqu’un qui pense en termes de récit et d’orientation globale (un rôle plus souvent attribué au producteur dans le cinéma hollywoodien) mais chez qui la mise en images se résume à cela : de la simple mise en images. C’est ce que l’on appelle un shooter. Depuis l’époque de la série ALIAS, son style de mise-en-scène n’a pas évolué d’un iota car il n’en a pas besoin. Héritier des techniques de couverture optimale enseignée dans les bonnes écoles, la méthode d’Abrams a vocation exclusive à servir la Bible que constitue le scénario, d’une façon économe et dynamique, sans que jamais n’interfère le moindre sous-texte ou double sens périphérique. C’est pourquoi de nombreuses séquences de STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, peu signifiantes sur le plan scénaristique, auront été déjà vues à l’identique dans ses films précédents. Les plans de Rey filant sur son vaisseau le long des carcasses de destroyers géants étaient déjà visibles dans STAR TREK (pour ceux qui s’en souviennent). La course effrénée de Rey et Finn pour échapper au bombardement du marché de Jakku reprend des travellings de MISSION : IMPOSSIBLE 3 (pour ceux qui s’en souviennent). Le premier vol du faucon millénaire, poursuivi par des chasseurs TIE dans les entrailles du Destroyer, rappelle une séquence de STAR TREK : INTO DARKNESS (pour ceux qui s’en souviennent). Les deux plans-séquence qui rythment le passage sur la planète Takodana (l’arrivée dans la simili-cantina et le vol circulaire du X-wing autour du champ de bataille) ne dépassent pas, en ambition et en chorégraphie, la pauvreté scénique de SUPER 8 (pour ceux qui s’en souviennent). Quant à l’horrible très longue focale en hélicoptère qui conclut le film en unissant Rey à Luke, elle avait déjà été affreusement utilisée par George Lucas sur STAR WARS – ÉPISODE II : L’ATTAQUE DES CLONES et elle fait écho rien moins qu’à une centaine de documentaires montagnards paresseux. Cette énumération n’a pas vocation à accabler Abrams de tous les maux mais à expliquer le fait qu’il ne puisse se détacher du commandement de sa hiérarchie en faisant dérailler une œuvre pré-calculée grâce à une mise en scène subtile ou à double-fond (comme l’ont fait autrefois tant de cinéastes mavericks dans l’enceinte rigide des studios). Si la prélogie de Lucas nous avait infligé une mise en scène scolaire et passéiste à base de plans d’ensemble-plans rapprochés-champs/contrechamps, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE ne nous inflige rien de plus ou de moins que ce que à quoi nous a habitué le cahier des charges télévisuel de ces dernières années.
Et pourtant, quelque chose semblait timidement se produire, d’un point de vue scénaristique et scénographique, dans les toutes premières minutes du film. Le plan iconique d’ouverture sur un destroyer s’amuse à dialoguer avec son illustre ancêtre en un effet d’éclipse suffisamment inattendu pour ne pas être déférent. La présentation du personnage de Poe devisant avec Lor San Tekka n’a rien de stupéfiant en soi mais elle génère certains des mini-frissons que pouvaient provoquer la découverte de nouveaux protagonistes dans les romans de l’Univers étendu. Enfin, l’identité et le conflit intérieur du Stormtrooper Finn sont caractérisés par une triple marque de sang qu’il porte sur son casque (peut-être la seule idée réellement cinématographique du film). Toute cette première séquence d’invasion et d’attaque du hameau par les troupes du Premier Ordre ont d’étranges réminiscences de l’œuvre d’Osamu Tezuka, à la fois dans la radicalité du massacre d’innocents et dans la fantasmagorie du Mal implacable suggéré par l’armure rutilante du Captain Phasma. On se souvient que George Lucas avait calqué la structure de son récit originel sur LA FORTERESSE CACHÉE d’Akira Kurosawa. On se surprend alors à imaginer que la nouvelle équipe se soit à son tour ingénieusement tournée vers le Japon et sa pléthore de modèles narratifs trop rarement importés. Et si Rey, dans son exploration patiente des tréfonds de vaisseaux du passé, émulait le personnage de NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT ? Et si la tentative d’évasion foireuse de Poe et Finn nous menait au comique palpitant d’un CONAN, LE FILS DU FUTUR ? Et si le besoin impérieux qu’a l’ouvrier Finn de protéger Rey d’un danger qu’il a encore mal identifié émulait le brave Pazu du CHÂTEAU DANS LE CIEL ? Faux espoirs.
La seule « nouveauté » à laquelle nous invite alors le récit est d’ordre strictement sociologique (et donc périphérique au récit). « Les héros de STAR WARS seront dorénavant une femme et un black » semble nous dire avec fierté l’équipe de Disney. Or, cette héroïne féminine avait déjà été évoquée par Gary Kurtz et George Lucas, en vue d’un hypothétique ÉPISODE VII, à l’époque de leur conception de REVENGE OF THE JEDI. Cette héroïne aurait dû être la sœur cachée de Luke Skywalker et les traits, les activités de scavenger et l’accoutrement de Rey semblent directement issues de ces réunions de travail (après le clash et le départ de Gary Kurtz, Lucas décidera de faire de Leïa la sœur de Luke dans le retitré LE RETOUR DU JEDI, initiant un sous-texte incestueux dont on se serait bien passés). Enfin l’annonce du personnage black de Finn entraîna en début d’année une polémique débile dans les provinces consanguines aux USA, où personne n’a jamais entendu parler de Lando Calrissian. Toujours est-il que sur le plan sociologique (et donc périphérique au récit), cette « nouveauté » s’avère bien plus embarrassante que prévue. Finn se révèle être une sorte d’esclave en fuite, réduit à plonger sa tête dans un abreuvoir à bestiaux, et que nos héros soupçonneront d’abord d’avoir volé un blouson à l’homme blanc (?)… bref un Kunta Kinté… dans un blockbuster de 2015… Quant à Rey, une fois passées les présentations miyazakiennes évoquées ci-dessus, elle se révèle être probablement l’un des pires lead-characters de ces vingt dernières années. Zéro conflit, zéro choix moral, zéro erreur, elle se verra condamnée durant tout le reste du métrage à subir des évènements qu’elle n’a jamais initiés, avec pour seule promesse d’arc narratif un pauvre flashback directement hérité des séries télé qui ne savent pas du tout où elles vont. Ses seules impulsions consistent à trop kiffer de rencontrer des gens célèbres et à s’inscrire dans une quête permanente de la validation paternelle en prouvant à Han Solo ses compétences de pilote mécanicienne. En résumé : Kunta Kinté et une potiche ballotée par les évènements. Étonnant de voir que les curés des réseaux sociaux, toujours prompts à condamner le racisme et la misogynie de la production hollywoodienne, ne se soient pas sentis foudroyés par ce doublé (et par simple politesse, nous éviterons de nous attarder sur le sort parfaitement débile réservé au personnage féminin pourtant prometteur de Phasma).
Le plus embarrassant est pourtant à venir. Dès l’apparition de Han Solo et de Chewbacca, le film se met définitivement sur les rails du Doudouland cher au studio Disney. Passons sur le coup de bol qui autorise cette rencontre entre les héros et le légendaire mercenaire (le film est truffé de tels raccourcis et LA GUERRE DES ÉTOILES en usait déjà sans que cela nuise à son déroulé) pour plutôt s’appesantir sur l’incapacité des auteurs à réinventer ce personnage, jusqu’à le rétrograder au rang de ses lointains descendants, en l’occurrence le Peter Quill des GARDIENS DE LA GALAXIE. La gêne intense qui s’empare de nous dans la séquence, parfaitement inutile voire sinistrement mal foutue, qui s’ensuit (scénographie à deux portes et monstres incompréhensibles), est un peu l’équivalent de ce que ressentirait un fan de James Bond en voyant l’agent 007 tenter d’imiter Austin Powers. Si l’on pouvait craindre jusque-là que les auteurs ne pêchent par excès de déférence et de fanboyisme, voici qu’ils nous indiquent soudain ne pas comprendre grand chose à l’univers qu’ils souhaitent faire revivre. Cette sensation de gêne acide grandira avec la révélation progressive du cercle familial Han Solo / Leïa / Kylo Ren, en un absurde mélodrame où un couple de post-soixante-huitards divorcés (les versions galactiques d’André Dussolier et Sabine Azéma) se désespèrent de l’immaturité de leur fils unique, Tanguy le colérique. Et la confirmation de ce plus-qu’à-peu-près thématique s’imposera dans la séquence de maîtrise expresse de la Force dont fait preuve Rey, quelques minutes après avoir entendu son évocation. À cet instant, le spectateur lambda est en droit de se demander si quelqu’un parmi l’équipe de ce nouvel épisode a déjà vu un film de la saga STAR WARS. Peut-être pas les films en entier mais des bribes, des bandes-annonces, des pochettes de figurines, tant la servilité à reproduire des « images-clés » ne donne même plus lieu à de l’étonnement : une planète désertique, une planète enneigée, une planète forestière. Voilà pour le dépaysement galactique ! La saga qui a ouvert en grand l’imaginaire d’au moins trois générations, en générant un vaste univers à explorer, se retrouve réduite à deux-trois niveaux obligatoires, tel le moins imaginatif des jeux de plateforme.
Tony Zhou, ou ce qui est arrivé de mieux à la cinéphilie internaute ces dernières années, a expliqué très clairement en quoi ce nouveau STAR WARS ressemblait surtout à une tentative de réparer LE RETOUR DU JEDI, film qui scellait la mainmise régressive de George Lucas sur son univers et qui préfigurait avec vingt ans d’avance la déroute narrative de la prélogie. En offrant à Han Solo la mort qu’il aurait dû connaître lorsque Gary Kurtz était encore sur le projet, J.J. Abrams et Lawrence Kasdan semblent faire un remake du parcours de ce personnage dans un film sorti il y a plus de trente ans, avec pour seul objectif émotionnel cette séquence de mort autrefois promise à Harrison Ford et inconsciemment attendue par les fans ; une séquence évidemment superfétatoire aujourd’hui. Or non seulement ce pic émotionnel n’en est pas un, la faute à une narration indécise qui n’a jamais choisi ses priorités dans les séquences précédentes, mais la scène se permet en plus d’en appeler à la mémoire qu’a le public d’un autre moment d’émotion, à savoir la mort de Gandalf dans LE SEIGNEUR DES ANNEAUX – LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU. La topographie est respectée : le pont de Kazad-dum, le gouffre de la Moria, Kylo Ren dans le rôle du Balrog, jusqu’au cri de révolte de Rey / Frodon face à ce corps qui chute, et à qui il ne manque plus que le ralenti. D’une façon plus globale, on pourrait presque s’amuser à décrypter tout STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE comme une tentative d’auto-légitimation de J.J. Abrams, à qui l’on vient de confier un monument de cette culture pop dans laquelle il s’est développé et qui choisit de se confondre en excès d’humilité : le côté ébahi de Rey découvrant ses idoles ; l’impuissance adolescente de Kylo Ren à se hisser à la hauteur de son modèle de vilain ; ou même la petite portion de carte que BB-8 vient ajouter à la grande carte d’un R2D2 qui le domine ; tous ces éléments pourront faire la joie des décryptages auteurisants mais ils ne feront que rajouter quelques clous à un cercueil déjà bien scellé, celui d’un échec opérant à de multiples niveaux qui dépassent celui de son principal signataire.
Car en définitive, STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, premier STAR WARS entièrement déterminé par le désir d’une major, n’a qu’une seule fonction : celle d’être une publicité pour la marque STAR WARS ©, une tentative de « réveil » de la fanbase par la stimulation nostalgique en vue de préparer la déferlante transmédiatique de ces dix prochaines années. Et comme toute publicité, le film n’a rien d’autre à proposer que du concept dénué de substance : une Force qui ne l’est que parce qu’on l’a nommée ainsi, ou encore des sabres-laser qui transforment ceux qui les touchent en de redoutables escrimeurs, c’est-à-dire de purs simulacres ou, pour paraphraser le nihilisme selon Baudrillard « des croix qui suggèreraient, au fond, que Dieu n’a jamais existé ». Ce n’est pas une erreur de parcours, un échec isolé, mais bel et bien la confirmation que l’anomalie que représentait originellement STAR WARS a parfaitement été digérée par toute l’institution qu’il avait autrefois mise en échec. Pour preuve préalable, les six dernières années du box-office international, quasi-intégralement constituées de « franchises geeks », sont devenus l’antichambre de l’Enfer et la destruction méthodique de l’imaginaire que beaucoup des gourous de cette culture avaient prophétisé. Des « franchises geeks » à ce point soutenues par le cynisme des chiffres et la régression fœtale de toute une société qu’elles asphyxient les meilleurs créateurs et étranglent jusqu’à l’évocation des sources pulp de toute cette culture. Et s’il se trouve des spectateurs qui auront sincèrement apprécié le film de J.J. Abrams en dehors de tout contexte, il reste que STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE, du studio Disney, est ontologiquement une négation de STAR WARS ainsi que le symbole d’une réelle capitulation.
http://www.capturemag.net/etat-critique/un...veau-desespoir/
http://www.capturemag.net/etat-critique/un...veau-desespoir/
STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, premier STAR WARS entièrement déterminé par le désir d’une major, n’a qu’une seule fonction : celle d’être une publicité pour la marque STAR WARS ©, une tentative de « réveil » de la fanbase par la stimulation nostalgique en vue de préparer la déferlante transmédiatique de ces dix prochaines années.
STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE, premier STAR WARS entièrement déterminé par le désir d’une major, n’a qu’une seule fonction : celle d’être une publicité pour la marque STAR WARS ©, une tentative de « réveil » de la fanbase par la stimulation nostalgique en vue de préparer la déferlante transmédiatique de ces dix prochaines années.
Il aurait pu s'arrêter là et s'éviter bien des hémorroïdes.
Le ton et l'approche essaye de changer des critiques simplistes qu'on peut voir un peu partout mais ce n'est pas pour le mieux
J'espère tout de même que pour les 4 prochains il évitera de se faire du mal et n'ira pas voir les immondices de Disney au cinéma.
Sinon tout ça m'a donné envie de mater la série animée the Clone Wars (pas mal du tout au passage), et la puissance de Mace Windu... Ils ont vraiment sous-utilisé ce personnage dans la prélogie.
Perso je trouve que le Ginger General a le meilleur potentiel comme ennemi principal pour cette nouvelle trilogie.
J'espere que la love story entre Finn et Rey ne sera pas trop chiante dans le prochain film
J'espere que la love story entre Finn et Rey ne sera pas trop chiante dans le prochain film
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
