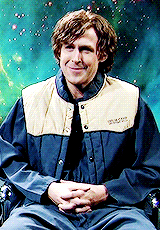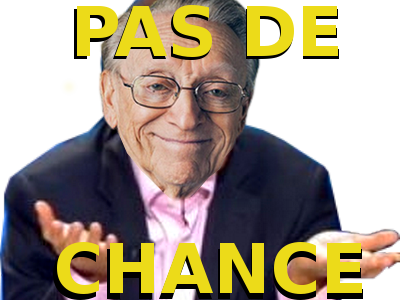Barrer la porte aussi!
Version complète : Twitter: 3 pénalités. Is a joke. Cool!
Forum de Culture PSG > Les forums du Bas : Parce que la communauté ne parle pas que de foot > Forum Général
Pages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
Ah oui, tout à fait! 
Barrer la porte aussi!
Barrer la porte aussi!
Il y a bcp de vieux français ou encore des expressions toujours utilisées en province mais pas à Paris (comme barrer la porte par ex)
Ah oui!? Tiens, je ne savais pas...
J’imaginais que cela venait de l’anglais, « lock the door »
J’imaginais que cela venait de l’anglais, « lock the door »
Ça ne vient pas surtout du passé quand on mettait une barre pour verrouiller une porte ?
Oui, mais j'imagine que c'est toujours comme ça dans leurs fermes du Poitou.
Ce que je voulais dire c'est que l'expression a toujours cours en Vendée et dans le Poitou plus généralement.
https://twitter.com/MrFernandNaudin/status/1145330365176983552
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
https://twitter.com/1Xtra/status/1145443443415617536
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
le meilleur TS qu'on ai vu
J'ai rien compris au tweet ni à ce que tu dit
L'heure tardive avec la chaleur 
Mais je connaissais pas la chanson avant ce tweet ni même me chanteur
Mais je connaissais pas la chanson avant ce tweet ni même me chanteur
https://twitter.com/MrFernandNaudin/status/1145330365176983552
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
https://twitter.com/MrFernandNaudin/status/1145330365176983552
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Je serai tenté de dire oui 
Là, pour le coup, avec tomber en amour, j’ai un exemple très concret...Faudrait creuser la question avec d’autres expressions
Là, pour le coup, avec tomber en amour, j’ai un exemple très concret...Faudrait creuser la question avec d’autres expressions
« passer à travers », « ça a pas de sens », « bienvenue » (pour de rien), j’en oublie mais le québécois est rempli de ces traductions littérales.
Plus qu’un simple mélange linguistique, c’est le produit de deux choses. D’abord du fait qu’a l’image de l’anglais, et à plus forte raison peut-être de l’anglais américain, le français québécois est historiquement très « oralisé ». La culture de la stabilisation des règles (y compris grammaticales) par l’ecrit y est moins forte que dans les traditions européennes. Ce qui explique d’ailleurs en partie les grandes facultés orales de nombreux québécois, qui peuvent être assez verbeux dans leur quotidien, sans parler même de la culture de « l’impro » que l’on retrouve très ancrée dans les cursus de théâtre et de comédien, là les québécois ont, en moyenne, un écrit beaucoup plus défaillant : plein de fautes de grammaire à l’ecrit, d’accords aussi, y compris chez des gens très qualifiés (à l’Université notamment, et je ne parle pas que des étudiants..)
Et dans ce cadre-là, ces modes de langage traduisent aussi, et plus fondamentalement, les restes d’une domination séculaire de l’anglais sur le français, qui a structuré - et structure encore - l’histoire du Canada. Cette domination est combattue tant bien que mal depuis les années 1970, avec les grandes lois de francisation, à l’école d’abord et dans l’espace public, incluant les administrations publiques. C’est ce combat impossible à achever pleinement qui explique que d’un côté tout est très frénétiquement francisé (au-delà des mots techniques, qu’on retrouve à des degrés divers dans tous les domaines, le plus étonnant pour les non-initiés étant les titres de film, en raison des lois sur l’affichage : Frisson pour Scream, Histoire de jouet, etc. ; ou les noms de resto pour la même raison : PFK pour poulet frit kentucky) ; mais que de l’autre subsiste l’anglais dans les formes oralisées, qui sont les plus inconscientes et les plus difficiles à maîtriser (les traductions littérales en étant le meilleur exemple). Il n’est pas à exclure que le militantisme linguistique diminuant chez les nouvelles générations, et l’influence de l’anglais augmentant, ces formes se multiplient à l’avenir, ce qui en retour provoquera une volonté frénétique (et compréhensible) de francisation par les élites francophones. Dans les écoles secondaires (collège), il n’est pas rare que les ados parlent anglais à la récré et reviennent au français dans les couloirs et évidemment dans la classe, l’usage de l’anglais étant souvent très formellement interdit dans l’enceinte des établissements francophones.
« passer à travers », « ça a pas de sens », « bienvenue » (pour de rien), j’en oublie mais le québécois est rempli de ces traductions littérales.
Plus qu’un simple mélange linguistique, c’est le produit de deux choses. D’abord du fait qu’a l’image de l’anglais, et à plus forte raison peut-être de l’anglais américain, le français québécois est historiquement très « oralisé ». La culture de la stabilisation des règles (y compris grammaticales) par l’ecrit y est moins forte que dans les traditions européennes. Ce qui explique d’ailleurs en partie les grandes facultés orales de nombreux québécois, qui peuvent être assez verbeux dans leur quotidien, sans parler même de la culture de « l’impro » que l’on retrouve très ancrée dans les cursus de théâtre et de comédien, là les québécois ont, en moyenne, un écrit beaucoup plus défaillant : plein de fautes de grammaire à l’ecrit, d’accords aussi, y compris chez des gens très qualifiés (à l’Université notamment, et je ne parle pas que des étudiants..)
Et dans ce cadre-là, ces modes de langage traduisent aussi, et plus fondamentalement, les restes d’une domination séculaire de l’anglais sur le français, qui a structuré - et structure encore - l’histoire du Canada. Cette domination est combattue tant bien que mal depuis les années 1970, avec les grandes lois de francisation, à l’école d’abord et dans l’espace public, incluant les administrations publiques. C’est ce combat impossible à achever pleinement qui explique que d’un côté tout est très frénétiquement francisé (au-delà des mots techniques, qu’on retrouve à des degrés divers dans tous les domaines, le plus étonnant pour les non-initiés étant les titres de film, en raison des lois sur l’affichage : Frisson pour Scream, Histoire de jouet, etc. ; ou les noms de resto pour la même raison : PFK pour poulet frit kentucky) ; mais que de l’autre subsiste l’anglais dans les formes oralisées, qui sont les plus inconscientes et les plus difficiles à maîtriser (les traductions littérales en étant le meilleur exemple). Il n’est pas à exclure que le militantisme linguistique diminuant chez les nouvelles générations, et l’influence de l’anglais augmentant, ces formes se multiplient à l’avenir, ce qui en retour provoquera une volonté frénétique (et compréhensible) de francisation par les élites francophones. Dans les écoles secondaires (collège), il n’est pas rare que les ados parlent anglais à la récré et reviennent au français dans les couloirs et évidemment dans la classe, l’usage de l’anglais étant souvent très formellement interdit dans l’enceinte des établissements francophones.
Plus qu’un simple mélange linguistique, c’est le produit de deux choses. D’abord du fait qu’a l’image de l’anglais, et à plus forte raison peut-être de l’anglais américain, le français québécois est historiquement très « oralisé ». La culture de la stabilisation des règles (y compris grammaticales) par l’ecrit y est moins forte que dans les traditions européennes. Ce qui explique d’ailleurs en partie les grandes facultés orales de nombreux québécois, qui peuvent être assez verbeux dans leur quotidien, sans parler même de la culture de « l’impro » que l’on retrouve très ancrée dans les cursus de théâtre et de comédien, là les québécois ont, en moyenne, un écrit beaucoup plus défaillant : plein de fautes de grammaire à l’ecrit, d’accords aussi, y compris chez des gens très qualifiés (à l’Université notamment, et je ne parle pas que des étudiants..)
Et dans ce cadre-là, ces modes de langage traduisent aussi, et plus fondamentalement, les restes d’une domination séculaire de l’anglais sur le français, qui a structuré - et structure encore - l’histoire du Canada. Cette domination est combattue tant bien que mal depuis les années 1970, avec les grandes lois de francisation, à l’école d’abord et dans l’espace public, incluant les administrations publiques. C’est ce combat impossible à achever pleinement qui explique que d’un côté tout est très frénétiquement francisé (au-delà des mots techniques, qu’on retrouve à des degrés divers dans tous les domaines, le plus étonnant pour les non-initiés étant les titres de film, en raison des lois sur l’affichage : Frisson pour Scream, Histoire de jouet, etc. ; ou les noms de resto pour la même raison : PFK pour poulet frit kentucky) ; mais que de l’autre subsiste l’anglais dans les formes oralisées, qui sont les plus inconscientes et les plus difficiles à maîtriser (les traductions littérales en étant le meilleur exemple). Il n’est pas à exclure que le militantisme linguistique diminuant chez les nouvelles générations, et l’influence de l’anglais augmentant, ces formes se multiplient à l’avenir, ce qui en retour provoquera une volonté frénétique (et compréhensible) de francisation par les élites francophones. Dans les écoles secondaires (collège), il n’est pas rare que les ados parlent anglais à la récré et reviennent au français dans les couloirs et évidemment dans la classe, l’usage de l’anglais étant souvent très formellement interdit dans l’enceinte des établissements francophones.
Tu peux rajouter la classe politique, une honte. Mais bon, ils pourront au moins faire valoir que ça les rapproche du peuple.
Hormis les journalistes de Radio Canada, ça reste un pays très pauvre mais qui essaie tant bien que mal de préserver sa langue.
Tu peux rajouter la classe politique, une honte. Mais bon, ils pourront au moins faire valoir que ça les rapproche du peuple.
Hormis les journalistes de Radio Canada, ça reste un pays très pauvre mais qui essaie tant bien que mal de préserver sa langue.
Hormis les journalistes de Radio Canada, ça reste un pays très pauvre mais qui essaie tant bien que mal de préserver sa langue.
Je limiterais pas la "richesse" d'un pays aux capacités (ortho)graphiques moyennes de ses habitants.
Sans bien sûr qu'on puisse comparer à ce qui se produit en France, il y a de très belles et bonnes choses en cinéma, en littérature, en poésie, en musique, en théatre aussi et en arts vivants.. Montréal est pour le coup une vraie ville de culture, à la fois entrée sur la francophonie québécoise et grande métropole nord-américaine, ce qui lui donne un statut et une saveur vraiment singulière et finalement très "riche".
« passer à travers », « ça a pas de sens », « bienvenue » (pour de rien), j’en oublie mais le québécois est rempli de ces traductions littérales.
Plus qu’un simple mélange linguistique, c’est le produit de deux choses. D’abord du fait qu’a l’image de l’anglais, et à plus forte raison peut-être de l’anglais américain, le français québécois est historiquement très « oralisé ». La culture de la stabilisation des règles (y compris grammaticales) par l’ecrit y est moins forte que dans les traditions européennes. Ce qui explique d’ailleurs en partie les grandes facultés orales de nombreux québécois, qui peuvent être assez verbeux dans leur quotidien, sans parler même de la culture de « l’impro » que l’on retrouve très ancrée dans les cursus de théâtre et de comédien, là les québécois ont, en moyenne, un écrit beaucoup plus défaillant : plein de fautes de grammaire à l’ecrit, d’accords aussi, y compris chez des gens très qualifiés (à l’Université notamment, et je ne parle pas que des étudiants..)
Et dans ce cadre-là, ces modes de langage traduisent aussi, et plus fondamentalement, les restes d’une domination séculaire de l’anglais sur le français, qui a structuré - et structure encore - l’histoire du Canada. Cette domination est combattue tant bien que mal depuis les années 1970, avec les grandes lois de francisation, à l’école d’abord et dans l’espace public, incluant les administrations publiques. C’est ce combat impossible à achever pleinement qui explique que d’un côté tout est très frénétiquement francisé (au-delà des mots techniques, qu’on retrouve à des degrés divers dans tous les domaines, le plus étonnant pour les non-initiés étant les titres de film, en raison des lois sur l’affichage : Frisson pour Scream, Histoire de jouet, etc. ; ou les noms de resto pour la même raison : PFK pour poulet frit kentucky) ; mais que de l’autre subsiste l’anglais dans les formes oralisées, qui sont les plus inconscientes et les plus difficiles à maîtriser (les traductions littérales en étant le meilleur exemple). Il n’est pas à exclure que le militantisme linguistique diminuant chez les nouvelles générations, et l’influence de l’anglais augmentant, ces formes se multiplient à l’avenir, ce qui en retour provoquera une volonté frénétique (et compréhensible) de francisation par les élites francophones. Dans les écoles secondaires (collège), il n’est pas rare que les ados parlent anglais à la récré et reviennent au français dans les couloirs et évidemment dans la classe, l’usage de l’anglais étant souvent très formellement interdit dans l’enceinte des établissements francophones.
Plus qu’un simple mélange linguistique, c’est le produit de deux choses. D’abord du fait qu’a l’image de l’anglais, et à plus forte raison peut-être de l’anglais américain, le français québécois est historiquement très « oralisé ». La culture de la stabilisation des règles (y compris grammaticales) par l’ecrit y est moins forte que dans les traditions européennes. Ce qui explique d’ailleurs en partie les grandes facultés orales de nombreux québécois, qui peuvent être assez verbeux dans leur quotidien, sans parler même de la culture de « l’impro » que l’on retrouve très ancrée dans les cursus de théâtre et de comédien, là les québécois ont, en moyenne, un écrit beaucoup plus défaillant : plein de fautes de grammaire à l’ecrit, d’accords aussi, y compris chez des gens très qualifiés (à l’Université notamment, et je ne parle pas que des étudiants..)
Et dans ce cadre-là, ces modes de langage traduisent aussi, et plus fondamentalement, les restes d’une domination séculaire de l’anglais sur le français, qui a structuré - et structure encore - l’histoire du Canada. Cette domination est combattue tant bien que mal depuis les années 1970, avec les grandes lois de francisation, à l’école d’abord et dans l’espace public, incluant les administrations publiques. C’est ce combat impossible à achever pleinement qui explique que d’un côté tout est très frénétiquement francisé (au-delà des mots techniques, qu’on retrouve à des degrés divers dans tous les domaines, le plus étonnant pour les non-initiés étant les titres de film, en raison des lois sur l’affichage : Frisson pour Scream, Histoire de jouet, etc. ; ou les noms de resto pour la même raison : PFK pour poulet frit kentucky) ; mais que de l’autre subsiste l’anglais dans les formes oralisées, qui sont les plus inconscientes et les plus difficiles à maîtriser (les traductions littérales en étant le meilleur exemple). Il n’est pas à exclure que le militantisme linguistique diminuant chez les nouvelles générations, et l’influence de l’anglais augmentant, ces formes se multiplient à l’avenir, ce qui en retour provoquera une volonté frénétique (et compréhensible) de francisation par les élites francophones. Dans les écoles secondaires (collège), il n’est pas rare que les ados parlent anglais à la récré et reviennent au français dans les couloirs et évidemment dans la classe, l’usage de l’anglais étant souvent très formellement interdit dans l’enceinte des établissements francophones.
Je limiterais pas la "richesse" d'un pays aux capacités (ortho)graphiques moyennes de ses habitants.
Sans bien sûr qu'on puisse comparer à ce qui se produit en France, il y a de très belles et bonnes choses en cinéma, en littérature, en poésie, en musique, en théatre aussi et en arts vivants.. Montréal est pour le coup une vraie ville de culture, à la fois entrée sur la francophonie québécoise et grande métropole nord-américaine, ce qui lui donne un statut et une saveur vraiment singulière et finalement très "riche".
Sans bien sûr qu'on puisse comparer à ce qui se produit en France, il y a de très belles et bonnes choses en cinéma, en littérature, en poésie, en musique, en théatre aussi et en arts vivants.. Montréal est pour le coup une vraie ville de culture, à la fois entrée sur la francophonie québécoise et grande métropole nord-américaine, ce qui lui donne un statut et une saveur vraiment singulière et finalement très "riche".
Propos très intéressant! Merci!
Tu as vécu à MTL n’est-ce-pas!?
Je limiterais pas la "richesse" d'un pays aux capacités (ortho)graphiques moyennes de ses habitants.
Sans bien sûr qu'on puisse comparer à ce qui se produit en France, il y a de très belles et bonnes choses en cinéma, en littérature, en poésie, en musique, en théatre aussi et en arts vivants.. Montréal est pour le coup une vraie ville de culture, à la fois entrée sur la francophonie québécoise et grande métropole nord-américaine, ce qui lui donne un statut et une saveur vraiment singulière et finalement très "riche".
Sans bien sûr qu'on puisse comparer à ce qui se produit en France, il y a de très belles et bonnes choses en cinéma, en littérature, en poésie, en musique, en théatre aussi et en arts vivants.. Montréal est pour le coup une vraie ville de culture, à la fois entrée sur la francophonie québécoise et grande métropole nord-américaine, ce qui lui donne un statut et une saveur vraiment singulière et finalement très "riche".
"Pour sûr", MTL est une super ville à vivre et très riche culturellement, mais c'est vraiment donner de la confiture aux cochons.
https://twitter.com/oasisbefruit/status/1146080576551694336
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
https://twitter.com/yerdasliability/status/1145761265056473088?s=21
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
https://twitter.com/oasisbefruit/status/1146080576551694336
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Ça aurait été énorme une canette oasis Issou, dommage.
https://twitter.com/oasisbefruit/status/1146080576551694336
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Apparemment c'est parti en baston jvc/lgbt. Internet.
J'ai pas compris la blague avec issou 
Dommage toutes ces marques qui baissent leur froc à cause de coups de pression twitter
Faut dire qu'associersson image à l'une des pires bandes de débiles du net (eux et les cheveux bleus c'est les deux faces d'une même pièce) ça me semblait être un projet risqué 
Faut dire qu'associersson image à l'une des pires bandes de débiles du net (eux et les cheveux bleus c'est les deux faces d'une même pièce) ça me semblait être un projet risqué 
C'est con parce que sur ce forum, tout les bords politiques sont représentés, y a de vrais débat constructif sur de nombreux sujets d'actualité.
Y a aussi beaucoup de troll, de talc et des topics débile mais globalement ça reste sympa et y a de très bon délire (risitas, larry silverstein, celestin, les mages noirs, le parc spirou, gilbert et ses deux sucres, les QLF, les KJ etc.....)
Ça aurait été énorme une canette oasis Issou, dommage. 
J'en aurais acheté une dizaine pourtant dieu sait que c'est dégueulasse cette merde.
« Très bon délire » avec Larry Silverstein en exemple. Mouai. C’est une façon de voir les choses hein.
C'est con parce que sur ce forum, tout les bords politiques sont représentés, y a de vrais débat constructif sur de nombreux sujets d'actualité.
Y a aussi beaucoup de troll, de talc et des topics débile mais globalement ça reste sympa et y a de très bon délire (risitas, larry silverstein, celestin, les mages noirs, le parc spirou, gilbert et ses deux sucres, les QLF, les KJ etc.....)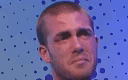
J'en aurais acheté une dizaine pourtant dieu sait que c'est dégueulasse cette merde.
Y a aussi beaucoup de troll, de talc et des topics débile mais globalement ça reste sympa et y a de très bon délire (risitas, larry silverstein, celestin, les mages noirs, le parc spirou, gilbert et ses deux sucres, les QLF, les KJ etc.....)
J'en aurais acheté une dizaine pourtant dieu sait que c'est dégueulasse cette merde.
Ah ok
C'est con parce que sur ce forum, tout les bords politiques sont représentés, y a de vrais débat constructif sur de nombreux sujets d'actualité.
Y a aussi beaucoup de troll, de talc et des topics débile mais globalement ça reste sympa et y a de très bon délire (risitas, larry silverstein, celestin, les mages noirs, le parc spirou, gilbert et ses deux sucres, les QLF, les KJ etc.....)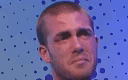
J'en aurais acheté une dizaine pourtant dieu sait que c'est dégueulasse cette merde.
Y a aussi beaucoup de troll, de talc et des topics débile mais globalement ça reste sympa et y a de très bon délire (risitas, larry silverstein, celestin, les mages noirs, le parc spirou, gilbert et ses deux sucres, les QLF, les KJ etc.....)
J'en aurais acheté une dizaine pourtant dieu sait que c'est dégueulasse cette merde.
Pauvre type
Pauvre type
Du même niveau que ça, t'es pathétique:
Allez en 5 secondes sur le forum et je te trouve quelques topics divers du politique au divertissement avec des centaines de participants
[Officiel] La France Insoumise φ
[CYCLISME] Tour de France 2019 - 106ème édition - Du 6 au 28 Juillet
[OFFICIEL] Coupe du Monde 2019 Angleterre - USA à 21h !
[Armée] Bienvenue sur le recrutement du 18-25!
"Mon rêve, c'est de devenir ECRIVAIN !"
Laisser pleurer un bébé sera maintenant INTERDIT !
Allez en 5 secondes sur le forum et je te trouve quelques topics divers du politique au divertissement avec des centaines de participants
[Officiel] La France Insoumise φ
[CYCLISME] Tour de France 2019 - 106ème édition - Du 6 au 28 Juillet
[OFFICIEL] Coupe du Monde 2019 Angleterre - USA à 21h !
[Armée] Bienvenue sur le recrutement du 18-25!
"Mon rêve, c'est de devenir ECRIVAIN !"
Laisser pleurer un bébé sera maintenant INTERDIT !
[Officiel] La France Insoumise φ
[CYCLISME] Tour de France 2019 - 106ème édition - Du 6 au 28 Juillet
[OFFICIEL] Coupe du Monde 2019 Angleterre - USA à 21h !
[Armée] Bienvenue sur le recrutement du 18-25!
"Mon rêve, c'est de devenir ECRIVAIN !"
Laisser pleurer un bébé sera maintenant INTERDIT !
On s'en branle de tes délires de chômeur.
Du même niveau que ça, t'es pathétique:
Allez en 5 secondes sur le forum et je te trouve quelques topics divers du politique au divertissement avec des centaines de participants
[Officiel] La France Insoumise φ
[CYCLISME] Tour de France 2019 - 106ème édition - Du 6 au 28 Juillet
[OFFICIEL] Coupe du Monde 2019 Angleterre - USA à 21h !
[Armée] Bienvenue sur le recrutement du 18-25!
"Mon rêve, c'est de devenir ECRIVAIN !"
Laisser pleurer un bébé sera maintenant INTERDIT !
Allez en 5 secondes sur le forum et je te trouve quelques topics divers du politique au divertissement avec des centaines de participants
[Officiel] La France Insoumise φ
[CYCLISME] Tour de France 2019 - 106ème édition - Du 6 au 28 Juillet
[OFFICIEL] Coupe du Monde 2019 Angleterre - USA à 21h !
[Armée] Bienvenue sur le recrutement du 18-25!
"Mon rêve, c'est de devenir ECRIVAIN !"
Laisser pleurer un bébé sera maintenant INTERDIT !
Quelle richesse intellectuelle, c'est bouleversant.
On s'en branle de tes délires de chômeur.
Félicitations les boys! 
Citoyen depuis bientôt 4 ans pour ma part
Citoyen depuis bientôt 4 ans pour ma part
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.