Version complète : [Sport] Cyclisme
Forum de Culture PSG > Les forums du Bas : Parce que la communauté ne parle pas que de foot > Forum Sports et Loisirs
Pages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Heureusement qu'il était affaibli sinon il mettait tous ses adversaires hors délais au Ventoux 
Enorme 
Quintana a du entendre la nouvelle puisqu'il devrait selon lequipe.fr faire le Giro plutôt que le Tour.
Quintana a du entendre la nouvelle puisqu'il devrait selon lequipe.fr faire le Giro plutôt que le Tour.

Mythique image avec la tête d'Armstrong en plus
Armstrong le cancéreux, Landis (qui a gagné avant d'être délcassé) avait une hanche en bois, Hamilton sur le podium avec une épaule fracturée, Contador qui sortait d'un AVC avant sa première victoire, et donc Froome qui était affaibli.
Une belle arnaque les cyclistes, on peut aussi parler de Ricco qui a failli se tuer en s'injectant du sang mal conservé dans son propre frigo (rien à voir avec Dario Frigo)
Une belle arnaque les cyclistes, on peut aussi parler de Ricco qui a failli se tuer en s'injectant du sang mal conservé dans son propre frigo (rien à voir avec Dario Frigo)
Citation
Froome :"J'aimerais faire Koh-Lanta"
Pas de Quintana sur le tour, Movistar l'envoi au Giro et Valverde sera le leader pour la grande boucle.
Ah ok.
Ah ok.
Oui c'était prévu comme ça.
Idem pour Rodriguez
Idem pour Rodriguez
Équipes invitées sur le Tour :
- Cofidis
- Bretagne Séché (les frères Feillu)
- Team Net App (Konig, Barta, Machado)
- IAM (Chavanel, Pineau)
- Cofidis
- Bretagne Séché (les frères Feillu)
- Team Net App (Konig, Barta, Machado)
- IAM (Chavanel, Pineau)
C'est deja decide? 
Oui, la liste des 22 équipes a été publiée aujourd'hui.
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/A...-cofidis/436044
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/A...-cofidis/436044
Pas de Quintana sur le tour, Movistar l'envoi au Giro et Valverde sera le leader pour la grande boucle.
Ah ok.
Ah ok.
En lisant les interviews des gros leaders (les plus sérieux) en ce début de saison et surtout leurs nombreux projets de tenter d'autres tours (Giro et Vuelta) que celui de juillet, je ne sais pas si c'est mon coté parano ou quoi mais j'ai comme l'impression que cette année il est acquis dans le milieu que le Tour de juillet est absolument intouchable (avec Froome "guéri" de sa "maladie"), et la plupart essaient de voir où ils pourraient ajouter une ligne à leur palmarès.
Vous en pensez quoi ?
On est même pas en février qu'il y a une avalanche de "je vais tenter autre chose que le Tour"... bizarre.
Contador est motivé en tout cas, Nibali sera présent aussi.
En lisant les interviews des gros leaders (les plus sérieux) en ce début de saison et surtout leurs nombreux projets de tenter d'autres tours (Giro et Vuelta) que celui de juillet, je ne sais pas si c'est mon coté parano ou quoi mais j'ai comme l'impression que cette année il est acquis dans le milieu que le Tour de juillet est absolument intouchable (avec Froome "guéri" de sa "maladie"), et la plupart essaient de voir où ils pourraient ajouter une ligne à leur palmarès.
Vous en pensez quoi ?
On est même pas en février qu'il y a une avalanche de "je vais tenter autre chose que le Tour"... bizarre.
Vous en pensez quoi ?
On est même pas en février qu'il y a une avalanche de "je vais tenter autre chose que le Tour"... bizarre.
Bof, Nibali a annoncé qu'il viendrait pour l'emporter en faisant impasse sur la Vuelta.
Après évidemment que Froome et sa guérison
Y'en a peut etre certains qui feraient peut etre attention a l'AFLD qui ferait du contrôle acharné cette année.
A part ça, Voeckler a dit qu'il espérait revenir pour le Tour d'Algarve, alors qu'il a chuté lourdement en janvier.
Pas sur que ça intéresse du monde mais pour info c'est les portes ouvertes du nouveau vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end, il a vraiment de la gueule 
http://velodrome-national.com/velodrome_po...hp#.UuqNvLQ_V4x
http://velodrome-national.com/velodrome_po...hp#.UuqNvLQ_V4x
En lisant les interviews des gros leaders (les plus sérieux) en ce début de saison et surtout leurs nombreux projets de tenter d'autres tours (Giro et Vuelta) que celui de juillet, je ne sais pas si c'est mon coté parano ou quoi mais j'ai comme l'impression que cette année il est acquis dans le milieu que le Tour de juillet est absolument intouchable (avec Froome "guéri" de sa "maladie"), et la plupart essaient de voir où ils pourraient ajouter une ligne à leur palmarès.
Vous en pensez quoi ?
On est même pas en février qu'il y a une avalanche de "je vais tenter autre chose que le Tour"... bizarre.
Vous en pensez quoi ?
On est même pas en février qu'il y a une avalanche de "je vais tenter autre chose que le Tour"... bizarre.
Nibali disait ça l'année dernière, il sera là cette année. Il n'y a que Quintana qui ne sera pas là comme favori.
Puisqu'on parle de Froome 
Pour Quintana cela dépendra appremment de la volonté du sponsor
https://twitter.com/michellecound/status/426057885274357760
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Pour Quintana cela dépendra appremment de la volonté du sponsor
J'avais vu la photo, bien les maillots 
Citation
Le cycliste belge Kristof Goddaert est décédé mardi à l'âge de 27 ans suite à un accident de la circulation. Alors qu'il s'entraînait, il a été victime d'une chute et a été heurté par un autobus. Goddaert courait pour la formation suisse IAM depuis l'année dernière. Il était auparavant passé par les équipes Davitamon, TopSport et AG2R-La Mondiale.
L'équipe.fr
Un grimpeur colombien (Largo) qui vient de se faire gauler au contrôle anti-dopage 
Froome qui repart sur le même rythme en gagnant l'étape et en prenant le maillot au sommet du Jabal Al Akhdhar . 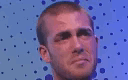
Selon les infos il a contré à 1km5 du sommet après une première attaque à 2km du sommet de Henao.:variante:
Les écarts non officiel:
Froome vanGarderen 22" Uran 33 Rodriguez 38 Gesink 47 Pozzovivo 51 Jeannesson 56 Bardet 59 Henao 1'09 Kreuziger 1'15 Nibali 1'30.
Selon les infos il a contré à 1km5 du sommet après une première attaque à 2km du sommet de Henao.:variante:
Les écarts non officiel:
Froome vanGarderen 22" Uran 33 Rodriguez 38 Gesink 47 Pozzovivo 51 Jeannesson 56 Bardet 59 Henao 1'09 Kreuziger 1'15 Nibali 1'30.
Best climbs up Jabal Al Akhdhar:
18'33, Froome (2014)
19'14, Rodriguez (2013)
19'18, Froome (2013)
19'24, Nibali (2012)

18'33, Froome (2014)
19'14, Rodriguez (2013)
19'18, Froome (2013)
19'24, Nibali (2012)
Il avait prévenu qu'il allait faire mieux 

J'ai l'impression que les medecins de l'équipe de cyclisme sur piste ont retrouvé les clés de l'armoire à pharmacie 
Ils ont aussi retrouvé un vélodrome digne de ce nom.
2 pages de Brunel consacrées à Pantani aujdui. A lire absolument.
Citation
« La vraie blessure, c’est Armstrong »
Sur un tee-shirt retrouvé par sa mère, MARCO PANTANI avait écrit tout le mal qu’il pensait d’Armstrong, passé depuis aux aveux. Retour sur une dualité qui archive toute une époque.
DIX ANS APRÈS sa tragique disparition, on peut se demander si Marco Pantani, martyrisé par la justice sportive de son pays après son exclusion du Tour d’Italie 1999 à Madonna di Campiglio, pour un taux d’hématocrite trop élevé, ne va pas récupérer à titre posthume sa juste place dans l’histoire, à l’inverse de Lance Armstrong, béatifié de son « vivant », dont les confessions de dopage tardives tempèrent aujourd’hui la vénération courtisane qu’il suscitait quand il alignait les victoires dans le Tour comme autant de trophées gagnés sur le cancer (1). On le constate en comparant l’empreinte laissée par l’Italien (avec notamment ce livre de Marco Pastonesi, Pantani était un dieu, aux éditions 66thand2nd) et les objets littéraires que s’attire le Texan, le dernier en date, coécrit par deux collaborateurs du Wall Street Journal, ayant pour titre Armstrong, itinéraire d’un salaud (éditions Hugo-Sport). Dans les années 1990, les deux hommes avaient occupé le devant de la scène, Pantani dans les grands Tours après deux raids d’anthologie en 1994, vers Merano et sur le Mortirolo, l’Américain dans les médias fascinés autant qu’aveuglés par ce combattant de l’impossible, transmué en un grimpeur d’exception par sa maladie mais plus encore, on le sait, par la grâce du « sorcier de Ferrare », Michele Ferrari. Leur rivalité fut éruptive et de courte durée, symptomatique de deux univers, deux philosophies opposées. C’est dans le Tour 2000 qu’elle se cristallisera, un Tour que l’Italien aborde dans la peau d’un paria et les revers nauséeux de Madonna di Campiglio, Armstrong régnant en despote sur un monde où tout lui était concédé. Il y avait l’antique et le moderne, l’Américain - qui repérait tous les cols du Tour, par anticipation - se faisant l’apôtre de la programmation biologique, pendant que l’Italien, chantre d’un certain empirisme, se laissait gouverner par son instinct. « À quoi bon reconnaître un col, l’important c’est de marcher fort le jour J, non? », avait-il rétorqué à son directeur sportif, Giuseppe Martinelli, désireux de l’emmener en stage dans les Alpes. Pantani préférait s’entraîner, chez lui, en Romagne, pendant plus de sept heures parfois, sans manger, en s’abreuvant à l’eau des fontaines. Ses gregarii ignoraient la longueur des entraînements. «Il aimait se tester dans la côte de San Marino de sept kilomètres et nous attendait généralement en haut, le temps de régler ses cales de chaussure, il décidait s’il y avait lieu ou non de forcer la dose» , s’amuse son ancien lieutenant, Fabiano Fontanelli, qui avait vu son leader débarquer à l’improviste, en juin 1998, sur la plage de Milano Marittima où il se trouvait en vacances à la mer.
« Il est arrivé à vélo avec un maillot à manches longues, il faisait près de 45 °C, il n’avait plus roulé depuis le Giro, quinze jours sans vélo, eh bien, ce jour-là, on a fait plus de 260 kilomètres sous un ciel de plomb… » À l’époque, Pantani incarnait le cyclisme. Il était le cyclisme. Et faisait fantasmer pas mal de ses pairs, même Armstrong. Licencié par Cofidis après l’annonce de son cancer, l’Américain était entré en contact téléphonique avec Davide Cassani (2) pour courir sous le maillot Mercatone. « C’était pendant l’hiver 1997, Lance m’a téléphoné et m’a dit : ‘’Je veux recourir chez vous, auprès de Pantani.’’ À l’époque, Marco le fascinait. » Pantani avait d’ailleurs donné son aval. Il était prêt à recueillir le Texan déjà condamné par toutes les grandes équipes à une retraite anticipée. Puis l’US Postal fit son entrée dans les pelotons et l’affaire en resta là, mais elle cautionne a posteriori la rage de Pantani quand, en juillet 2000, Armstrong lui abandonna la victoire au Ventoux avec une ostentation suspecte, comme pour mieux le rabaisser. Le Texan était-il jaloux de l’Italien, de son aura auprès du public, au point de vouloir l’humilier? Fallait-il mettre cette provocation sur l’infatuation d’un personnage égotiste, prétendant au rôle d’unique à l’exclusion des autres? Toujours est-il que Pantani ne cessera plus de distiller des critiques acidulées contre l’Américain, « un héros de bande dessinée. Une sorte de Spiderman, raillait-il avant de voir en lui le fils de celui qui est allé sur la Lune » . « Leurs relations se sont envenimées après le Ventoux, à partir de là Marco s’est mis à le haïr », se souvient Marcello Siboni, un de ses fidèles équipiers.
« Je connais la montagne, je la pratique depuis que j’ai huit ans. Sur le Ventoux, l’Américain pédalait à un rythme trop élevé, au-delà de l’humain. D’ailleurs, il n’a pas affronté la montagne face à face, mais comme s’il savait par avance dès le pied qu’il en sortirait vainqueur », récriminera l’Italien sur la RAI. Déjà, il entrevoyait l’imposture derrière le phénomène Armstrong, vanté, loué par les médias. « Il n’a jamais cru à la métamorphose du Texan, à cette fable de l’homme invincible qui triomphe du cancer et gagne le Tour », renchérit Fontanelli. Tout avait basculé en juin 1999, à Madonna di Campiglio, dans les dérèglements délictueux de son expulsion du Giro. Reclus dans sa villa, il avait scié de rage sa bicyclette. « Il se disait : “ils m’ont pris et pas lui“, et s’est mis à parler de complot. Pour Marco, c’était évident, Armstrong était protégé, on le sait maintenant », se souvient Roberto Conti. À l’époque, il était facile de tricher, de contourner les contrôles ( « J’aurais pu trouver l’escamotage », avait d’ailleurs déclaré Pantani pour sa défense). Chacun avait ses filières, ses méthodes. Un médecin d’un laboratoire de Cologne délivrait, moyennant finances, des médicaments assortis de certificats antidatés, tout le monde savait ça dans le peloton.
Pendant que Pantani se faisait harceler par les « sangsues » de l’UCI, Armstrong parrainait l’UCI à travers une donation destinée – un comble ! – à l’achat d’un appareil de contrôle antidopage sophistiqué. Sans que l’UCI n’y voie une entorse à cette fameuse éthique dont se prévalait son éminent président, Hein Verbruggen. L’UCI auprès de laquelle Pantani était allé en délégation en août 1996, avec Bugno et Chiapucci, pour réclamer l’instauration de contrôles sanguins, l’EPO faisant rage dans les pelotons. Il faudra attendre 2013 pour que le Texan confesse ses accointances avec les hauts dirigeants du cyclisme.
Dans ce climat trompeur de connivence, l’Italien perdra toute confiance dans le « système », un terme générique qui, chez lui, englobait la Fédération italienne, l’UCI et certains sponsors jaloux de sa suprématie. «À table, il ne parlait plus que d’Armstrong, de ses protections, c’était devenu son obsession », rappelle Fontanelli. Comprenant qu’il avait blessé l’orgueil de Pantani au Ventoux, le Texan (3) ira à sa rencontre un soir, en 2002, sur le Tour de Murcie. Mais, pour Pantani, il était trop tard, comment croire à la sincérité du Texan ? Voici quelques mois, fouillant dans les affaires de son fils, Tonina Pantani a retrouvé un tee-shirt rose de cette époque sur lequel Marco avait noté pêle mêle, au stylo bleu, diverses réflexions comme il s’y adonnait sur les murs, les plinthes, les radiateurs de sa villa, sous cocaïne, ou bien encore sur les feuilles de son passeport (dont certains passages seront lus dans l’église San Giacomo lors de ses obsèques). Sur le tee-shirt, il encourageait ses pairs à briser l’omerta. « On lutte pour des valeurs et la merde se substitue à la souffrance, alors, parlez cyclistes ! Faites-le pour les enfants qui rêvent des champions », écrivait-il. Et parmi d’autres pensées cafardeuses il y avait cette phrase, en forme d’accusation : « L’unique vraie blessure, c’est Armstrong. » Il disait là, clairement, ce qu’il suggérait dans ses interviews, sans être entendu, à savoir que le Texan avait tué le cyclisme en piétinant la dignité de ses rivaux et pas seulement, Tyler Hamilton et Floyd Landis, ses équipiers, en ont, par la suite, témoigné. « Mon fils avait anticipé de dix ans ce qui allait se passer mais, alors, la vérité ne pouvait être racontée que sur un bout d’étoffe», râle Tonina (4), qui le revoit au retour d’un entraînement, devant le kiosque à Piadine de la via Torino, alors qu’il n’était qu’un jeune professionnel de la Carrera. « Mamma, je crois que je vais m’arrêter de courir. »
Mais pourquoi ? « Ce milieu est une mafia, mamma…» Une mafia qui s’était trouvé un boss dans ce «salaud» d’Armstrong.…
Sur un tee-shirt retrouvé par sa mère, MARCO PANTANI avait écrit tout le mal qu’il pensait d’Armstrong, passé depuis aux aveux. Retour sur une dualité qui archive toute une époque.
DIX ANS APRÈS sa tragique disparition, on peut se demander si Marco Pantani, martyrisé par la justice sportive de son pays après son exclusion du Tour d’Italie 1999 à Madonna di Campiglio, pour un taux d’hématocrite trop élevé, ne va pas récupérer à titre posthume sa juste place dans l’histoire, à l’inverse de Lance Armstrong, béatifié de son « vivant », dont les confessions de dopage tardives tempèrent aujourd’hui la vénération courtisane qu’il suscitait quand il alignait les victoires dans le Tour comme autant de trophées gagnés sur le cancer (1). On le constate en comparant l’empreinte laissée par l’Italien (avec notamment ce livre de Marco Pastonesi, Pantani était un dieu, aux éditions 66thand2nd) et les objets littéraires que s’attire le Texan, le dernier en date, coécrit par deux collaborateurs du Wall Street Journal, ayant pour titre Armstrong, itinéraire d’un salaud (éditions Hugo-Sport). Dans les années 1990, les deux hommes avaient occupé le devant de la scène, Pantani dans les grands Tours après deux raids d’anthologie en 1994, vers Merano et sur le Mortirolo, l’Américain dans les médias fascinés autant qu’aveuglés par ce combattant de l’impossible, transmué en un grimpeur d’exception par sa maladie mais plus encore, on le sait, par la grâce du « sorcier de Ferrare », Michele Ferrari. Leur rivalité fut éruptive et de courte durée, symptomatique de deux univers, deux philosophies opposées. C’est dans le Tour 2000 qu’elle se cristallisera, un Tour que l’Italien aborde dans la peau d’un paria et les revers nauséeux de Madonna di Campiglio, Armstrong régnant en despote sur un monde où tout lui était concédé. Il y avait l’antique et le moderne, l’Américain - qui repérait tous les cols du Tour, par anticipation - se faisant l’apôtre de la programmation biologique, pendant que l’Italien, chantre d’un certain empirisme, se laissait gouverner par son instinct. « À quoi bon reconnaître un col, l’important c’est de marcher fort le jour J, non? », avait-il rétorqué à son directeur sportif, Giuseppe Martinelli, désireux de l’emmener en stage dans les Alpes. Pantani préférait s’entraîner, chez lui, en Romagne, pendant plus de sept heures parfois, sans manger, en s’abreuvant à l’eau des fontaines. Ses gregarii ignoraient la longueur des entraînements. «Il aimait se tester dans la côte de San Marino de sept kilomètres et nous attendait généralement en haut, le temps de régler ses cales de chaussure, il décidait s’il y avait lieu ou non de forcer la dose» , s’amuse son ancien lieutenant, Fabiano Fontanelli, qui avait vu son leader débarquer à l’improviste, en juin 1998, sur la plage de Milano Marittima où il se trouvait en vacances à la mer.
« Il est arrivé à vélo avec un maillot à manches longues, il faisait près de 45 °C, il n’avait plus roulé depuis le Giro, quinze jours sans vélo, eh bien, ce jour-là, on a fait plus de 260 kilomètres sous un ciel de plomb… » À l’époque, Pantani incarnait le cyclisme. Il était le cyclisme. Et faisait fantasmer pas mal de ses pairs, même Armstrong. Licencié par Cofidis après l’annonce de son cancer, l’Américain était entré en contact téléphonique avec Davide Cassani (2) pour courir sous le maillot Mercatone. « C’était pendant l’hiver 1997, Lance m’a téléphoné et m’a dit : ‘’Je veux recourir chez vous, auprès de Pantani.’’ À l’époque, Marco le fascinait. » Pantani avait d’ailleurs donné son aval. Il était prêt à recueillir le Texan déjà condamné par toutes les grandes équipes à une retraite anticipée. Puis l’US Postal fit son entrée dans les pelotons et l’affaire en resta là, mais elle cautionne a posteriori la rage de Pantani quand, en juillet 2000, Armstrong lui abandonna la victoire au Ventoux avec une ostentation suspecte, comme pour mieux le rabaisser. Le Texan était-il jaloux de l’Italien, de son aura auprès du public, au point de vouloir l’humilier? Fallait-il mettre cette provocation sur l’infatuation d’un personnage égotiste, prétendant au rôle d’unique à l’exclusion des autres? Toujours est-il que Pantani ne cessera plus de distiller des critiques acidulées contre l’Américain, « un héros de bande dessinée. Une sorte de Spiderman, raillait-il avant de voir en lui le fils de celui qui est allé sur la Lune » . « Leurs relations se sont envenimées après le Ventoux, à partir de là Marco s’est mis à le haïr », se souvient Marcello Siboni, un de ses fidèles équipiers.
« Je connais la montagne, je la pratique depuis que j’ai huit ans. Sur le Ventoux, l’Américain pédalait à un rythme trop élevé, au-delà de l’humain. D’ailleurs, il n’a pas affronté la montagne face à face, mais comme s’il savait par avance dès le pied qu’il en sortirait vainqueur », récriminera l’Italien sur la RAI. Déjà, il entrevoyait l’imposture derrière le phénomène Armstrong, vanté, loué par les médias. « Il n’a jamais cru à la métamorphose du Texan, à cette fable de l’homme invincible qui triomphe du cancer et gagne le Tour », renchérit Fontanelli. Tout avait basculé en juin 1999, à Madonna di Campiglio, dans les dérèglements délictueux de son expulsion du Giro. Reclus dans sa villa, il avait scié de rage sa bicyclette. « Il se disait : “ils m’ont pris et pas lui“, et s’est mis à parler de complot. Pour Marco, c’était évident, Armstrong était protégé, on le sait maintenant », se souvient Roberto Conti. À l’époque, il était facile de tricher, de contourner les contrôles ( « J’aurais pu trouver l’escamotage », avait d’ailleurs déclaré Pantani pour sa défense). Chacun avait ses filières, ses méthodes. Un médecin d’un laboratoire de Cologne délivrait, moyennant finances, des médicaments assortis de certificats antidatés, tout le monde savait ça dans le peloton.
Pendant que Pantani se faisait harceler par les « sangsues » de l’UCI, Armstrong parrainait l’UCI à travers une donation destinée – un comble ! – à l’achat d’un appareil de contrôle antidopage sophistiqué. Sans que l’UCI n’y voie une entorse à cette fameuse éthique dont se prévalait son éminent président, Hein Verbruggen. L’UCI auprès de laquelle Pantani était allé en délégation en août 1996, avec Bugno et Chiapucci, pour réclamer l’instauration de contrôles sanguins, l’EPO faisant rage dans les pelotons. Il faudra attendre 2013 pour que le Texan confesse ses accointances avec les hauts dirigeants du cyclisme.
Dans ce climat trompeur de connivence, l’Italien perdra toute confiance dans le « système », un terme générique qui, chez lui, englobait la Fédération italienne, l’UCI et certains sponsors jaloux de sa suprématie. «À table, il ne parlait plus que d’Armstrong, de ses protections, c’était devenu son obsession », rappelle Fontanelli. Comprenant qu’il avait blessé l’orgueil de Pantani au Ventoux, le Texan (3) ira à sa rencontre un soir, en 2002, sur le Tour de Murcie. Mais, pour Pantani, il était trop tard, comment croire à la sincérité du Texan ? Voici quelques mois, fouillant dans les affaires de son fils, Tonina Pantani a retrouvé un tee-shirt rose de cette époque sur lequel Marco avait noté pêle mêle, au stylo bleu, diverses réflexions comme il s’y adonnait sur les murs, les plinthes, les radiateurs de sa villa, sous cocaïne, ou bien encore sur les feuilles de son passeport (dont certains passages seront lus dans l’église San Giacomo lors de ses obsèques). Sur le tee-shirt, il encourageait ses pairs à briser l’omerta. « On lutte pour des valeurs et la merde se substitue à la souffrance, alors, parlez cyclistes ! Faites-le pour les enfants qui rêvent des champions », écrivait-il. Et parmi d’autres pensées cafardeuses il y avait cette phrase, en forme d’accusation : « L’unique vraie blessure, c’est Armstrong. » Il disait là, clairement, ce qu’il suggérait dans ses interviews, sans être entendu, à savoir que le Texan avait tué le cyclisme en piétinant la dignité de ses rivaux et pas seulement, Tyler Hamilton et Floyd Landis, ses équipiers, en ont, par la suite, témoigné. « Mon fils avait anticipé de dix ans ce qui allait se passer mais, alors, la vérité ne pouvait être racontée que sur un bout d’étoffe», râle Tonina (4), qui le revoit au retour d’un entraînement, devant le kiosque à Piadine de la via Torino, alors qu’il n’était qu’un jeune professionnel de la Carrera. « Mamma, je crois que je vais m’arrêter de courir. »
Mais pourquoi ? « Ce milieu est une mafia, mamma…» Une mafia qui s’était trouvé un boss dans ce «salaud» d’Armstrong.…
Citation
13 juillet 2000, le « cadeau » du Ventoux
LANCE ARMSTRONG est déjà leader du Tour de France 2000 depuis les Pyrénées lorsque la course aborde le Ventoux, le 13 juillet. Dès le bas du géant de Provence, Tyler Hamilton imprime le rythme et plusieurs coureurs notables sont déjà en difficulté : Zülle, Jalabert et même… Pantani. Celui-ci reste tout de même en vue du groupe de tête où ils ne sont plus que six au Chalet Reynard : Armstrong, Ullrich, Heras, Botero, Beloki et Virenque.
C’est au début de la portion lunaire que Marco Pantani rétablit le contact et attaque aussitôt. Son quatrième démarrage est le bon. Porté par un orgueil monstre, l’Italien s’isole en tête. Pantani semble alors foncer vers cette victoire de grand prestige. Mais à moins de trois kilomètres du sommet, Armstrong se lance à sa poursuite. Il fond sur lui en cinq cents mètres et le Maillot Jaune conduit le reste de l’ascension sans chercher, semble-t-il, à se défaire du grimpeur italien. À l’arrivée, Armstrong laisse planer une certaine ambiguïté. Un peu trop ostensiblement au goût de l’Italien… Trois jours plus tard, dans les Alpes, Pantani remportera l’étape de Courchevel. En lâchant Armstrong dans la montée finale.
LANCE ARMSTRONG est déjà leader du Tour de France 2000 depuis les Pyrénées lorsque la course aborde le Ventoux, le 13 juillet. Dès le bas du géant de Provence, Tyler Hamilton imprime le rythme et plusieurs coureurs notables sont déjà en difficulté : Zülle, Jalabert et même… Pantani. Celui-ci reste tout de même en vue du groupe de tête où ils ne sont plus que six au Chalet Reynard : Armstrong, Ullrich, Heras, Botero, Beloki et Virenque.
C’est au début de la portion lunaire que Marco Pantani rétablit le contact et attaque aussitôt. Son quatrième démarrage est le bon. Porté par un orgueil monstre, l’Italien s’isole en tête. Pantani semble alors foncer vers cette victoire de grand prestige. Mais à moins de trois kilomètres du sommet, Armstrong se lance à sa poursuite. Il fond sur lui en cinq cents mètres et le Maillot Jaune conduit le reste de l’ascension sans chercher, semble-t-il, à se défaire du grimpeur italien. À l’arrivée, Armstrong laisse planer une certaine ambiguïté. Un peu trop ostensiblement au goût de l’Italien… Trois jours plus tard, dans les Alpes, Pantani remportera l’étape de Courchevel. En lâchant Armstrong dans la montée finale.
Citation
Une lente décadence
Dix ans après la tragédie Pantani, le cyclisme italien peine à se trouver de nouveaux héros et à renouer avec sa grandeur passée.
À LA VEILLE des Strade Bianche, qui lanceront la saison italienne à travers les sentes poussiéreuses du Chianti, les Italiens, moroses, inquiets pour leur cyclisme jadis si florissant mais aujourd’hui miné par sa mauvaise conscience sont très étrangement nostalgiques de Marco Pantani, mort il y a dix ans, d’une overdose de cocaïne et de tristesse dans un hôtel de Rimini.
Le Romagnol n’est plus ce héros shakespearien tragique et encombrant, isolé dans sa gloire, cruellement incompris qu’il était avant que Lance Armstrong ne passe aux aveux mais à retardement, l’incarnation d’une Italie conquérante auquel RAI Sport 2 a consacré plus de douze heures d’antenne – pas moins ! – le 14 février dernier. La transmission s’intitulait C’era una volta il Pirata (Il était une fois le pirate). Un pari éditorial audacieux, doublé d’une réhabilitation publique, salué par de fortes audiences. « Au-delà de ce que l’on peut penser de sa fin tragique, Pantani a suggéré de très fortes émotions, pas seulement dans notre pays, il fait partie de notre histoire », avait déclaré Mauro Vegni, l’organisateur de la RCS, en septembre dernier, lors de la présentation à Milan du prochain Giro où deux étapes lui seront dédiées : la première au sanctuaire d’Oropa, la seconde au monte Campione, théâtre d’un âpre duel au couteau en 1998 avec Pavel Tonkov.
C’était un an avant que l’Italie cycliste ne sombre avec le Pirate dans une lente décadence liée à son économie moribonde (la Fédération peine à trouver des sponsors), à l’omnipotence des préparateurs italiens, à l’extinction de ses figures populaires, toutes rattrapées par le dopage, qu’il s’agisse de Basso, Scarponi, de Rebellin, Ballan ou Riccardo Ricco, le cobra de Modène, disqualifié pour neuf ans, ou du multirécidiviste Danilo Di Luca, suspendu à vie par le CONI (le Comité national olympique italien), et haï par ses pairs pour avoir déclaré l’autre jour, dans l’émission polémiste d’Italia Uno, les Hyènes, «qu’il est impossible de finir dans les dix premiers d’un Giro sans se doper » . Selon lui, « quatre-vingt-dix pour cent des coureurs du Giro se doperaient » . Propos scandaleux, selon les uns ; délirants, selon les autres, inexcusables pour l’ACCPI (l’association des coureurs italiens), qui l’assignera en justice pour diffamation, une façon aussi de l’inciter à plus de prudence, alors que Di Luca s’apprête à publier ses mémoires, avec, à la clé, paraît-il, de nouvelles révélations dévastatrices sur les pratiques déviantes d’une époque heureusement révolue. « Il ne sait plus quoi inventer pour se faire de l’argent. De toute évidence, il n’a plus toute sa tête » , a regretté Vincenzo Nibali, le dernier dignitaire, chargé d’entretenir la flamme vacillante d’un peloton italien désorienté, qui ne compte que deux équipes dans le Pro Tour : la Cannondale, d’essence américaine, et la Lampre, l’une et l’autre structurées autour de deux leaders étrangers (Peter Sagan et Rui Costa), un des nombreux symptômes de ces temps bousculés qui placent les Italiens dans l’obligation d’assumer les dérives de leur propre passé. Pour mieux repartir de l’avant.
Dix ans après la tragédie Pantani, le cyclisme italien peine à se trouver de nouveaux héros et à renouer avec sa grandeur passée.
À LA VEILLE des Strade Bianche, qui lanceront la saison italienne à travers les sentes poussiéreuses du Chianti, les Italiens, moroses, inquiets pour leur cyclisme jadis si florissant mais aujourd’hui miné par sa mauvaise conscience sont très étrangement nostalgiques de Marco Pantani, mort il y a dix ans, d’une overdose de cocaïne et de tristesse dans un hôtel de Rimini.
Le Romagnol n’est plus ce héros shakespearien tragique et encombrant, isolé dans sa gloire, cruellement incompris qu’il était avant que Lance Armstrong ne passe aux aveux mais à retardement, l’incarnation d’une Italie conquérante auquel RAI Sport 2 a consacré plus de douze heures d’antenne – pas moins ! – le 14 février dernier. La transmission s’intitulait C’era una volta il Pirata (Il était une fois le pirate). Un pari éditorial audacieux, doublé d’une réhabilitation publique, salué par de fortes audiences. « Au-delà de ce que l’on peut penser de sa fin tragique, Pantani a suggéré de très fortes émotions, pas seulement dans notre pays, il fait partie de notre histoire », avait déclaré Mauro Vegni, l’organisateur de la RCS, en septembre dernier, lors de la présentation à Milan du prochain Giro où deux étapes lui seront dédiées : la première au sanctuaire d’Oropa, la seconde au monte Campione, théâtre d’un âpre duel au couteau en 1998 avec Pavel Tonkov.
C’était un an avant que l’Italie cycliste ne sombre avec le Pirate dans une lente décadence liée à son économie moribonde (la Fédération peine à trouver des sponsors), à l’omnipotence des préparateurs italiens, à l’extinction de ses figures populaires, toutes rattrapées par le dopage, qu’il s’agisse de Basso, Scarponi, de Rebellin, Ballan ou Riccardo Ricco, le cobra de Modène, disqualifié pour neuf ans, ou du multirécidiviste Danilo Di Luca, suspendu à vie par le CONI (le Comité national olympique italien), et haï par ses pairs pour avoir déclaré l’autre jour, dans l’émission polémiste d’Italia Uno, les Hyènes, «qu’il est impossible de finir dans les dix premiers d’un Giro sans se doper » . Selon lui, « quatre-vingt-dix pour cent des coureurs du Giro se doperaient » . Propos scandaleux, selon les uns ; délirants, selon les autres, inexcusables pour l’ACCPI (l’association des coureurs italiens), qui l’assignera en justice pour diffamation, une façon aussi de l’inciter à plus de prudence, alors que Di Luca s’apprête à publier ses mémoires, avec, à la clé, paraît-il, de nouvelles révélations dévastatrices sur les pratiques déviantes d’une époque heureusement révolue. « Il ne sait plus quoi inventer pour se faire de l’argent. De toute évidence, il n’a plus toute sa tête » , a regretté Vincenzo Nibali, le dernier dignitaire, chargé d’entretenir la flamme vacillante d’un peloton italien désorienté, qui ne compte que deux équipes dans le Pro Tour : la Cannondale, d’essence américaine, et la Lampre, l’une et l’autre structurées autour de deux leaders étrangers (Peter Sagan et Rui Costa), un des nombreux symptômes de ces temps bousculés qui placent les Italiens dans l’obligation d’assumer les dérives de leur propre passé. Pour mieux repartir de l’avant.
Merci Varino.
Merci Varino, du coup j'ai commandé le livre : "Pantani era un dio" 
Merci Varino.
Pantani, peut-être le dernier coureur qui m'a fait vibrer devant la télé
Pantani, peut-être le dernier coureur qui m'a fait vibrer devant la télé
J'ai aimé aussi Simoni sur le Giro.
Merci Varino.
Pantani, peut-être le dernier coureur qui m'a fait vibrer devant la télé
Pantani, peut-être le dernier coureur qui m'a fait vibrer devant la télé
Je plussoie, même si Sagan me fait rêver dans un autre style. Quintana me plaît bien aussi, mais ça demande confirmation. La blessure Armstrong a toujours pas cicatrisé pour ma part, et avec son cousin éloigné leucémique kényan, la plaie risque pas de se refermer.
Non mais Marco qu'est qu'il t'a pris, d'aller mourir à Rimini ©
On vibre quand meme regulierement sur certaines classiques ou avec les Francais sur les GT. Betancur aussi m'a rendu dingue l'an dernier (et Horner  ). Mais ouai ca restera surement ma derniere idole cycliste à jamais. On a plus l'innocence aussi.
). Mais ouai ca restera surement ma derniere idole cycliste à jamais. On a plus l'innocence aussi.
Merci Varino.
Lui et Chiapucci, les deux seules vraies idoles cyclistes que j'ai eu.
Lui et Chiapucci, les deux seules vraies idoles cyclistes que j'ai eu.
Je plussoie, même si Sagan me fait rêver dans un autre style. Quintana me plaît bien aussi, mais ça demande confirmation. La blessure Armstrong a toujours pas cicatrisé pour ma part, et avec son cousin éloigné leucémique kényan, la plaie risque pas de se refermer.
Non mais Marco qu'est qu'il t'a pris, d'aller mourir à Rimini ©
Non mais Marco qu'est qu'il t'a pris, d'aller mourir à Rimini ©
C'est pas pareil, à l'époque, je pensais pas que Pantani et Virenque se dopaient, j'irais pas jusqu'à dire que c'était des héros pour moi, mais je respectais beaucoup leurs performances.
Maintenant qu'on sait qu'ils se chargent tous, c'est pas pareil, même si je suis avec attention le résultat de mecs qui chargent la mule comme des porcs pour faire du spectacle (Europcar et Chris la Chaudière Horner en tête de gondole)
On vibre quand meme regulierement sur certaines classiques ou avec les Francais sur les GT. Betancur aussi m'a rendu dingue l'an dernier (et Horner  ). Mais ouai ca restera surement ma derniere idole cycliste à jamais. On a plus l'innocence aussi.
). Mais ouai ca restera surement ma derniere idole cycliste à jamais. On a plus l'innocence aussi.
Oh putain, la même
C'est pas pareil, à l'époque, je pensais pas que Pantani et Virenque se dopaient, j'irais pas jusqu'à dire que c'était des héros pour moi, mais je respectais beaucoup leurs performances.
C'était aussi pas le même cyclisme, les types n'attendaient pas forcément la dernière difficulté pour se mettre à pédaler comme des rats de laboratoire à des fréquences surhumaines. Peut-être aussi la faute aux oreillettes et aux "wattmètres". Quand tu vois Froome sur le Tour 2013, c'est à la limite du ridicule, et le mec annonce qu'il va envoyer du pâté sur le Tour 2014 maintenant qu'il est guéri
Oui aussi, le dernier Grand qui est parti pour faire des aventures en solitaire, ca devait être Jalabert sur le Tour.
Maintenant qu'on sait qu'ils se chargent tous, c'est pas pareil, même si je suis avec attention le résultat de mecs qui chargent la mule comme des porcs pour faire du spectacle (Europcar et Chris la Chaudière Horner en tête de gondole)
C'est ça le truc, les mecs envoyaient du rêve sur chaque étape, n'importe où, n'importe quand (Festina
Merci Varino 
J'avais lu pas mal de trucs pour les 10 ans de sa mort.
Je recherche les dvd mais ils ne sont qu'en italien
Pantani et sa chevauchée vers les 2 Alpes, que de souvenirs...
J'avais lu pas mal de trucs pour les 10 ans de sa mort.
Je recherche les dvd mais ils ne sont qu'en italien
Pantani et sa chevauchée vers les 2 Alpes, que de souvenirs...
Lui et Chiapucci, les deux seules vraies idoles cyclistes que j'ai eu.
+1 également. L'étape de Sestrieres 92 je crois que c'est ma préférée. Cette chevauchée fantastique!! :gif_animé_émotion_que_je_sais_pas_ajouter:
Je connais la VHS du Tour 92 par cœur.
Dans les années 90 j'étais ado, jamais entendu parler du dopage. C'était des Dieux pour moi. Pantani qui freine dans les virages de l'Alpe et qui a 30 cm de large pour passer dans la foule, c'était mythique.
C'est pour ça que j'ai commencé la compet' en 95 d'ailleurs. Pas sûr qu'ado aujourd'hui ça me donnerait envie.
Comme quoi on a tous des sensibilités différentes. Moi mes idoles c'était Indurain et Jan Ullrich (puis Olano  )
)
J'aimais la puissance qu'ils dégageaient.
J'aimais la puissance qu'ils dégageaient.
Citation
« L’unique vraie blessure, c’est Armstrong. »
Il parle d'or.
On ne mesure pas le mal qu'a pu faire ce gros fils de pute au cyclisme, pendant son ère puis après, avec l'arrivée des "anglophones".
Il parle d'or.
On ne mesure pas le mal qu'a pu faire ce gros fils de pute au cyclisme, pendant son ère puis après, avec l'arrivée des "anglophones".
On ne mesure pas le mal qu'a pu faire ce gros fils de pute au cyclisme, pendant son ère puis après, avec l'arrivée des "anglophones".
C'est Lemond, l'arrivé des anglo-saxons. Faut pas se tromper d'ennemi, c'est pas l'anglais qui à a gerber, c'est le dopage scientifique.
Lemond dernier vainqueur d'un Tour.
Sinon Paris-Nice demarre ce week-end avec un parcours interessant, des etapes cabossées sans col difficile. Les favoris sont Rui Costa désormais chez Lampre, Porte le tenant du titre, et Nibali.
Je sais pas trop qui fait le Tirreno Adriatico ni le parcours, en parallele.
Des "classiqueurs" risquent de se meler à la bagarre vu le parcours, j'ai lu Gallopin, pourquoi pas?
Je sais pas trop qui fait le Tirreno Adriatico ni le parcours, en parallele.
Des "classiqueurs" risquent de se meler à la bagarre vu le parcours, j'ai lu Gallopin, pourquoi pas?
C'est Lemond, l'arrivé des anglo-saxons.
Je me comprends, Armstrong a ramené dans sa suite la clique des US/autraliens/anglais très limites ou sortis d'on ne sait où.
Si tu vas par là Hampsteen ou Lemond n'étaient pas limites, et Simpson était déjà un sale britt shooté
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
