Version complète : Cinéma
Forum de Culture PSG > Les forums du Bas : Parce que la communauté ne parle pas que de foot > Forum Sports et Loisirs
Pages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Un article du Monde daté 26/08/2018 (l'été dernier y'avait une très bonne série sur Alain Delon)
« Le Cercle rouge », regards croisés de Jean-Pierre Melville et Alain Delon
La photographie reste toujours aussi frappante. Nous sommes sur le plateau du Cercle rouge, dans une clairière en marge du relais route de Bel-Air, au nord de La Rochepot, en Côte-d’Or. Le tournage a commencé en février 1970, et il faut avancer sans tarder. Jean-Pierre Melville a une date bien en tête pour sortir son film, son deuxième avec Alain Delon. Ce sera le 20 octobre. Pour le premier, Le Samouraï, en 1967, c’était un 25 octobre. Soit, à chaque fois autour, où le jour même, de son anniversaire. Melville croit à la vérité des chiffres et au maintien d’un ordre immanent qui, s’il est respecté, veillera au succès de son film. Ce fut le cas avec Le Samouraï. Ce sera de nouveau le cas, et même mieux, avec Le Cercle rouge, le plus grand succès de sa carrière avec 4 300 000 entrées.
Au milieu de la forêt, le réalisateur s’apprête à tourner la séquence où, selon l’improbable cosmologie dont il est le concepteur, avec son idée-force d’un hasard objectif, les êtres doivent se rencontrer dans le respect d’un destin décidé par les dieux. Corey, le truand incarné par Delon, tout juste sorti de la prison des Beaumettes, à Marseille, remonte à Paris pour retourner dans son appartement, avenue Paul-Doumer. Il arrête sa voiture sur un chemin de forêt. Dans le coffre de sa Plymouth Fury III, propriété, dans la vie, de Jean-Pierre Melville, Delon sait que s’est réfugié, à son insu, un autre bandit en cavale. Après avoir faussé compagnie au commissaire Mattei dans le train le ramenant lui aussi de Marseille à Paris, Vogel (Gian Maria Volonte) est devenu l’homme le plus recherché par les polices de France.
Dans Le Cercle rouge, la rencontre de trois malfrats – Alain Delon, Gian Maria Volonte et Yves Montand – qui se connaissent à peine relève de l’arbitraire. Leur objectif, le cambriolage de la bijouterie Mauboussin place Vendôme, devient leur chef-d’œuvre. Le piège tendu par le commissaire Mattei, incarné par Bourvil, scelle le sort de ces trois hommes en tragédie.
Melville, son Stetson sur la tête
Sur la photo, Melville, son Stetson sur la tête, le visage obstrué par ses habituelles lunettes fumées, apparaît muet, concentré, mélancolique. « Il portait un masque », remarque Philippe Labro, qui fut le disciple et l’un des plus proches amis de Melville, à partir de 1969, au moment de L’Armée des ombres, jusqu’à la mort du cinéaste, le 2 août 1973, sous ses yeux, au restaurant, d’une rupture d’anévrisme. « Son chapeau, explique Labro, visait à masquer sa calvitie, ses lunettes fumées son regard, son imperméable ses formes. Cet homme masqué, fasciné par les hommes beaux, avait devant lui, avec Delon, le plus beau visage du cinéma français, à ce point magnifique qu’il n’avait pas besoin de masque. »
Alain Delon.
Alain Delon. Corona /Prod DB
Toujours sur la photo, les poings de Melville, bien que rangés dans les poches de son blouson, signalent une véritable tension. Le cinéaste se trouve, déjà, au bord de la crise de nerfs. Un état habituel chez cet insomniaque qui déteste les tournages, encore plus ceux en extérieurs, car ils l’obligent à se lever encore plus tôt le matin. Si cela ne tenait qu’à lui, Melville déléguerait cette corvée à un imaginaire frère jumeau. Le réalisateur vit la nuit. La journée, il évolue dans la pénombre, les volets clos et, si nécessaire, en clouant des planches sur les interstices pour ne laisser filtrer aucune lumière.
Le monde entier est contre lui, tente-t-il de se convaincre. Sauf Alain Delon
« Quand nous retournions à son domicile parisien de la rue Jenner, raconte Bernard Stora, l’assistant du réalisateur sur Le Cercle rouge, il se mettait en pyjama, se couchait et sa femme, Florence, lui amenait un plateau avec du poulet froid, des frites et de la mayonnaise en tube, car cela faisait américain. Cela prenait jusqu’à minuit, puis il se rhabillait entièrement et disait : “Venez mon coco, nous allons faire le tour du périphérique.” On prenait sa grosse voiture américaine et, là, il s’exclamait : “Ça, c’est l’Amérique !” » Melville manifeste aussi une paranoïa certaine.
Son exigence absolue à l’égard de son équipe – techniciens et acteurs – le pousse à s’imaginer entouré d’ennemis. Le tournage du Cercle rouge va durer soixante-six jours au lieu des cinquante prévus. « Tout cela, explique le cinéaste, parce que les hommes qui étaient avec moi sur le plateau, les hommes et la femme qui étaient sur le plateau n’étaient pas du tout à la hauteur. » Le monde entier, donc, est contre lui, tente-t-il de se convaincre. Sauf Alain Delon.
Rencontre inscrite dans les étoiles
Il fallait bien que ce soit lui, Delon, pour que Melville, sur le tournage du Cercle rouge, consente à une pause et l’observe, amusé, en train d’ausculter un poignard de samouraï. Quelques années plus tôt, cette arme avait scellé le pacte entre les deux hommes. Le Cercle rouge marque leur deuxième collaboration, trois ans après Le Samouraï, deux ans avant Un flic (1972), ultime film du réalisateur.
Lorsque, durant l’hiver 1966, Melville se rend à l’hôtel particulier d’Alain Delon, au 22, avenue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris, pour lui lire le scénario du Samouraï, l’acteur interrompt à un moment le cinéaste en regardant sa montre, constatant l’absence de dialogues jusque-là : « Cela fait neuf minutes que vous lisez le scénario, personne ne vous a interrompu. Ce sera ce film, et pas un autre, que je tournerai. » Delon fait une pause, puis demande : « Quel est son titre ? »« Le Samouraï », répond Melville. Sans dire un mot, Delon prend alors Melville par le bras et lui montre sa chambre. Les trois objets qui la décorent sont une lance, un poignard et un sabre de samouraï. C’est comme si le destin du film, acté par les deux hommes, avait été décidé en de plus hauts lieux.
Jean-Pierre Melville repère Delon en 1957, dès son premier film, Quand la femme s’en mêle, dYves Allégret. Il le suit ensuite, au gré de la carrière de l’acteur, à la manière d’une femme que l’on aperçoit, croise régulièrement, en attendant le moment opportun pour l’aborder. C’est à la toute fin des années 1950, avant Plein soleil et la naissance de la star Delon, en le rencontrant par hasard sur les Champs-Elysées, que Melville se décide à lui parler. Il lui fait alors écrire son nom sur son agenda Hermès. Pour tracer un destin. Qui consiste à tourner sous sa direction, le jour où se présentera le projet opportun. En attendant, leur rencontre se trouve déjà inscrite dans les étoiles.
Sous le regard ravi de Delon
Jean-Pierre Melville se dessine une image de Delon qui tient beaucoup à son physique. Le réalisateur est séduit par un certain naturel, une rare sécurité des gestes, des réflexes, des muscles, des nerfs plutôt. En somme, tout ce qui fait que l’on désigne le plus souvent Delon comme « un bel animal ». Mais, au-delà du talent évident, Melville craint le comportement de star de l’acteur, ses caprices sur un plateau. Des craintes effacées dès la première seconde de tournage du Samouraï, le chef-d’œuvre qui va fixer pour toujours le mythe Delon et définir les canons du film noir moderne : contemplatif, hiératique, fétichiste, métaphysique, proche de l’essence de la tragédie, déconnecté du réalisme qui constituait auparavant l’essence même du polar.
Dans la scène d’ouverture du Samouraï, le tueur à gages solitaire, éliminant ses victimes les mains gantées de blanc, et personnifié par Delon, quitte le lit monacal de sa chambre aux volets clos, regarde son bouvreuil dans sa cage, se lève, se dirige vers un miroir où il ajuste son chapeau, et essuie trois fois son doigt sur son rebord. Melville passe une demi-journée sur ce plan de 3 secondes. Il se place aux côtés de Delon devant le miroir, ajuste lui-même le bord du chapeau. Il le rabat. Ou le relève. Une dizaine de prises ne suffisent pas. De nouvelles répétitions sont nécessaires afin d’ajuster le bord du chapeau, plus que jamais l’objet d’un travail de haute précision. Tout cela sous le regard ravi de Delon, dont le goût pour l’abstraction, la précision des gestes élevés au rang de science exacte, correspond aux obsessions de son metteur en scène.
« Nous nous adressâmes très peu la parole, expliquait Melville. Trop occupés à nous déchiffrer. Il y avait pourtant avant chaque scène de courtes conversations à voix basse, dont je me rappelle la musique et la magie. Nous avions l’attente, la complicité mystérieuse. Ce sont des bonheurs rares pour un metteur en scène comme pour un acteur. Ce fut pour moi et, je l’espère, pour lui, une des plus belles lunes de miel que j’ai jamais connues. »
« Le solitaire qui dit non »
Melville rêve de Delon. Delon révère Melville. L’écart de génération – Delon a 34 ans au moment du Cercle rouge, Melville 53 – fait de l’acteur ce fils que le réalisateur n’a jamais eu. Delon est attiré par les héros de la guerre. Melville, né Jean-Pierre Grumbach, qui a rejoint les rangs de la Résistance en réponse au statut des juifs édicté par Vichy et pour libérer une France occupée par les nazis, et qui a adopté, durant ces années, son pseudonyme, en hommage à l’auteur de Moby Dick, est précisément l’un des héros de la Résistance. Après un passage en zone libre, le futur réalisateur traverse à pied les Pyrénées. Il rejoint Londres et participe à la campagne d’Italie. Melville et Delon partagent une admiration commune pour la figure du général de Gaulle, au point, pour Melville, de personnifier l’homme de la France libre dans son admirable film sur la Résistance, L’Armée des ombres (1969), réalisé entre Le Samouraï et Le Cercle rouge.
Lorsque Delon achète, en décembre 1970, le manuscrit de l’« Appel à tous les Français »,rédigé à Londres, en juin 1940, par de Gaulle, dans le but de le remettre ensuite au grand chancelier de l’ordre de la Libération, il effectue aussi un geste en direction de Jean-Pierre Melville, au nom d’une fascination mutuelle, d’une certaine idée de leur pays, d’une manière aussi de se conduire et de diriger son existence. En marge, toujours. « Delon va vers de Gaulle, estime Philippe Labro, car, au-delà d’un patriotisme bien compréhensible, le Général est le solitaire qui dit non. Chez Alain, il y a cette référence et cette révérence vers le grand homme. Cela montre très bien qu’il sait qui il est. Au prix de quelles errances a-t-il acquis ce code ? Alain est une personnalité très forte, pas tellement influençable, il trace seul une route. »
Plus que jamais la star absolue aux yeux de Melville
Lors de son passage à Marseille, Melville fréquente le milieu. Cette expérience, qui nourrit ses premiers films, Bob le flambeur (1956) et Le Doulos (1962), plaît à Delon. De son côté, la star ne fait aucun mystère de ses relations avec le grand banditisme. Cet aspect ravit Melville, et encore plus les récents démêlés du comédien avec la justice, à la suite à l’affaire Markovic, au sujet de laquelle le cinéaste se trouve d’ailleurs interrogé par les policiers de la première brigade mobile, en septembre 1969. Delon incarne plus que jamais la star absolue aux yeux de Melville.
L’odeur de soufre qui l’entoure parfait un peu plus son aura aux yeux du metteur en scène, au moment où il le retrouve pour Le Cercle rouge. « Delon, estime Melville, est la dernière “star” que je connaisse ; cela va de soi pour la France, mais je me réfère au monde entier. Il est une “star” hollywoodienne des années 1930. Il a même sacrifié à cette obligation propre aux stars des années 1930 : celle d’entretenir un scandale : “Hollywood Babylone !”»
Delon se rend régulièrement, aux commandes de son hélicoptère, dans la maison de Melville, à Tilly, dans les Yvelines. « Ils voulaient se parler sans moi, raconte Rémy Grumbach, le neveu de Melville. Leur conversation rejetait les autres, ils voulaient être seuls et parler. Cela se sentait très bien. »
Bourvil et Alain Delon.
Bourvil et Alain Delon. Films Corona / Prod DB
A propos de Melville, Delon expliquera plus tard : « [Il] connaissait mieux que moi ce personnage qui est en moi. » Un personnage que le réalisateur définit mieux que quiconque, voyant en Delon un homme secret, « replié sur lui-même, introverti dans des proportions qu’il n’imagine certainement pas. Il est de la race qui conserve sa jeunesse intacte et la fraîcheur de son adolescence. Il a retenu l’univers même de son enfance avec ses passions taciturnes et ses mythologies. Il existe chez lui un goût de l’autodestruction tout à fait romantique. Un goût romanesque de la mort qui est certainement dû au fait qu’il a fait la guerre très jeune en Indochine. »
Le code d’honneur est scellé par un regard
Au début du Cercle rouge, une fois sa voiture garée en pleine nature, son coffre ouvert, Delon demande à l’intrus d’en sortir. Il sort de sa poche un paquet de cigarettes et l’envoie en direction de Gian Maria Volonte, qui l’attrape au vol. Puis Delon lui jette son briquet. Une main occupée par le paquet de cigarettes, l’autre par le revolver, Volonte ne peut rattraper le briquet qui tombe par terre. Il hésite, mais finalement range son arme, se baisse et ramasse le briquet. Delon regarde Volonte allumer une cigarette et lui adresse un sourire timide et ému au moment où l’intrus lui renvoie le briquet. Ce moment entre les deux hommes n’existe que par cette cigarette, les regards suffisent, le code d’honneur est scellé par un regard.
La scène, magistrale, inoubliable, trouve aussi sa force par ce qu’elle raconte des relations entre Delon et Melville. Une connivence sans paroles. « Sur le plateau, note Bernard Stora, Delon et Melville ne se parlaient pas, car ils n’avaient rien à dire. Delon n’était pas intéressé à parler. Melville ne parlait guère. Delon, d’une discipline absolue, était toujours là, disponible quand on avait besoin de lui, connaissant, comme toujours, son texte à la perfection. »
A la différence de la rigueur martiale de son personnage de tueur solitaire dans Le Samouraï, du corset constitué par l’agencement de son chapeau, son imperméable, sa cravate, ses gants, reflet de sa rigidité psychologique, Delon arbore dans Le Cercle rouge des cheveux un peu plus longs, teints en noir, et une moustache. Melville tient à la moustache, un accessoire atypique dans les films de Delon.
L’acteur ressemble tout de même beaucoup à celui du Samouraï, avec le même imperméable Burberry, mais cette fois un peu trop grand, fripé, sanglé à l’extrême. La cravate noire est nouée, mais le col gauche de sa chemise blanche s’échappe de son pardessus – une entorse à rapprocher de la légendaire rigueur melvilienne, qui donne tout son sens à la trajectoire contrainte du personnage incarné par Delon. Trahi par sa compagne, lâché par ses anciens complices, touché par le réconfort d’une cigarette partagée fraternellement avec un inconnu en compagnie duquel il organise le casse d’une bijouterie, Delon n’agit plus pour s’ouvrir les possibles de l’existence, mais pour refermer le livre de sa vie.
Quelque part, ce Delon ressemble à la description si juste donnée par Melville : un homme qui a retenu de son enfance ses mythologies et affiche un goût romanesque de la mort. C’est souvent ainsi avec Melville. Il y a les acteurs qu’il veut et ceux avec lesquels il se brouille à vie. Jean-Paul Belmondo a quitté le plateau de L’Aîné des Ferchaux (1963) après avoir giflé le réalisateur. Lino Ventura n’adresse plus parole à Melville lors du tournage de L’Armée des ombres, et préfère lui payer un dédit plutôt que de le retrouver sur Le Cercle rouge, où il devait tenir le rôle du commissaire Mattei, dont héritera Bourvil.
Un héros moderne
Durant le tournage du Cercle rouge, le souffre-douleur ne s’appelle pas Yves Montand ou Bourvil, deux acteurs pour lesquels le réalisateur manifestera, après-coup, la plus grande admiration, mais Gian Maria Volonte. L’acteur italien, révélé dans Pour une poignée de dollars, de Sergio Leone, est imposé pour des raisons de coproduction avec l’Italie. Melville voit en lui un grand acteur shakespearien, mais un homme impossible, un comédien incapable de se placer dans la lumière, ne comprenant pas qu’un centimètre à droite ou un centimètre à gauche ce n’est pas la même chose.
Volonte est membre du Parti communiste italien, un engagement qui accentue son éloignement avec le gaulliste Melville. Harcelé, humilié par le metteur en scène, dépassé par la tension que celui-ci fait régner sur le plateau, Volonte préfère quitter le tournage. Alain Delon file à l’aéroport d’Orly, où son partenaire s’apprête à prendre le prochain avion pour Rome. L’acteur lui explique patiemment que son forfait met, non seulement un terme au film, mais, au-delà, à sa carrière. Le lendemain, Delon et Volonte sont de retour aux studios de Boulogne.
Au début du Cercle rouge, le personnage incarné par Delon, sortant de la prison des Beaumettes, récupère ses effets personnels. Dont trois photos du même visage d’une jeune femme que le scénario, écrit par Melville, décrit comme étant « tour à tour gaie, pensive, triste, avec un grain de beauté sur la joue ». Peu après, il manque d’abandonner les photos sur le comptoir d’un café. Dans ce film, la rigueur de la mise en scène reflète l’ascétisme de son personnage principal. Défait, meurtri, négligé, mais avec élégance. Un héros moderne.
Lorsque Delon retourne chez son ancien complice récupérer de l’argent, la jeune femme se trouve dans la chambre d’à côté. Elle est effectivement pensive et triste, et prend les traits d’Anna Douking. Cette actrice débutante poursuivra sa carrière dans Juste avant la nuit, de Claude Chabrol, et la terminera dans des films érotiques comme La Chatte sur un doigt brûlant. Quand Anna Douking se tourne vers l’ancien ami de Delon, une fois ce dernier reparti, elle lui demande ce qui se passe, et il répond de manière détachée : « Rien, rien. » Effectivement, dans Le Cercle rouge, Delon n’est plus rien. Et en même temps, il est tout.
Rémy Grumbach a été interviewé en 2017, Philippe Labro et Bernard Stora l’ont été en 2018. La citation d’Alain Delon provient d’« Alain Delon », d’Henri Rode (PAC, 1982), celles de Jean-Pierre Melville du « Cinéma selon Jean-Pierre Melville », de Rui Nogueira (Seghers, 1973). Le travail, impeccable de Yannick Vallet, dans son blog, Melvilledelon.blogspot.com, a été d’une grande utilité pour retrouver les détails topographiques et scénaristiques du film.
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Merci pour l'article.
De Melville, mon préféré est "Le deuxième souffle" pour Lino, mais l'oeuvre entière est extraordinaire.
Houdini, derrière tu dois te faire les H.G Clouzot et t'es bon.
Quant à Delon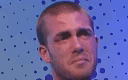
De Melville, mon préféré est "Le deuxième souffle" pour Lino, mais l'oeuvre entière est extraordinaire.
Houdini, derrière tu dois te faire les H.G Clouzot et t'es bon.
Quant à Delon
L'article sur Monsieur Klein est excellent :
« Jouer Klein, un rôle de Monsieur Dupont, avec son chapeau feutre et sa gueule de con… Vous connaissez quelqu’un d’autre pour faire ça ? », déclare Alain Delon à la revue Cinématographe, en 1994, dix-huit ans après la sortie de Monsieur Klein, de Joseph Losey.
Oui, il peut y avoir d’autres acteurs. Mais ce qui est sûr, c’est que ce profil d’un marchand d’art sous l’Occupation achetant à vil prix les tableaux de Français juifs aux abois – l’anti-héros par excellence – colle parfaitement à ce comédien atypique et imprévisible. Qui aime se décider dans l’instant.
Lorsque le producteur Norbert Saada lui apporte le matin un scénario signé par le réalisateur de Z et de L’Aveu, Costa-Gavras, et Franco Solinas, qui a écrit celui de La Bataille d’Alger (1966), de Gillo Pontecorvo, un film interdit en France et qui devra attendre cinq ans avant sa sortie en salle, Delon donne son assentiment le soir même. Avec enthousiasme.
La rafle de 13 000 juifs, voulue par les Allemands mais organisée par le régime de Vichy, arrêtés les 16 et 17 juillet 1942, dont plus de la moitié seront emmenés au Vélodrome d’Hiver, dans le 15e arrondissement de Paris, puis déportés vers les camps d’extermination nazis, reste, comme l’explique Delon, un sujet brûlant, « qui faisait peur à tout le monde ». Mais le sujet n’entame en rien sa témérité : « Ce film, je devais le faire », déclare-t-il au Monde en 2003.
Il tient tant à s’impliquer qu’il endosse, en plus de celle de vedette, la casquette de coproducteur. Sa décision est impérative, dictée par une responsabilité. Cela n’a rien de surprenant pour un acteur qui a autrefois abordé, avec la même urgence, la question de la guerre d’Algérie dans L’Insoumis (1964), d’Alain Cavalier, puis dans Les Centurions (1966), de Mark Robson.
« Alain connaissait l’épisode du Vélodrome d’Hiver, insiste Norbert Saada. Il est né en 1935, il n’a pas feint la surprise. Il avait 7 ans en 1942, le fait qu’il ait été contemporain de cet événement l’avait frappé. Il était au courant de ce qui se passait, des horreurs commises. Il ne découvrait rien. Après avoir lu le scénario, il ne m’a posé aucune question là-dessus. Il savait. »
A rebours du discours dominant sur une France résistante
C’est un autre comédien, et pas n’importe lequel, qui, à l’origine, doit incarner Monsieur Klein : Jean-Paul Belmondo. Sous la direction alors de Costa-Gavras. Ce dernier commence, en 1973, avec Franco Solinas, l’écriture d’un film sur la rafle du Vélodrome d’hiver.
Ce tabou, bien réel, d’un gouvernement français qui a assassiné une partie de sa population, car juive, devient une question centrale en France à partir du début des années 1970. Le Chagrin et la Pitié, en 1969, avec sa réception controversée et son impact considérable, est passé par là. Le documentaire de Marcel Ophuls met en avant, à travers la chronique d’une ville française, Clermont-Ferrand, entre 1940 et 1944, des comportements quotidiens pour le moins ambigus, voire de franche collaboration avec l’occupant allemand – à rebours du discours dominant sur une France résistante.
La publication en 1972, aux Etats-Unis, de l’ouvrage fondateur de l’Américain Robert O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, traduit en France l’année suivante, qui met en avant le rôle central du gouvernement de Pétain dans la déportation des juifs, signifie qu’un passé douloureux remonte à la surface. Costa-Gavras et Solinas travaillent d’ailleurs en partie à partir de cet ouvrage. Le tandem cherche un angle lui permettant de raconter le passé vichyste de la France.
Un témoignage du Chagrin et la Pitié frappe Gavras. Un commerçant du nom de Marius Klein fait publier, dans les années 1940, une annonce dans un journal local afin de faire savoir que son nom n’est pas juif. A partir de cette simple histoire, Gavras et Solinas trouvent le fil rouge de leur scénario autour de la question de l’identité. Qui est juif ? Qui ne l’est pas ? Qui est susceptible d’être déporté ou pas ? Que faire si un nom ne permet pas de trancher avec certitude ? Klein peut être le nom d’un juif ou d’un chrétien. Jean-Paul Belmondo incarnera celui qui, selon l’expression de Gavras, « allait être pris au piège de son nom ».
Un exemple d’inhumanité
Pour des raisons complexes liées, selon Costa-Gavras, aux conditions financières extravagantes réclamées par Robert Kuperberg et Jean-Pierre Labrande, à l’origine les deux producteurs de Monsieur Klein, Jean-Paul Belmondo, furieux et blessé, se retire.
Le projet atterrit en 1975 entre les mains de Delon, qui propose naturellement à Costa-Gavras de le mettre en scène. Mais ce dernier, qui a pensé et écrit ce film pour Belmondo, concevant pour lui certaines scènes, préfère se retirer, au point d’enlever son nom du générique. Un geste compris par Delon.
L’acteur a alors l’idée, brillante, de proposer Monsieur Klein à Joseph Losey. Il le connaît, a travaillé avec lui sur L’Assassinat de Trotsky (1972), où l’acteur incarne l’assassin du révolutionnaire russe. Losey fait partie de ses maîtres, en compagnie de René Clément, Visconti et Melville, sous l’autorité desquels l’acteur pense laisser une trace dans l’histoire.
Au début des années 1950, le réalisateur américain fuit les Etats-Unis et le maccarthysme pour échapper à la liste noire. Il s’installe en Angleterre où il tourne au long des années 1960 quelques chefs-d’œuvre parmi les plus achevés de la décennie – The Servant, Accident, Cérémonie secrète.
Ce marchand d’art, Robert Klein, contraint pour survivre de justifier sa véritable identité, se trouve en phase avec plusieurs grands rôles de l’acteur. Delon est si souvent double à l’écran...
Losey trouve dans le scénario de Franco Solinas des résonances intimes. La période de l’Occupation symbolise à ses yeux la monstrueuse indifférence de l’homme pour d’autres individus, un exemple d’inhumanité, sur lequel il se documente de manière obsessionnelle, dans le but d’en acquérir une compréhension intime.
Losey s’appuie pour cela sur l’expérience personnelle de plusieurs membres de la future équipe de Monsieur Klein : Alexandre Trauner, un juif hongrois qui a clandestinement conçu les décors des Enfants du paradis (1945), de Marcel Carné ; la responsable du casting, Margot Capelier, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps ; Claude Lyon, directeur de laboratoire à LTC, dont la mère est morte en déportation.
Alain Delon.
Alain Delon. LIRA - NOVA / PROD DB
En outre, ce profil d’un citoyen pris pour un autre, qui a confiance dans son gouvernement et les institutions de la France, dont la famille « est française et catholique depuis Louis XIV », cet individu confondu avec un homonyme juif, trouve chez Losey un écho avec le maccarthysme où, parfois, des individus portant juste les prénom et nom d’une autre personne figurant sur la liste noire se trouvent privés de leur travail.
Franco Solinas a été membre du Parti communiste italien. Losey avait rejoint le Parti communiste américain dans les années 1940 – un choix qui scelle son sort dans son pays natal. Alain Delon, dont les opinions politiques penchent à droite, est loin de cette sphère. Seul le critère artistique importe à ses yeux. Et c’est lui, avec la double casquette de vedette et de coproducteur, qui permet à cet alliage improbable mais si probant – un scénariste italien, un metteur en scène américain, une star française – de concevoir le plus grand film jamais réalisé sur la France de Vichy.
L’acteur, révélé dix-sept ans plus tôt avec « Plein Soleil », dans la lumière éclatante de la côte amalfitaine, croise, cette fois, le soleil noir de la déportation
Lorsque Monsieur Klein est annoncé, le film arrive en fin de comète sur la période de l’Occupation. Dans la foulée du Chagrin et la Pitié sortent sur les écrans Lacombe Lucien (1974), de Louis Malle, d’après un scénario de Patrick Modiano ; Les Guichets du Louvre (1974), de Michel Mitrani, sur la rafle de juillet 1942 déjà ; Section spéciale (1975), de Costa-Gavras. Mais, loin d’arriver en retard, Monsieur Klein surplombe cet ensemble et le domine.
Joseph Losey est si frappé par le discours du président de la République Valéry Giscard d’Estaing prononcé le 18 juin 1975 à Auschwitz qu’il lui écrit pour lui demander l’autorisation d’utiliser dans son film le passage relatif à la rafle du Vél’d’Hiv. Le chef de l’Etat évoque une tache noire dans l’histoire de France qui ne peut se dissiper tant elle traverse les histoires individuelles : « Nous les avons vus partir ; je les ai vus partir. Le matin du 16 juillet 1942, nous avons été réveillés par le bruit inhabituel des autobus parcourant avant le lever du jour les avenues de Paris. On y apercevait des silhouettes sombres, avec leurs manteaux et de petites valises. Quelques heures plus tard, on apprenait qu’il s’agissait de juifs qui avaient été arrêtés à l’aube et qu’on rassemblait au Vélodrome d’Hiver. J’avais observé qu’il y avait parmi eux des enfants de notre âge, serrés et immobiles, le regard écrasé sur la vitre, pendant la traversée de cette ville glacée, à l’heure faite pour la douceur du sommeil. Je pense à leurs yeux noirs et cernés, qui sont devenus des milliers d’étoiles dans la nuit. »
L’occupant nazi reste invisible à l’écran
Giscard donne son accord à Losey, mais ce dernier, sur l’insistance de Franco Solinas, abandonne l’idée. Sans doute pour cette raison : à l’instar de son prédécesseur à l’Elysée, Georges Pompidou ou, de son successeur, François Mitterrand, Giscard ne souligne jamais la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs – Jacques Chirac sera le premier chef d’Etat à le faire.
Dans Monsieur Klein, au contraire, l’occupant nazi reste invisible à l’écran, entièrement occupé par la police et l’administration de Vichy. Car la rafle du Vél’ d’Hiv est une histoire française. Une histoire aussi sans image. Il n’existe comme document visuel qu’une seule photographie de l’événement.
Cette rafle, effectuée à huis clos, à l’aube, profitant du calme de l’été, s’est efforcée de ne laisser aucune trace. Même le vélodrome est détruit en 1959, obligeant l’équipe du tournage à tourner la scène au vélodrome Jacques-Anquetil, à Vincennes. Ainsi, Monsieur Klein reconstitue ce qui a été effacé.
Une cohérence d’un film à l’autre
« L’idée de jouer quelqu’un qui découvre qu’il a des origines juives me séduisait beaucoup, dit Delon. Je trouvais l’évolution du personnage très forte. » Ce marchand d’art, Robert Klein, contraint pour survivre de justifier sa véritable identité, se trouve en phase avec plusieurs grands rôles de l’acteur.
Delon est si souvent double à l’écran… Dans Plein soleil (1959), de René Clément, il tue son ami pour endosser son identité. Avec La Tulipe noire (1964), de Christian-Jaque, il fait face à un frère jumeau, ou dans William Wilson, le segment d’Histoires extraordinaires (1968), adapté d’une nouvelle d’Edgar Poe et réalisé par Louis Malle, Delon est confronté à son double. Il y a surtout ses rôles chez Melville, dans Le Samouraï et Le Cercle rouge, et chez Visconti, avec Le Guépard, déjà abordés dans cette série, où l’acteur croise systématiquement un miroir, contemplant son propre reflet, dans le vertige d’une identité toujours plus indiscernable.
Avec Monsieur Klein, Delon se lance à la poursuite de son ombre, d’abord pour la confondre, ensuite pour l’accompagner dans son destin funeste. Au point de rejoindre son double dans un train de déportation. Le dialoguiste Pascal Jardin notait, au sujet de Delon : « Tous les personnages qui cohabitent en lui s’entendent mal entre eux. »
Pour cet acteur qui bâtit sa carrière en stratège, et aussi en auteur, dressant une cohérence d’un film à l’autre, pour dessiner son autoportrait, Monsieur Klein devient ce film impossible à refuser. Il confronte Delon à l’urgence de l’histoire, et à sa propre histoire, en posant toujours la même question : qui suis-je ?
Lorsque Delon/Klein achète pour une somme dérisoire auprès d’un juif une toile d’Adriaen van Ostade représentant le portrait d’un gentilhomme hollandais raccompagnant son vendeur à la porte, il s’arrête devant un miroir accroché dans le vestibule et y contemple son visage livide, défait. Il se demande pour la première fois qui est Robert Klein.
Plus tard, au moment de quitter La Coupole, il est confronté au même reflet, dans la vitrine du restaurant où il dîne avec ses amis et sa maîtresse. Michael Lonsdale, qui incarne son avocat, chargé de trouver les extraits de naissance de ses grands-parents afin de prouver que son client n’est pas juif, se souvient de l’insistance de Delon pour filmer ce reflet. Delon dit : « Non, la caméra, là, ce n’est pas mon bon profil, il faut la mettre là, parce qu’il y a un reflet dans la glace. » Losey lui répond : « C’est moi le metteur en scène. » Et Delon : « Oui, mais moi je suis le producteur. » « Delon, ajoute Lonsdale, était avec son garde du corps et ses chiens. J’ai voulu caresser le chien. Delon m’a répondu :“Touche pas, il mord.” »
« Ce personnage est très complexe, Alain l’est aussi »
En 2014, Delon confie au Figaro, à l’occasion de la ressortie sur les écrans de Monsieur Klein, une photo de tournage. L’acteur est assis, avec le manteau de cachemire beige qu’il porte la plupart du temps dans le film. Son père, à côté de lui, l’observe, fasciné par les multiples personnalités de son fils.
Delon semble ailleurs, comme happé par le personnage qu’il incarne. La photo est affichée dans le bureau de l’acteur. C’est l’une des rares dont il ne se sépare jamais. A la veille d’être englouti dans la rafle du Vél’ d’Hiv, Monsieur Klein contemple une dernière fois la toile d’Adriaen van Ostade, représentant ce gentilhomme qui pourrait être son père.
« Il est difficile de dire qu’il y a beaucoup d’Alain dans le personnage, puisque celui-ci n’est pas très plaisant, et je ne veux pas du tout dire cela, confie Joseph Losey à Michel Ciment dans un livre d’entretiens. Mais ce personnage est très complexe, et Alain l’est lui aussi – c’est mon avis, qu’il ne partage peut-être pas – une personnalité assez autodestructrice et à la recherche de sa propre identité. Tous les aspects de sa vie sont d’une grande complexité et souvent contradictoires. Par exemple, c’est un acteur très coopératif, mais il y eut deux ou trois jours où il ne l’a pas été. Un jour, je lui dis :“Qu’est-ce qui ne va pas Alain ? – Rien.”J’insistai, et il me répondit : “Oh ! Je me trouve merdique, et tout le monde est merdique, sauf vous, évidemment ! – Que voulez-vous dire ? – Il y a des jours où je me trouve merdique, où je trouve le monde entier merdique, et tous les gens, et le cinéma, et je n’aime pas ce décor, et rien de tout cela ne me plaît.” »
« Il est une tragédie »
Sur le tournage, Joseph Losey fait donc face à un Delon coopératif et complexe. Le réalisateur américain écrit à son épouse, Patricia Losey, à la date du 22 janvier 1976 : « Hier fut une de mes pires journées professionnelles, bien que le travail en fin de compte se soit avéré bon. Comportement de la part d’Alain qui nous a retardés de pratiquement une demi-journée et a failli arrêter le film. Je n’ai pas la moindre idée du pourquoi, sauf, peut-être, son ego. (…) Au cas où tu t’inquiéterais à propos de ce que je t’ai dit plus haut concernant Alain, il se comporte parfaitement bien avec moi, est plutôt un homme brisé et triste. Il est une tragédie. »
Monsieur Klein est présenté en compétition au Festival de Cannes en 1976, l’année où Taxi Driver, de Martin Scorsese, remporte la Palme d’or. Delon n’effectue pas le déplacement sur la Croisette pour un film qu’il n’a pas encore vu. Costa-Gavras, qui fait partie du jury présidé par Tennessee Williams, bataille pour que Delon obtienne le prix d’interprétation. Mais il n’y parvient pas : « Il y a eu une levée de boucliers contre Delon. Pour des raisons politiques peut-être. Il méritait tellement ce prix… »
Lorsque l’acteur découvre plus tard le film dont la sortie est fixée au 27 octobre 1976, il est enthousiaste. « Il a remercié Losey d’avoir réalisé un grand film, se souvient Pierre-William Glenn, le caméraman de Monsieur Klein. Son bonheur de se voir dans ce film-là était évident. Il était ravi. Il avait le sentiment d’avoir participé à une œuvre qui resterait dans l’histoire. » Avec 700 000 entrées en France, c’est un échec, ouvrant chez Delon une blessure jamais refermée. « Des années après, déplore Delon, quand ça passe à la télévision, on vous dit des choses du genre :“Oh mais dites-moi, Monsieur Klein, c’est magnifique !”Que n’y sont-ils allés à la sortie ? »
Sur l’affiche du film, le visage de Delon apparaît au milieu d’une étoile de David, comme prisonnier d’un destin et d’une histoire implacables. Avant de lui montrer l’affiche, tout le monde dit à Norbert Saada que jamais Delon ne l’acceptera : trop sombre, pas assez commerciale. « Mais il a écrit dessus dans l’instant : “Bon pour accord”. »
L’acteur, révélé dix-sept ans plus tôt avec Plein soleil, dans la lumière éclatante de la côte amalfitaine, croise cette fois le soleil noir de la déportation. Une manière de clore une histoire. Son histoire.
« Jouer Klein, un rôle de Monsieur Dupont, avec son chapeau feutre et sa gueule de con… Vous connaissez quelqu’un d’autre pour faire ça ? », déclare Alain Delon à la revue Cinématographe, en 1994, dix-huit ans après la sortie de Monsieur Klein, de Joseph Losey.
Oui, il peut y avoir d’autres acteurs. Mais ce qui est sûr, c’est que ce profil d’un marchand d’art sous l’Occupation achetant à vil prix les tableaux de Français juifs aux abois – l’anti-héros par excellence – colle parfaitement à ce comédien atypique et imprévisible. Qui aime se décider dans l’instant.
Lorsque le producteur Norbert Saada lui apporte le matin un scénario signé par le réalisateur de Z et de L’Aveu, Costa-Gavras, et Franco Solinas, qui a écrit celui de La Bataille d’Alger (1966), de Gillo Pontecorvo, un film interdit en France et qui devra attendre cinq ans avant sa sortie en salle, Delon donne son assentiment le soir même. Avec enthousiasme.
La rafle de 13 000 juifs, voulue par les Allemands mais organisée par le régime de Vichy, arrêtés les 16 et 17 juillet 1942, dont plus de la moitié seront emmenés au Vélodrome d’Hiver, dans le 15e arrondissement de Paris, puis déportés vers les camps d’extermination nazis, reste, comme l’explique Delon, un sujet brûlant, « qui faisait peur à tout le monde ». Mais le sujet n’entame en rien sa témérité : « Ce film, je devais le faire », déclare-t-il au Monde en 2003.
Il tient tant à s’impliquer qu’il endosse, en plus de celle de vedette, la casquette de coproducteur. Sa décision est impérative, dictée par une responsabilité. Cela n’a rien de surprenant pour un acteur qui a autrefois abordé, avec la même urgence, la question de la guerre d’Algérie dans L’Insoumis (1964), d’Alain Cavalier, puis dans Les Centurions (1966), de Mark Robson.
« Alain connaissait l’épisode du Vélodrome d’Hiver, insiste Norbert Saada. Il est né en 1935, il n’a pas feint la surprise. Il avait 7 ans en 1942, le fait qu’il ait été contemporain de cet événement l’avait frappé. Il était au courant de ce qui se passait, des horreurs commises. Il ne découvrait rien. Après avoir lu le scénario, il ne m’a posé aucune question là-dessus. Il savait. »
A rebours du discours dominant sur une France résistante
C’est un autre comédien, et pas n’importe lequel, qui, à l’origine, doit incarner Monsieur Klein : Jean-Paul Belmondo. Sous la direction alors de Costa-Gavras. Ce dernier commence, en 1973, avec Franco Solinas, l’écriture d’un film sur la rafle du Vélodrome d’hiver.
Ce tabou, bien réel, d’un gouvernement français qui a assassiné une partie de sa population, car juive, devient une question centrale en France à partir du début des années 1970. Le Chagrin et la Pitié, en 1969, avec sa réception controversée et son impact considérable, est passé par là. Le documentaire de Marcel Ophuls met en avant, à travers la chronique d’une ville française, Clermont-Ferrand, entre 1940 et 1944, des comportements quotidiens pour le moins ambigus, voire de franche collaboration avec l’occupant allemand – à rebours du discours dominant sur une France résistante.
La publication en 1972, aux Etats-Unis, de l’ouvrage fondateur de l’Américain Robert O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, traduit en France l’année suivante, qui met en avant le rôle central du gouvernement de Pétain dans la déportation des juifs, signifie qu’un passé douloureux remonte à la surface. Costa-Gavras et Solinas travaillent d’ailleurs en partie à partir de cet ouvrage. Le tandem cherche un angle lui permettant de raconter le passé vichyste de la France.
Un témoignage du Chagrin et la Pitié frappe Gavras. Un commerçant du nom de Marius Klein fait publier, dans les années 1940, une annonce dans un journal local afin de faire savoir que son nom n’est pas juif. A partir de cette simple histoire, Gavras et Solinas trouvent le fil rouge de leur scénario autour de la question de l’identité. Qui est juif ? Qui ne l’est pas ? Qui est susceptible d’être déporté ou pas ? Que faire si un nom ne permet pas de trancher avec certitude ? Klein peut être le nom d’un juif ou d’un chrétien. Jean-Paul Belmondo incarnera celui qui, selon l’expression de Gavras, « allait être pris au piège de son nom ».
Un exemple d’inhumanité
Pour des raisons complexes liées, selon Costa-Gavras, aux conditions financières extravagantes réclamées par Robert Kuperberg et Jean-Pierre Labrande, à l’origine les deux producteurs de Monsieur Klein, Jean-Paul Belmondo, furieux et blessé, se retire.
Le projet atterrit en 1975 entre les mains de Delon, qui propose naturellement à Costa-Gavras de le mettre en scène. Mais ce dernier, qui a pensé et écrit ce film pour Belmondo, concevant pour lui certaines scènes, préfère se retirer, au point d’enlever son nom du générique. Un geste compris par Delon.
L’acteur a alors l’idée, brillante, de proposer Monsieur Klein à Joseph Losey. Il le connaît, a travaillé avec lui sur L’Assassinat de Trotsky (1972), où l’acteur incarne l’assassin du révolutionnaire russe. Losey fait partie de ses maîtres, en compagnie de René Clément, Visconti et Melville, sous l’autorité desquels l’acteur pense laisser une trace dans l’histoire.
Au début des années 1950, le réalisateur américain fuit les Etats-Unis et le maccarthysme pour échapper à la liste noire. Il s’installe en Angleterre où il tourne au long des années 1960 quelques chefs-d’œuvre parmi les plus achevés de la décennie – The Servant, Accident, Cérémonie secrète.
Ce marchand d’art, Robert Klein, contraint pour survivre de justifier sa véritable identité, se trouve en phase avec plusieurs grands rôles de l’acteur. Delon est si souvent double à l’écran...
Losey trouve dans le scénario de Franco Solinas des résonances intimes. La période de l’Occupation symbolise à ses yeux la monstrueuse indifférence de l’homme pour d’autres individus, un exemple d’inhumanité, sur lequel il se documente de manière obsessionnelle, dans le but d’en acquérir une compréhension intime.
Losey s’appuie pour cela sur l’expérience personnelle de plusieurs membres de la future équipe de Monsieur Klein : Alexandre Trauner, un juif hongrois qui a clandestinement conçu les décors des Enfants du paradis (1945), de Marcel Carné ; la responsable du casting, Margot Capelier, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps ; Claude Lyon, directeur de laboratoire à LTC, dont la mère est morte en déportation.
Alain Delon.
Alain Delon. LIRA - NOVA / PROD DB
En outre, ce profil d’un citoyen pris pour un autre, qui a confiance dans son gouvernement et les institutions de la France, dont la famille « est française et catholique depuis Louis XIV », cet individu confondu avec un homonyme juif, trouve chez Losey un écho avec le maccarthysme où, parfois, des individus portant juste les prénom et nom d’une autre personne figurant sur la liste noire se trouvent privés de leur travail.
Franco Solinas a été membre du Parti communiste italien. Losey avait rejoint le Parti communiste américain dans les années 1940 – un choix qui scelle son sort dans son pays natal. Alain Delon, dont les opinions politiques penchent à droite, est loin de cette sphère. Seul le critère artistique importe à ses yeux. Et c’est lui, avec la double casquette de vedette et de coproducteur, qui permet à cet alliage improbable mais si probant – un scénariste italien, un metteur en scène américain, une star française – de concevoir le plus grand film jamais réalisé sur la France de Vichy.
L’acteur, révélé dix-sept ans plus tôt avec « Plein Soleil », dans la lumière éclatante de la côte amalfitaine, croise, cette fois, le soleil noir de la déportation
Lorsque Monsieur Klein est annoncé, le film arrive en fin de comète sur la période de l’Occupation. Dans la foulée du Chagrin et la Pitié sortent sur les écrans Lacombe Lucien (1974), de Louis Malle, d’après un scénario de Patrick Modiano ; Les Guichets du Louvre (1974), de Michel Mitrani, sur la rafle de juillet 1942 déjà ; Section spéciale (1975), de Costa-Gavras. Mais, loin d’arriver en retard, Monsieur Klein surplombe cet ensemble et le domine.
Joseph Losey est si frappé par le discours du président de la République Valéry Giscard d’Estaing prononcé le 18 juin 1975 à Auschwitz qu’il lui écrit pour lui demander l’autorisation d’utiliser dans son film le passage relatif à la rafle du Vél’d’Hiv. Le chef de l’Etat évoque une tache noire dans l’histoire de France qui ne peut se dissiper tant elle traverse les histoires individuelles : « Nous les avons vus partir ; je les ai vus partir. Le matin du 16 juillet 1942, nous avons été réveillés par le bruit inhabituel des autobus parcourant avant le lever du jour les avenues de Paris. On y apercevait des silhouettes sombres, avec leurs manteaux et de petites valises. Quelques heures plus tard, on apprenait qu’il s’agissait de juifs qui avaient été arrêtés à l’aube et qu’on rassemblait au Vélodrome d’Hiver. J’avais observé qu’il y avait parmi eux des enfants de notre âge, serrés et immobiles, le regard écrasé sur la vitre, pendant la traversée de cette ville glacée, à l’heure faite pour la douceur du sommeil. Je pense à leurs yeux noirs et cernés, qui sont devenus des milliers d’étoiles dans la nuit. »
L’occupant nazi reste invisible à l’écran
Giscard donne son accord à Losey, mais ce dernier, sur l’insistance de Franco Solinas, abandonne l’idée. Sans doute pour cette raison : à l’instar de son prédécesseur à l’Elysée, Georges Pompidou ou, de son successeur, François Mitterrand, Giscard ne souligne jamais la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs – Jacques Chirac sera le premier chef d’Etat à le faire.
Dans Monsieur Klein, au contraire, l’occupant nazi reste invisible à l’écran, entièrement occupé par la police et l’administration de Vichy. Car la rafle du Vél’ d’Hiv est une histoire française. Une histoire aussi sans image. Il n’existe comme document visuel qu’une seule photographie de l’événement.
Cette rafle, effectuée à huis clos, à l’aube, profitant du calme de l’été, s’est efforcée de ne laisser aucune trace. Même le vélodrome est détruit en 1959, obligeant l’équipe du tournage à tourner la scène au vélodrome Jacques-Anquetil, à Vincennes. Ainsi, Monsieur Klein reconstitue ce qui a été effacé.
Une cohérence d’un film à l’autre
« L’idée de jouer quelqu’un qui découvre qu’il a des origines juives me séduisait beaucoup, dit Delon. Je trouvais l’évolution du personnage très forte. » Ce marchand d’art, Robert Klein, contraint pour survivre de justifier sa véritable identité, se trouve en phase avec plusieurs grands rôles de l’acteur.
Delon est si souvent double à l’écran… Dans Plein soleil (1959), de René Clément, il tue son ami pour endosser son identité. Avec La Tulipe noire (1964), de Christian-Jaque, il fait face à un frère jumeau, ou dans William Wilson, le segment d’Histoires extraordinaires (1968), adapté d’une nouvelle d’Edgar Poe et réalisé par Louis Malle, Delon est confronté à son double. Il y a surtout ses rôles chez Melville, dans Le Samouraï et Le Cercle rouge, et chez Visconti, avec Le Guépard, déjà abordés dans cette série, où l’acteur croise systématiquement un miroir, contemplant son propre reflet, dans le vertige d’une identité toujours plus indiscernable.
Avec Monsieur Klein, Delon se lance à la poursuite de son ombre, d’abord pour la confondre, ensuite pour l’accompagner dans son destin funeste. Au point de rejoindre son double dans un train de déportation. Le dialoguiste Pascal Jardin notait, au sujet de Delon : « Tous les personnages qui cohabitent en lui s’entendent mal entre eux. »
Pour cet acteur qui bâtit sa carrière en stratège, et aussi en auteur, dressant une cohérence d’un film à l’autre, pour dessiner son autoportrait, Monsieur Klein devient ce film impossible à refuser. Il confronte Delon à l’urgence de l’histoire, et à sa propre histoire, en posant toujours la même question : qui suis-je ?
Lorsque Delon/Klein achète pour une somme dérisoire auprès d’un juif une toile d’Adriaen van Ostade représentant le portrait d’un gentilhomme hollandais raccompagnant son vendeur à la porte, il s’arrête devant un miroir accroché dans le vestibule et y contemple son visage livide, défait. Il se demande pour la première fois qui est Robert Klein.
Plus tard, au moment de quitter La Coupole, il est confronté au même reflet, dans la vitrine du restaurant où il dîne avec ses amis et sa maîtresse. Michael Lonsdale, qui incarne son avocat, chargé de trouver les extraits de naissance de ses grands-parents afin de prouver que son client n’est pas juif, se souvient de l’insistance de Delon pour filmer ce reflet. Delon dit : « Non, la caméra, là, ce n’est pas mon bon profil, il faut la mettre là, parce qu’il y a un reflet dans la glace. » Losey lui répond : « C’est moi le metteur en scène. » Et Delon : « Oui, mais moi je suis le producteur. » « Delon, ajoute Lonsdale, était avec son garde du corps et ses chiens. J’ai voulu caresser le chien. Delon m’a répondu :“Touche pas, il mord.” »
« Ce personnage est très complexe, Alain l’est aussi »
En 2014, Delon confie au Figaro, à l’occasion de la ressortie sur les écrans de Monsieur Klein, une photo de tournage. L’acteur est assis, avec le manteau de cachemire beige qu’il porte la plupart du temps dans le film. Son père, à côté de lui, l’observe, fasciné par les multiples personnalités de son fils.
Delon semble ailleurs, comme happé par le personnage qu’il incarne. La photo est affichée dans le bureau de l’acteur. C’est l’une des rares dont il ne se sépare jamais. A la veille d’être englouti dans la rafle du Vél’ d’Hiv, Monsieur Klein contemple une dernière fois la toile d’Adriaen van Ostade, représentant ce gentilhomme qui pourrait être son père.
« Il est difficile de dire qu’il y a beaucoup d’Alain dans le personnage, puisque celui-ci n’est pas très plaisant, et je ne veux pas du tout dire cela, confie Joseph Losey à Michel Ciment dans un livre d’entretiens. Mais ce personnage est très complexe, et Alain l’est lui aussi – c’est mon avis, qu’il ne partage peut-être pas – une personnalité assez autodestructrice et à la recherche de sa propre identité. Tous les aspects de sa vie sont d’une grande complexité et souvent contradictoires. Par exemple, c’est un acteur très coopératif, mais il y eut deux ou trois jours où il ne l’a pas été. Un jour, je lui dis :“Qu’est-ce qui ne va pas Alain ? – Rien.”J’insistai, et il me répondit : “Oh ! Je me trouve merdique, et tout le monde est merdique, sauf vous, évidemment ! – Que voulez-vous dire ? – Il y a des jours où je me trouve merdique, où je trouve le monde entier merdique, et tous les gens, et le cinéma, et je n’aime pas ce décor, et rien de tout cela ne me plaît.” »
« Il est une tragédie »
Sur le tournage, Joseph Losey fait donc face à un Delon coopératif et complexe. Le réalisateur américain écrit à son épouse, Patricia Losey, à la date du 22 janvier 1976 : « Hier fut une de mes pires journées professionnelles, bien que le travail en fin de compte se soit avéré bon. Comportement de la part d’Alain qui nous a retardés de pratiquement une demi-journée et a failli arrêter le film. Je n’ai pas la moindre idée du pourquoi, sauf, peut-être, son ego. (…) Au cas où tu t’inquiéterais à propos de ce que je t’ai dit plus haut concernant Alain, il se comporte parfaitement bien avec moi, est plutôt un homme brisé et triste. Il est une tragédie. »
Monsieur Klein est présenté en compétition au Festival de Cannes en 1976, l’année où Taxi Driver, de Martin Scorsese, remporte la Palme d’or. Delon n’effectue pas le déplacement sur la Croisette pour un film qu’il n’a pas encore vu. Costa-Gavras, qui fait partie du jury présidé par Tennessee Williams, bataille pour que Delon obtienne le prix d’interprétation. Mais il n’y parvient pas : « Il y a eu une levée de boucliers contre Delon. Pour des raisons politiques peut-être. Il méritait tellement ce prix… »
Lorsque l’acteur découvre plus tard le film dont la sortie est fixée au 27 octobre 1976, il est enthousiaste. « Il a remercié Losey d’avoir réalisé un grand film, se souvient Pierre-William Glenn, le caméraman de Monsieur Klein. Son bonheur de se voir dans ce film-là était évident. Il était ravi. Il avait le sentiment d’avoir participé à une œuvre qui resterait dans l’histoire. » Avec 700 000 entrées en France, c’est un échec, ouvrant chez Delon une blessure jamais refermée. « Des années après, déplore Delon, quand ça passe à la télévision, on vous dit des choses du genre :“Oh mais dites-moi, Monsieur Klein, c’est magnifique !”Que n’y sont-ils allés à la sortie ? »
Sur l’affiche du film, le visage de Delon apparaît au milieu d’une étoile de David, comme prisonnier d’un destin et d’une histoire implacables. Avant de lui montrer l’affiche, tout le monde dit à Norbert Saada que jamais Delon ne l’acceptera : trop sombre, pas assez commerciale. « Mais il a écrit dessus dans l’instant : “Bon pour accord”. »
L’acteur, révélé dix-sept ans plus tôt avec Plein soleil, dans la lumière éclatante de la côte amalfitaine, croise cette fois le soleil noir de la déportation. Une manière de clore une histoire. Son histoire.
"Le deuxième souffle" n'est pas dans le coffret, il n'existe que dans une version pourlingue René Chateau ou pour plus cher dans une belle version chez Criterion, du coup je vais peut être me saigner.
Pour Clouzot déjà fait l'an passé, à l'époque de la sortie du superbe coffret intégral DVD et suite à mon traumatisme "Sorcerer". Folie sur folie.
Sinon hier je me suis fait "Classe tous risques" de Sautet avec Belmondo et Ventura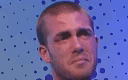
T'es un chef NumeroStar
Pour Clouzot déjà fait l'an passé, à l'époque de la sortie du superbe coffret intégral DVD et suite à mon traumatisme "Sorcerer". Folie sur folie.
Sinon hier je me suis fait "Classe tous risques" de Sautet avec Belmondo et Ventura
T'es un chef NumeroStar
Beau film "Classe tous risques". La musique de Georges Delerue est magnifique, notamment dans la scène ou Lino Ventura laisse ses enfants à une nourrisse et la réplique de Belmondo quand Lino lui dit que ses gosses se sont déjà fait des amis : "Oh tu sais à cet âge là, en 5 minutes tu te fais des copains"
Un bien joli film le dernier Clint.
Voilà, c'est fini maintenant, il approche les 90 ans, peu de chance qu'on le revoit. Je pensais que Gran Torino était le dernier, mais il apporte encore une dernière touche toute en mélancolie et parle plus que jamais de lui, c'était bien.
Voilà, c'est fini maintenant, il approche les 90 ans, peu de chance qu'on le revoit. Je pensais que Gran Torino était le dernier, mais il apporte encore une dernière touche toute en mélancolie et parle plus que jamais de lui, c'était bien.
Devant le succès à raison de la saga Delon, aujourd'hui topo sur le Guépard:
Delon en six films-cultes (2/6). Le cinéaste italien voit dans l’acteur, qui le subjugue, un talent, dont il veut faire sa créature. Dans « Rocco et ses frères », puis en 1961 dans « Le Guépard », qui lui vaut une reconnaissance internationale.
Pendant le tournage de Plein soleil, où il assiste René Clément, Dominique Delouche contemple un jour Alain Delon avec un peu plus d’insistance. Cette fascination doit moins à la stupéfaction qu’à l’impression de reconnaître un visage familier. L’acteur l’interpelle : « Mais qu’est-ce qui te prend ? » Sans se démonter, Dominique Delouche lui répond : « On ne t’a jamais dit que tu avais un visage dessiné par Botticelli ? » Delon se met alors à rougir : « Si. » Dominique Delouche : « Visconti ? » Delon : « Oui. »
Le nom de Luchino Visconti explique en partie l’assurance du jeune homme de 23 ans sur le plateau romain de Plein soleil. Car le cinéaste italien, auteur de Senso (1954) puis de Nuits blanches (1957), lui a fait une promesse. Il s’est engagé à lui offrir le rôle principal de son nouveau film, Rocco et ses frères, dont le tournage doit débuter en février 1960, un mois avant la sortie française de Plein soleil. Après l’enseignement auprès de René Clément, Delon sait aussi que son apprentissage doit passer par un second maître. Peut-être le plus grand.
Pour son « Rocco », qu’il projette de tourner à Milan, Visconti veut raconter l’histoire d’une mère et de ses cinq fils, partis dans les années 1950 de l’extrême sud de la botte italienne, la région la plus misérable du pays, pour s’établir au nord, dans la prospère et industrielle Milan. Ces fils doivent tout à leur mère, imagine le metteur en scène, et cette dernière les voit à travers le prisme déformant du rêve : forts, grands, magnifiques, invincibles. Au sein de cette fratrie, Rocco Parondi apparaît comme le joyau, l’ange du bien, détenteur d’une force brute, et pourtant pacifique, qu’il manifeste sur un ring de boxe. Un personnage inspiré du Prince Mychkine de L’Idiot de Dostoïevski.
Mais Visconti se heurte à un écueil. Il ne trouve personne pour interpréter Rocco, ni en Italie ni en France. Sans cet acteur providentiel, il renoncera à son film. Alors il parle longuement de ce Rocco avec Olga Horstig, l’agent d’Alain Delon et de grandes stars françaises – Michèle Morgan, Edwige Feuillère, Brigitte Bardot. Olga Horstig présente Delon à Visconti le 9 mai 1959, à Londres, au Royal Opera House, lors de la première de Don Carlo, l’opéra de Verdi dont il est le metteur en scène. Visconti regarde le jeune homme quelques instants, puis se tourne vers son agent et lui glisse à l’oreille : « J’ai vu Rocco. » Delon possède, selon le mot de Visconti, cette « mélancolie de qui se sent forcé de se charger de haine quand il se bat, parce que, d’instinct, il la refuse ». Visconti décèle en Delon un talent brut qu’il va s’efforcer de polir, avec d’autant plus de force et de sévérité que l’acteur, encore docile, a vocation à l’accompagner longtemps dans sa carrière.
« On sait, écrit Dominique Delouche, que la notion d’éblouissement a jalonné la vie créative comme la vie intime de Visconti. Cette fois, il avait reconnu le héros qui remplissait alors son imaginaire, Rocco. Sous les yeux d’une jet-society intriguée et complice, Visconti intronisait son invité, l’ex-petit engagé d’Indochine, dans un royaume où il se savait souverain : l’Art, l’Opéra et le “grand monde”. Alain y serait son féal. »
« On ne t’a jamais dit que tu avais un visage dessiné par Botticelli ? » Delon se met alors à rougir : « Si. » Dominique Delouche : « Visconti ? » Delon : « oui »
Ce rapport de maître à sujet est frappant dans une des premières interviews télévisées de Delon. Alors qu’il prépare son rôle pour Rocco et ses frères, il est interrogé sur un ring de boxe par le journaliste François Chalais, qui lui demande : « Est-ce que vous pensez être un être fort ou un être faible ? » « Un peu des deux », répond Delon, timide, torse nu, la sueur encore dégoulinante. Il est à l’évidence surpris par l’absolu d’une telle question. Il reprend alors son souffle et lâche : « Des moments très fort et des moments aussi très faible. »
A l’époque, Delon réclame encore de la sévérité au démiurge Visconti. « J’ai besoin qu’on me tienne, explique l’acteur, se comparant à un pur-sang à dompter, il ne faut surtout pas me laisser aller. » Durant le tournage de Rocco, dans une scène où il sort d’un combat de boxe, Visconti lui intime l’ordre de pleurer. Delon utilise de l’ammoniaque, fourni par une maquilleuse. Après avoir découvert le subterfuge, Visconti lui hurle dessus. « On avait entendu sa colère dans tout Rome. Il pouvait faire exploser le Colisée sur un coup de colère », dira Delon.
« Une prétention à l’exclusivité »
L’apprentissage de l’acteur se poursuit en mars 1961, au Théâtre de Paris, où Visconti met en scène le couple Romy Schneider-Alain Delon dans Dommage qu’elle soit une putain, du dramaturge élisabéthain John Ford. L’Italien doit faire face à plusieurs écueils. A commencer par la réalité de ce jeune couple, qui s’est formé sur le plateau de Christine (1958), de Pierre Gaspard-Huit, et surnommé par la presse « les fiancés de l’Europe ». Un couple qui laisse Visconti s’approcher de lui et observer sa passion. Cette place, le réalisateur s’en accommode avec plus ou moins de bonne volonté. « Luchino, expliquait Romy Schneider, aimait Alain parce qu’il flairait en lui la matière brute du grand acteur. Il entendait donner forme à cette matière, et ce, de façon tyrannique, avec une prétention à l’exclusivité. »
Ni Delon ni Schneider ne sont jamais montés sur une scène de théâtre. Visconti insiste alors pour qu’ils soient associés dans le spectacle à des grands comédiens de l’époque, Daniel Sorano et Sylvia Monfort, ce qui crée chez les deux débutants un sentiment de panique. A chaque répétition, Schneider sent le regard de Visconti, inquisiteur, impitoyable, proférant humiliations et menaces. Delon demande à s’absenter un moment pour négocier le rôle de Shérif Ali ibn el Kharish dans Lawrence d’Arabie, le film que prépare David Lean (finalement joué par Omar Sharif), et Visconti parvient à contrecarrer son désir. Le réalisateur italien garde la mainmise sur le couple. Et sa façon d’en parler est assez claire : « Je les avais complètement “fabriqués” en dehors des autres. »
Un peu moins de deux ans après Rocco, en décembre 1961, Delon retrouve Visconti pour le tournage du Guépard, et c’est une tout autre histoire qui commence. Car il n’est plus le même acteur. Il est devenu une star dominante. Sa faiblesse, il la réserve désormais exclusivement aux personnages qu’il incarne. L’effet du temps qui passe devient visible chez Delon, sur au moins un détail : le front. Les rides, au nombre de trois, dès qu’il plisse son visage, signifient, davantage que sa métamorphose en homme, un temps qui se comprime, une intensité spéciale. Le perfectionnisme, l’exigence, l’obsession du détail, la violence colérique, la rigueur disciplinaire et le pouvoir démiurgique de Visconti se sont exercés avec une intensité qui rappelle combien l’effet Delon repose sur une discipline spartiate.
Le guépard, ce félin unique en son genre, symbole d’une noblesse en voie de disparition, désigne, tant dans l’unique roman de l’aristocrate italien Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en 1958, que dans l’adaptation de Luchino Visconti, Don Fabrizio Corbera, Prince de Salina. En 1860, après l’arrivée en Sicile des troupes de Garibaldi, ce dernier regarde, depuis son palais de Palerme, avec mélancolie et fatalisme, les bouleversements politiques menant à l’unification de l’Italie. Le Prince Salina, conscient de l’impossibilité d’arrêter le cours de l’Histoire, décide d’aider son neveu, Tancrède Falconeri, avec lequel il entretient une relation filiale, à rejoindre les combattants volontaires ayant suivi Garibaldi dans sa marche sur la capitale sicilienne.
Visconti intronisait son invité, l’ex-petit engagé d’Indochine, dans un royaume où il se savait souverain : l’art, l’opéra et le « grand monde ». Alain y serait son féal
Le Prince Salina est interprété par un acteur hollywoodien, Burt Lancaster. Tancrède, son neveu, prend chair avec l’interprétation complexe, magnétique, moderne, d’Alain Delon. « Tancrède, explique Visconti, n’est pas seulement un être vorace et cynique. Encore au début du processus de déformation et de corruption, on peut voir se refléter sur sa personne ces éclairs de civilisation, de noblesse et de virilité que l’immobilité féodale a cristallisés et précisément immobilisés sans espoir d’avenir chez le prince Fabrizio. »
Le Prince Salina qui voit, au soir de sa vie, mourir son univers, c’est bien entendu Visconti, 57 ans en 1963. C’est d’ailleurs ce qui rend Le Guépard extraordinairement vrai : Visconti pose sur ce monde, dont il est issu, un regard ordinaire. Tancrède Falconeri, qui passe des garibaldiens aux troupes de l’armée royale, c’est aussi Visconti, le Visconti de 30 ans qui a effectué le chemin inverse, de l’aristocratie vers le marxisme. Et le mariage entre Tancrède et Angelica, à laquelle Claudia Cardinale prête sa beauté, cette fille d’un propriétaire foncier que méprise Salina mais dont il a compris l’importance à cette période de bascule historique, évoque l’union de raison des parents de Visconti – son père, le duc de Modrone, avait épousé en 1900 Donna Carla Erba, riche héritière d’une fortune industrielle.
« L’humilier devant tout le monde »
Dans sa biographie du réalisateur italien, Visconti, Une vie exposée (Ed. Folio, 2009), Laurence Schifano décrit l’implication absolue du metteur en scène sur le plateau du Guépard : « Les quintaux de fleurs fraîches envoyées chaque jour par avion de San Remo, les vraies chandelles sur le lustre qu’il fallait remplacer toutes les heures, les cuisines installées à proximité de la salle de bal pour que les rôtis et les plats arrivent encore fumants, la lingerie disposée au rez-de-chaussée pour qu’on puisse nettoyer les gants blancs des hommes qui, au bout de quelques heures, se tachaient de sueur, les leçons de valse, de mazurka et de galop prodiguées par des maîtres à danser, les vaisselles d’or et d’argent prêtées par les plus anciennes familles de Palerme, la sélection minutieuse des figurants chargés d’apparaître dans les scènes de combats de rue, selon le type morphologique de chaque région. »
Cette obsession de la perfection et de la vérité de chaque accessoire transpire jusqu’aux comédiens, mis au service de la symphonie orchestrée par Visconti. Celui-ci choisit le tissu de la veste de Delon, la couleur de sa chemise, son bracelet, sa montre…
Nous avons demandé à Claudia Cardinale, 80 ans, rare et précieux témoin, d’évoquer à nouveau Le Guépard, et d’emblée, ce qu’elle retient, c’est l’exigence et l’intransigeance de Visconti. Par exemple l’ordre qu’il lui donne de ne pas se laver les cheveux, seul moyen de leur donner une lourdeur qui définit les coiffures romantiques. Elle se souvient aussi de la sévérité initiale que le cinéaste impose à Burt Lancaster afin de marquer son territoire devant cette star hollywoodienne. Et quand avec Delon elle visite les salles du palais, Visconti insiste pour qu’il n’y ait entre eux ni faux gestes, ni fausses caresses, ni faux baisers, insistant pour que les deux fiancés mettent la langue.
Entre complicité et hostilité
La relation entre Delon et Visconti ? Complexe, répond Claudia Cardinale. Entre complicité et hostilité. La complicité, c’est quand l’acteur sert d’instrument idéal, de porte-parole sur le plateau, afin de rendre plus fluide la dynamique de certaines séquences. « Il y a cette scène, explique Claudia Cardinale, où j’arrive dans le salon du palais, devant toute cette noblesse raffinée. Les regards convergent vers Angelica que j’incarne. Mon personnage n’est pas très bien habillé, la robe est un peu trop serrée, Angelica n’est pas de ce monde, mais il y a ce regard… Pendant la scène du dîner qui suit, Alain me raconte une histoire inconvenante de batifolage avec des nonnes, dont le spectateur est le témoin, ce qui provoque chez moi un rire un peu vulgaire, et toute la table, pétrifiée, me regarde. Mais pour obtenir ce rire – ce que l’on ne sait pas –, Alain m’avait susurré à l’oreille d’autres blagues, provoquant ce fameux rire que je n’arrivais plus à contrôler. »
Et puis il y a l’hostilité, l’humiliation même. Parce que Visconti sent que son acteur-relais lui échappe. Et là, Claudia Cardinale confie cette autre anecdote : « Visconti n’était pas satisfait de la façon dont Alain avait interprété la scène où nous courons à travers le grenier. Il en avait profité pour lui dire tout ce qu’il pensait, il voulait l’humilier devant tout le monde. » Face à un Visconti qui s’emporte, Cardinale et Delon se trouvent assis côte à côte sur un petit canapé. L’acteur lui prend la main et la serre pour se contenir, pour ne pas répondre. Il va presque la lui broyer.
Alain Delon et Luchino Visconti ne tourneront plus jamais ensemble. Le cinéaste sent-il durant le tournage du Guépard que son acteur ne sera plus jamais sa créature, qu’il est en train de lui échapper ? Car ce dernier a déjà la tête ailleurs : il pense au tournage imminent de Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil, où il va retrouver un autre partenaire à l’écran, Jean Gabin. Un autre mentor. Visconti vit mal cette « infidélité ». Ce metteur en scène amoureux des hommes et admirateur des femmes comprend que façonner l’acteur Delon ne lui permettra pas de changer l’homme Delon. Car si ce dernier défie les catégories, la préservation, presque maladive, de son intimité devient la condition de sa liberté.
Lors d’un entretien au Nouvel Observateur, en 1969, le journaliste Olivier Todd fait part à Delon des rumeurs d’homosexualité qui circulent à son sujet. L’acteur répond avec le brio de celui qui incarne mieux qu’un autre une époque qui entend briser les carcans : « Si j’avais eu envie d’avoir des aventures avec des hommes, de quoi serais-je coupable ? En amour, tout est permis. Vous connaissez la formule de Michel Simon : “Si j’ai envie de ma chèvre, je m’enverrai ma chèvre.” » Puis d’ajouter, en hommage direct à Visconti : « Je me souviens de cette phrase du personnage de Putana dans Dommage qu’elle soit une putain : “Si une jeune fille se sent en disposition, qu’elle prenne n’importe qui, père ou mère, c’est tout comme.” »
Une photo sur sa table de nuit
La figure de Delon plane pourtant sur le reste de l’œuvre de Visconti. L’acteur doit incarner le frère incestueux de Claudia Cardinale dans Sandra (1965) que jouera finalement Jean Sorel. Puis Meursault dans L’Etranger, de Camus, qu’adapte Visconti en 1967 avec Mastroianni. C’est une erreur de casting, que le maestro italien déplorera. Car Delon avait donné son accord pour un rôle qui lui colle à la peau. Cet homme qui, dans le roman de Camus, dit ce qu’il est, refuse de masquer ses sentiments, éprouve à l’égard du meurtre qu’il a commis plus d’ennui que de regret véritable, c’est Delon.
Mais le producteur, Dino de Laurentiis, refuse le cachet réclamé par l’acteur. Delon peut réciter, encore aujourd’hui, et de mémoire, des passages entiers du roman de Camus, sa chute par exemple : « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. »
La vedette de Rocco et ses frères doit encore jouer le narrateur d’A la recherche du temps perdu que Visconti cherchera, sans succès, à adapter. Et pour son ultime film, en 1976, Visconti offre à Delon le rôle du mari du couple sadomasochiste de L’Innocent, mais l’acteur préfère décliner, disant qu’il ne veut pas voir Visconti dans une chaise roulante. On dit que Visconti avait posé une photo d’Alain Delon sur sa table de nuit, à la manière d’une image impossible qui hante ses films ; une image, et un vide impossible à combler.
« Mon jardin secret »
Lorsque la version restaurée du Guépard est présentée au Festival de Cannes, en 2010, quarante-sept ans après avoir obtenu la Palme d’or, Alain Delon se retrouve à côté de Claudia Cardinale. A la fin de la projection, il chuchote à sa partenaire, qu’il appelle encore parfois Angelica : « Tu as vu ? Ils sont tous morts. » L’acteur a conservé quelques objets du Guépard, comme ceux de plusieurs autres films. Sa maison est le musée de cette mémoire. Il ne revoit presque jamais ses films. « Cela remue des souvenirs, explique-t-il, trop d’images, et puis tous ces acteurs que l’on revoit vivants, vivre, alors que je sais qu’ils ne sont plus là. »
La scène que Delon préfère dans Le Guépard est celle du bal, ce moment où transparaît chez Tancrède une admiration pour le Prince Salina en même temps qu’une pointe de nervosité alors qu’Angelica s’approche de ce dernier pour l’embrasser. Salina montre alors aux deux amants, dans son boudoir, son tableau de chevet : La Mort du juste, de Jean-Baptiste Greuze, soit un homme agonisant, sur son lit, devant ses proches.
En 1979, Alain Delon écrit à François Truffaut : « La Chambre verte fait, en compagnie de Clément, Visconti, et quelques rares autres, partie de mon jardin secret. » Etonnante confession épistolaire de cet acteur bouleversé par le film le plus secret et le plus morbide de François Truffaut. Celui où les morts, devenus l’objet d’un culte, et donc exaltant l’imaginaire, apportent aux vivants un surcroît de vie. Ce culte des morts, partagé avec Truffaut, Alain Delon l’a manifesté très tôt, avec cette idée qu’en conservant leur souvenir il côtoie leur éternité.
Claudia Cardinale et Dominique Delouche ont été interviewés en juin 2018. Le livre de Dominique Delouche « Visconti, le prince travesti » (Hermann éditeurs, 2013) est l’un des plus justes consacrés au réalisateur italien. Les citations de Luchino Visconti sont extraites de « Luchino Visconti, cinéaste », d’Alain Sanzio (Persona, 1984), et de « Visconti, une vie exposée », de Laurence Schifano (Gallimard, 2009). Les propos d’Alain Delon sont issus, sauf mention contraire, de son entretien pour le bonus de l’édition DVD du « Guépard » par Pathé.
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Delon en six films-cultes (2/6). Le cinéaste italien voit dans l’acteur, qui le subjugue, un talent, dont il veut faire sa créature. Dans « Rocco et ses frères », puis en 1961 dans « Le Guépard », qui lui vaut une reconnaissance internationale.
Pendant le tournage de Plein soleil, où il assiste René Clément, Dominique Delouche contemple un jour Alain Delon avec un peu plus d’insistance. Cette fascination doit moins à la stupéfaction qu’à l’impression de reconnaître un visage familier. L’acteur l’interpelle : « Mais qu’est-ce qui te prend ? » Sans se démonter, Dominique Delouche lui répond : « On ne t’a jamais dit que tu avais un visage dessiné par Botticelli ? » Delon se met alors à rougir : « Si. » Dominique Delouche : « Visconti ? » Delon : « Oui. »
Le nom de Luchino Visconti explique en partie l’assurance du jeune homme de 23 ans sur le plateau romain de Plein soleil. Car le cinéaste italien, auteur de Senso (1954) puis de Nuits blanches (1957), lui a fait une promesse. Il s’est engagé à lui offrir le rôle principal de son nouveau film, Rocco et ses frères, dont le tournage doit débuter en février 1960, un mois avant la sortie française de Plein soleil. Après l’enseignement auprès de René Clément, Delon sait aussi que son apprentissage doit passer par un second maître. Peut-être le plus grand.
Pour son « Rocco », qu’il projette de tourner à Milan, Visconti veut raconter l’histoire d’une mère et de ses cinq fils, partis dans les années 1950 de l’extrême sud de la botte italienne, la région la plus misérable du pays, pour s’établir au nord, dans la prospère et industrielle Milan. Ces fils doivent tout à leur mère, imagine le metteur en scène, et cette dernière les voit à travers le prisme déformant du rêve : forts, grands, magnifiques, invincibles. Au sein de cette fratrie, Rocco Parondi apparaît comme le joyau, l’ange du bien, détenteur d’une force brute, et pourtant pacifique, qu’il manifeste sur un ring de boxe. Un personnage inspiré du Prince Mychkine de L’Idiot de Dostoïevski.
Mais Visconti se heurte à un écueil. Il ne trouve personne pour interpréter Rocco, ni en Italie ni en France. Sans cet acteur providentiel, il renoncera à son film. Alors il parle longuement de ce Rocco avec Olga Horstig, l’agent d’Alain Delon et de grandes stars françaises – Michèle Morgan, Edwige Feuillère, Brigitte Bardot. Olga Horstig présente Delon à Visconti le 9 mai 1959, à Londres, au Royal Opera House, lors de la première de Don Carlo, l’opéra de Verdi dont il est le metteur en scène. Visconti regarde le jeune homme quelques instants, puis se tourne vers son agent et lui glisse à l’oreille : « J’ai vu Rocco. » Delon possède, selon le mot de Visconti, cette « mélancolie de qui se sent forcé de se charger de haine quand il se bat, parce que, d’instinct, il la refuse ». Visconti décèle en Delon un talent brut qu’il va s’efforcer de polir, avec d’autant plus de force et de sévérité que l’acteur, encore docile, a vocation à l’accompagner longtemps dans sa carrière.
« On sait, écrit Dominique Delouche, que la notion d’éblouissement a jalonné la vie créative comme la vie intime de Visconti. Cette fois, il avait reconnu le héros qui remplissait alors son imaginaire, Rocco. Sous les yeux d’une jet-society intriguée et complice, Visconti intronisait son invité, l’ex-petit engagé d’Indochine, dans un royaume où il se savait souverain : l’Art, l’Opéra et le “grand monde”. Alain y serait son féal. »
« On ne t’a jamais dit que tu avais un visage dessiné par Botticelli ? » Delon se met alors à rougir : « Si. » Dominique Delouche : « Visconti ? » Delon : « oui »
Ce rapport de maître à sujet est frappant dans une des premières interviews télévisées de Delon. Alors qu’il prépare son rôle pour Rocco et ses frères, il est interrogé sur un ring de boxe par le journaliste François Chalais, qui lui demande : « Est-ce que vous pensez être un être fort ou un être faible ? » « Un peu des deux », répond Delon, timide, torse nu, la sueur encore dégoulinante. Il est à l’évidence surpris par l’absolu d’une telle question. Il reprend alors son souffle et lâche : « Des moments très fort et des moments aussi très faible. »
A l’époque, Delon réclame encore de la sévérité au démiurge Visconti. « J’ai besoin qu’on me tienne, explique l’acteur, se comparant à un pur-sang à dompter, il ne faut surtout pas me laisser aller. » Durant le tournage de Rocco, dans une scène où il sort d’un combat de boxe, Visconti lui intime l’ordre de pleurer. Delon utilise de l’ammoniaque, fourni par une maquilleuse. Après avoir découvert le subterfuge, Visconti lui hurle dessus. « On avait entendu sa colère dans tout Rome. Il pouvait faire exploser le Colisée sur un coup de colère », dira Delon.
« Une prétention à l’exclusivité »
L’apprentissage de l’acteur se poursuit en mars 1961, au Théâtre de Paris, où Visconti met en scène le couple Romy Schneider-Alain Delon dans Dommage qu’elle soit une putain, du dramaturge élisabéthain John Ford. L’Italien doit faire face à plusieurs écueils. A commencer par la réalité de ce jeune couple, qui s’est formé sur le plateau de Christine (1958), de Pierre Gaspard-Huit, et surnommé par la presse « les fiancés de l’Europe ». Un couple qui laisse Visconti s’approcher de lui et observer sa passion. Cette place, le réalisateur s’en accommode avec plus ou moins de bonne volonté. « Luchino, expliquait Romy Schneider, aimait Alain parce qu’il flairait en lui la matière brute du grand acteur. Il entendait donner forme à cette matière, et ce, de façon tyrannique, avec une prétention à l’exclusivité. »
Ni Delon ni Schneider ne sont jamais montés sur une scène de théâtre. Visconti insiste alors pour qu’ils soient associés dans le spectacle à des grands comédiens de l’époque, Daniel Sorano et Sylvia Monfort, ce qui crée chez les deux débutants un sentiment de panique. A chaque répétition, Schneider sent le regard de Visconti, inquisiteur, impitoyable, proférant humiliations et menaces. Delon demande à s’absenter un moment pour négocier le rôle de Shérif Ali ibn el Kharish dans Lawrence d’Arabie, le film que prépare David Lean (finalement joué par Omar Sharif), et Visconti parvient à contrecarrer son désir. Le réalisateur italien garde la mainmise sur le couple. Et sa façon d’en parler est assez claire : « Je les avais complètement “fabriqués” en dehors des autres. »
Un peu moins de deux ans après Rocco, en décembre 1961, Delon retrouve Visconti pour le tournage du Guépard, et c’est une tout autre histoire qui commence. Car il n’est plus le même acteur. Il est devenu une star dominante. Sa faiblesse, il la réserve désormais exclusivement aux personnages qu’il incarne. L’effet du temps qui passe devient visible chez Delon, sur au moins un détail : le front. Les rides, au nombre de trois, dès qu’il plisse son visage, signifient, davantage que sa métamorphose en homme, un temps qui se comprime, une intensité spéciale. Le perfectionnisme, l’exigence, l’obsession du détail, la violence colérique, la rigueur disciplinaire et le pouvoir démiurgique de Visconti se sont exercés avec une intensité qui rappelle combien l’effet Delon repose sur une discipline spartiate.
Le guépard, ce félin unique en son genre, symbole d’une noblesse en voie de disparition, désigne, tant dans l’unique roman de l’aristocrate italien Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en 1958, que dans l’adaptation de Luchino Visconti, Don Fabrizio Corbera, Prince de Salina. En 1860, après l’arrivée en Sicile des troupes de Garibaldi, ce dernier regarde, depuis son palais de Palerme, avec mélancolie et fatalisme, les bouleversements politiques menant à l’unification de l’Italie. Le Prince Salina, conscient de l’impossibilité d’arrêter le cours de l’Histoire, décide d’aider son neveu, Tancrède Falconeri, avec lequel il entretient une relation filiale, à rejoindre les combattants volontaires ayant suivi Garibaldi dans sa marche sur la capitale sicilienne.
Visconti intronisait son invité, l’ex-petit engagé d’Indochine, dans un royaume où il se savait souverain : l’art, l’opéra et le « grand monde ». Alain y serait son féal
Le Prince Salina est interprété par un acteur hollywoodien, Burt Lancaster. Tancrède, son neveu, prend chair avec l’interprétation complexe, magnétique, moderne, d’Alain Delon. « Tancrède, explique Visconti, n’est pas seulement un être vorace et cynique. Encore au début du processus de déformation et de corruption, on peut voir se refléter sur sa personne ces éclairs de civilisation, de noblesse et de virilité que l’immobilité féodale a cristallisés et précisément immobilisés sans espoir d’avenir chez le prince Fabrizio. »
Le Prince Salina qui voit, au soir de sa vie, mourir son univers, c’est bien entendu Visconti, 57 ans en 1963. C’est d’ailleurs ce qui rend Le Guépard extraordinairement vrai : Visconti pose sur ce monde, dont il est issu, un regard ordinaire. Tancrède Falconeri, qui passe des garibaldiens aux troupes de l’armée royale, c’est aussi Visconti, le Visconti de 30 ans qui a effectué le chemin inverse, de l’aristocratie vers le marxisme. Et le mariage entre Tancrède et Angelica, à laquelle Claudia Cardinale prête sa beauté, cette fille d’un propriétaire foncier que méprise Salina mais dont il a compris l’importance à cette période de bascule historique, évoque l’union de raison des parents de Visconti – son père, le duc de Modrone, avait épousé en 1900 Donna Carla Erba, riche héritière d’une fortune industrielle.
« L’humilier devant tout le monde »
Dans sa biographie du réalisateur italien, Visconti, Une vie exposée (Ed. Folio, 2009), Laurence Schifano décrit l’implication absolue du metteur en scène sur le plateau du Guépard : « Les quintaux de fleurs fraîches envoyées chaque jour par avion de San Remo, les vraies chandelles sur le lustre qu’il fallait remplacer toutes les heures, les cuisines installées à proximité de la salle de bal pour que les rôtis et les plats arrivent encore fumants, la lingerie disposée au rez-de-chaussée pour qu’on puisse nettoyer les gants blancs des hommes qui, au bout de quelques heures, se tachaient de sueur, les leçons de valse, de mazurka et de galop prodiguées par des maîtres à danser, les vaisselles d’or et d’argent prêtées par les plus anciennes familles de Palerme, la sélection minutieuse des figurants chargés d’apparaître dans les scènes de combats de rue, selon le type morphologique de chaque région. »
Cette obsession de la perfection et de la vérité de chaque accessoire transpire jusqu’aux comédiens, mis au service de la symphonie orchestrée par Visconti. Celui-ci choisit le tissu de la veste de Delon, la couleur de sa chemise, son bracelet, sa montre…
Nous avons demandé à Claudia Cardinale, 80 ans, rare et précieux témoin, d’évoquer à nouveau Le Guépard, et d’emblée, ce qu’elle retient, c’est l’exigence et l’intransigeance de Visconti. Par exemple l’ordre qu’il lui donne de ne pas se laver les cheveux, seul moyen de leur donner une lourdeur qui définit les coiffures romantiques. Elle se souvient aussi de la sévérité initiale que le cinéaste impose à Burt Lancaster afin de marquer son territoire devant cette star hollywoodienne. Et quand avec Delon elle visite les salles du palais, Visconti insiste pour qu’il n’y ait entre eux ni faux gestes, ni fausses caresses, ni faux baisers, insistant pour que les deux fiancés mettent la langue.
Entre complicité et hostilité
La relation entre Delon et Visconti ? Complexe, répond Claudia Cardinale. Entre complicité et hostilité. La complicité, c’est quand l’acteur sert d’instrument idéal, de porte-parole sur le plateau, afin de rendre plus fluide la dynamique de certaines séquences. « Il y a cette scène, explique Claudia Cardinale, où j’arrive dans le salon du palais, devant toute cette noblesse raffinée. Les regards convergent vers Angelica que j’incarne. Mon personnage n’est pas très bien habillé, la robe est un peu trop serrée, Angelica n’est pas de ce monde, mais il y a ce regard… Pendant la scène du dîner qui suit, Alain me raconte une histoire inconvenante de batifolage avec des nonnes, dont le spectateur est le témoin, ce qui provoque chez moi un rire un peu vulgaire, et toute la table, pétrifiée, me regarde. Mais pour obtenir ce rire – ce que l’on ne sait pas –, Alain m’avait susurré à l’oreille d’autres blagues, provoquant ce fameux rire que je n’arrivais plus à contrôler. »
Et puis il y a l’hostilité, l’humiliation même. Parce que Visconti sent que son acteur-relais lui échappe. Et là, Claudia Cardinale confie cette autre anecdote : « Visconti n’était pas satisfait de la façon dont Alain avait interprété la scène où nous courons à travers le grenier. Il en avait profité pour lui dire tout ce qu’il pensait, il voulait l’humilier devant tout le monde. » Face à un Visconti qui s’emporte, Cardinale et Delon se trouvent assis côte à côte sur un petit canapé. L’acteur lui prend la main et la serre pour se contenir, pour ne pas répondre. Il va presque la lui broyer.
Alain Delon et Luchino Visconti ne tourneront plus jamais ensemble. Le cinéaste sent-il durant le tournage du Guépard que son acteur ne sera plus jamais sa créature, qu’il est en train de lui échapper ? Car ce dernier a déjà la tête ailleurs : il pense au tournage imminent de Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil, où il va retrouver un autre partenaire à l’écran, Jean Gabin. Un autre mentor. Visconti vit mal cette « infidélité ». Ce metteur en scène amoureux des hommes et admirateur des femmes comprend que façonner l’acteur Delon ne lui permettra pas de changer l’homme Delon. Car si ce dernier défie les catégories, la préservation, presque maladive, de son intimité devient la condition de sa liberté.
Lors d’un entretien au Nouvel Observateur, en 1969, le journaliste Olivier Todd fait part à Delon des rumeurs d’homosexualité qui circulent à son sujet. L’acteur répond avec le brio de celui qui incarne mieux qu’un autre une époque qui entend briser les carcans : « Si j’avais eu envie d’avoir des aventures avec des hommes, de quoi serais-je coupable ? En amour, tout est permis. Vous connaissez la formule de Michel Simon : “Si j’ai envie de ma chèvre, je m’enverrai ma chèvre.” » Puis d’ajouter, en hommage direct à Visconti : « Je me souviens de cette phrase du personnage de Putana dans Dommage qu’elle soit une putain : “Si une jeune fille se sent en disposition, qu’elle prenne n’importe qui, père ou mère, c’est tout comme.” »
Une photo sur sa table de nuit
La figure de Delon plane pourtant sur le reste de l’œuvre de Visconti. L’acteur doit incarner le frère incestueux de Claudia Cardinale dans Sandra (1965) que jouera finalement Jean Sorel. Puis Meursault dans L’Etranger, de Camus, qu’adapte Visconti en 1967 avec Mastroianni. C’est une erreur de casting, que le maestro italien déplorera. Car Delon avait donné son accord pour un rôle qui lui colle à la peau. Cet homme qui, dans le roman de Camus, dit ce qu’il est, refuse de masquer ses sentiments, éprouve à l’égard du meurtre qu’il a commis plus d’ennui que de regret véritable, c’est Delon.
Mais le producteur, Dino de Laurentiis, refuse le cachet réclamé par l’acteur. Delon peut réciter, encore aujourd’hui, et de mémoire, des passages entiers du roman de Camus, sa chute par exemple : « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. »
La vedette de Rocco et ses frères doit encore jouer le narrateur d’A la recherche du temps perdu que Visconti cherchera, sans succès, à adapter. Et pour son ultime film, en 1976, Visconti offre à Delon le rôle du mari du couple sadomasochiste de L’Innocent, mais l’acteur préfère décliner, disant qu’il ne veut pas voir Visconti dans une chaise roulante. On dit que Visconti avait posé une photo d’Alain Delon sur sa table de nuit, à la manière d’une image impossible qui hante ses films ; une image, et un vide impossible à combler.
« Mon jardin secret »
Lorsque la version restaurée du Guépard est présentée au Festival de Cannes, en 2010, quarante-sept ans après avoir obtenu la Palme d’or, Alain Delon se retrouve à côté de Claudia Cardinale. A la fin de la projection, il chuchote à sa partenaire, qu’il appelle encore parfois Angelica : « Tu as vu ? Ils sont tous morts. » L’acteur a conservé quelques objets du Guépard, comme ceux de plusieurs autres films. Sa maison est le musée de cette mémoire. Il ne revoit presque jamais ses films. « Cela remue des souvenirs, explique-t-il, trop d’images, et puis tous ces acteurs que l’on revoit vivants, vivre, alors que je sais qu’ils ne sont plus là. »
La scène que Delon préfère dans Le Guépard est celle du bal, ce moment où transparaît chez Tancrède une admiration pour le Prince Salina en même temps qu’une pointe de nervosité alors qu’Angelica s’approche de ce dernier pour l’embrasser. Salina montre alors aux deux amants, dans son boudoir, son tableau de chevet : La Mort du juste, de Jean-Baptiste Greuze, soit un homme agonisant, sur son lit, devant ses proches.
En 1979, Alain Delon écrit à François Truffaut : « La Chambre verte fait, en compagnie de Clément, Visconti, et quelques rares autres, partie de mon jardin secret. » Etonnante confession épistolaire de cet acteur bouleversé par le film le plus secret et le plus morbide de François Truffaut. Celui où les morts, devenus l’objet d’un culte, et donc exaltant l’imaginaire, apportent aux vivants un surcroît de vie. Ce culte des morts, partagé avec Truffaut, Alain Delon l’a manifesté très tôt, avec cette idée qu’en conservant leur souvenir il côtoie leur éternité.
Claudia Cardinale et Dominique Delouche ont été interviewés en juin 2018. Le livre de Dominique Delouche « Visconti, le prince travesti » (Hermann éditeurs, 2013) est l’un des plus justes consacrés au réalisateur italien. Les citations de Luchino Visconti sont extraites de « Luchino Visconti, cinéaste », d’Alain Sanzio (Persona, 1984), et de « Visconti, une vie exposée », de Laurence Schifano (Gallimard, 2009). Les propos d’Alain Delon sont issus, sauf mention contraire, de son entretien pour le bonus de l’édition DVD du « Guépard » par Pathé.
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Delon, quelle carrière quand même. Le mec a eu une putain de vie, même s'il a bien payé le prix.
A titre personnel c'est l'un des plus grands aux cotés de Gabin, Simon, Depardieu, Belmondo.
Aujourd'hui son premier grand rôle : Plein Soleil
Alain Delon en six films cultes (1/6) Tourné en Italie, en 1959, le film de René Clément est le long métrage où l’acteur de 23 ans, peu connu jusqu’alors, devient une icône. Il irradie de beauté. La beauté du diable.
Avant d’entrer, le soir du 7 juillet 1959, dans l’appartement de René Clément, rue Henri-Martin à Paris, pour discuter de Plein soleil, le nouveau film du réalisateur de La Bataille du rail et de Jeux interdits, Alain Delon sait qu’il n’est encore rien.
Il a un visage, certes. Scruté par tous. Déjà admiré. Mais cet acteur de 23 ans se trouve encore en quête d’une postérité que ne sauraient lui offrir les cinq premiers films, « négligeables » selon lui, qu’il a tournés : Quand la femme s’en mêle (1957), d’Yves Allégret, Sois belle et tais-toi (1958), de Marc Allégret, Christine (1958), de Pierre Gaspard-Huit, Faibles femmes (1958) et Le Chemin des écoliers (1959), de Michel Boisrond.
Ce n’est presque rien, mais suffisant pour lui accoler l’étiquette de jeune premier, qui l’étouffe. Delon la trouve réductrice. Elle l’enferme dans une case qui ne correspond pas à l’acteur qu’il entend devenir. On met en avant son physique, comme s’il n’avait rien d’autre à proposer, n’avait aucun vécu.
Tellement plus à offrir
Lui sait aussi d’où il vient. D’une banlieue indécise, plutôt bourgeoise, à Sceaux, où il est né en 1935. Et d’une autre, plus populaire, à Fresnes, où son père et sa mère l’ont placé, plus tard, chez des parents nourriciers qui habitent un petit pavillon près de la prison. Il y a ensuite l’Indochine, engagé volontaire à 17 ans en 1953. Le très jeune homme tient à découvrir le monde, ce qui tombe très bien, car sa mère ne veut plus le voir.
Du territoire quelconque dont il s’est extrait, Delon ne peut qu’apprécier sa célébrité naissante. Même si celle-ci ne contient aucune promesse d’avenir : « Voir des gens qui chuchotent dans votre dos : “Voilà le nouveau James Dean…”, c’est quand même troublant, excitant, reconnaît-il, quand on vient de traîner son short en Indochine et qu’on a connu les cancrelats du cachot militaire. »
Il est convaincu qu’il a tellement plus à offrir… Du reste, ce visage, le regarde-t-on avec l’acuité nécessaire ? Comme s’il avait deviné que sa perfection le handicapait, Delon s’en remet au hasard, ou plutôt aux circonstances, pour altérer son visage, lui ajouter ce petit défaut qui va le rendre unique, et non plus seulement beau.
Une cicatrice sous le menton
A la manière de Brando en son temps, dont le nez s’est trouvé cassé lors d’un entraînement de boxe, en marge des répétitions, à Broadway, de la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé désir, Delon arbore, après un accident de voiture survenu durant le tournage de Sois belle et tais-toi, une cicatrice sous le menton. « Prête-moi ta voiture », exige Delon au dialoguiste du film, Pascal Jardin. « Je n’ai pas le droit », répond ce dernier. Delon surenchérit, avec cette autorité qu’on ne lui soupçonne pas encore : « On s’en fout. » La quatre-chevaux effectue cinq tonneaux sous le tunnel du pont de Saint-Cloud.
Davantage que le véhicule parti en fumée, c’est le regard de Delon qui frappe Pascal Jardin : « Il me regarde, écrit ce dernier dans Guerre après guerre (Grasset & Fasquelle, 1973), de ses yeux métalliques aux reflets d’alliage suédois, qui me font penser au Musée de l’Inquisition de Ratisbonne, et aussi au supplicié des catacombes de Palerme, dont on vida le corps de son sang pour le remplacer par du mercure. C’est un regard doux et meurtrier. »
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Marie Laforêt et Alain Delon.
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Marie Laforêt et Alain Delon. PARI FILMS / PROD DB
Pour peu qu’on y prête attention, cette cicatrice, une fois repérée, envahit le cadre, vampirise la figure de l’acteur, obsède le spectateur. Elle devient cette marque étrange, raturant un visage par ailleurs parfait. Le signe d’un pedigree hors du commun. La différence qui, déjà, différencie Delon des autres acteurs.
Au moment de pousser la porte de l’appartement de René Clément, Delon est conscient de son pouvoir : ce regard doux et meurtrier, comme l’a écrit Pascal Jardin, dont l’acteur est fermement décidé à exploiter les possibles à l’écran. La lecture du scénario – une adaptation du roman policier Monsieur Ripley (1955), de l’Américaine Patricia Highsmith – l’a convaincu qu’il n’est pas fait pour le rôle qu’on lui destine.
Le personnage de Philippe Greenleaf, un bourgeois insouciant, qui profite de la dolce vita romaine et dilapide sa fortune de famille, ce n’est pas Delon. Alors, quand il pousse la porte, ce n’est pas seulement pour refuser ce rôle. C’est pour en négocier un autre. Le rôle principal du film en l’occurrence, celui de Tom Ripley, un ami d’enfance de Philippe Greenleaf, envoyé en Italie par le père de ce dernier pour le convaincre de retourner à San Francisco et qui, plutôt que d’exécuter sa mission, décide d’exécuter son compagnon et d’endosser son identité. Un personnage taillé sur mesure pour l’éphèbe discrètement balafré, pour l’acteur conscient de sa beauté du diable. Ce sera donc Ripley ou rien.
Un rôle destiné à Jacques Charrier
Ce soir du 7 juillet, les hôtes de René Clément sont disposés dans la salle de séjour à la manière de pions sur un échiquier. Cette mise en scène vise à intimider Delon, à le jauger, le juger, le placer dans un étau pour emporter sa décision. Il est assis à une table sur laquelle est posé le scénario de Plein soleil.
René Clément, 46 ans et deux Oscars à Hollywood, s’assoit à sa droite. C’est un homme à la crinière d’argent et à l’allure martiale, d’une élégance froide, et, comme toujours, tiré à quatre épingles. Beau, certes, mais dépourvu de la moindre séduction. En face, Robert et Raymond Hakim, les producteurs du film. Tout au fond de la pièce, loin des protagonistes, l’épouse et éminence grise du réalisateur, Bella Clément. Elle est sensiblement plus âgée que son époux, avec un physique beaucoup plus ingrat. Federico Fellini s’amusait de constater combien sa laideur contredisait son prénom.
A ce moment, le rôle de Ripley est destiné à Jacques Charrier. Ce beau jeune homme de 23 ans a plusieurs cartes en main. Il vient de s’imposer dans le film Les Tricheurs, de Marcel Carné, et dans Les Dragueurs, de Jean-Pierre Mocky. Son mariage avec Brigitte Bardot lui apporte une aura supplémentaire. Du reste, Robert Hakim lance immédiatement à Delon, pour couper court à tout débat, si tant est qu’il puisse y en avoir un : « Nous sommes heureux de vous confirmer que nous vous proposons le rôle de Philippe. » L’acteur jette un froid en répondant : « Je suis désolé, mais je n’en veux pas. » Il argumente pied à pied, explique combien ce choix est une erreur. Il ne peut incarner un fils de milliardaire, un enfant gâté, un héritier indolent pour lequel la vie est une fête.
« Rrrené chérri, le petit a rrraison »
Delon ne s’arrête pas là. Le voyou Ripley, argumente-t-il, c’est lui. Les frères Hakim se mettent à hurler : « Comment ! Vous osez ! Vous n’êtes qu’un petit con ! Vous devriez payer pour le faire ! » Delon reste inflexible : « Je n’en ai rien à foutre ! Je ne veux pas le faire et je ne le ferai pas ! »
Vers deux heures du matin, dans une ambiance lourde, et alors que les protagonistes sont épuisés, s’installe un long silence. Soudain rompu par Bella Clément. Son accent russe étire certaines consonnes, les « r » en particulier, avec une maladresse qui rend pittoresque son autorité sans pour autant l’éroder : « Rrrené chérri, le petit a rrraison. » Au fond de la pièce, elle semblait hors jeu. Il faut se méfier des images. Son influence auprès de son mari est certaine. Mieux que ça, son avis a souvent valeur d’ordre. Jusqu’à 4 heures du matin, elle explique à son « Rrrené chérri » pourquoi le petit a raison. Au bout de la plus longue nuit de son existence, Delon vient de signer son acte de naissance.
Delon deviendra ce jeune homme capable de sacrifier la vie d’un autre pour vivre quelques minutes de rêve éveillé, jamais aussi innocent qu’au moment où il commet son crime.
Les frères Allégret avaient expliqué à Delon à ses débuts : « Reste toi-même. Ne force pas. Marche, respire, souris comme tu l’entends. Tu es bien comme ça. » Sa spontanéité est l’atout de choix de l’acteur. Pourtant, plus que son naturel, ce sont les virtualités troublantes de Delon qui frappent le réalisateur de Plein soleil et le poussent à accepter ses exigences.
Il pressent tout un monde en lui, qu’il va se charger de faire émerger. Car tout ce monde colle à la complexité du personnage de Plein soleil, qui est aussi une façon de poser les termes de l’équation Delon, confie René Clément : « Le personnage de Plein soleil n’est pas facile à interpréter. L’innocence criminelle existe-t-elle ? Delon doit, dans le crime, préserver cette pureté qui ne se juge pas, parce qu’elle relève d’une psychologie qui nous échappe en échappant à la norme de l’humanité. » Delon deviendra ce jeune homme capable de sacrifier la vie d’un autre pour vivre quelques minutes de rêve éveillé, jamais aussi innocent qu’au moment où il commet son crime.
Le tournage de Plein soleil débute le 3 août 1959 en Italie, dans la province de Naples, à Ischia et à Rome. Delon a donc 23 ans. Ses partenaires sont Marie Laforêt, qui en a 19, dont c’est le premier rôle au cinéma et qui n’est pas encore la chanteuse qu’elle deviendra. A 32 ans, Maurice Ronet hérite du rôle de Philippe Greenleaf. Il faut cette jeunesse pour incarner l’oisiveté, l’insouciance et la liberté d’une époque. Au même moment, Fellini met en scène, lui aussi à Rome, avec La Dolce Vita, le même bonheur innocent que René Clément capte presque à son insu.
Les yeux bleus de Delon et les yeux verts de Marie Laforêt
A son insu parce que, en 1959, le réalisateur français passe pour un homme et un cinéaste d’une autre époque. Il est devenu l’un des emblèmes d’une « qualité française » au cinéma, brocardée par François Truffaut dans son fameux – et désormais très daté – article, paru en 1954 dans Les Cahiers du Cinéma, « Une certaine tendance du cinéma français ».
Et si la tendance est certaine, elle n’est pas à l’avantage de René Clément. Surtout durant l’année 1959. Le même été, Jean-Luc Godard tourne à Paris son premier film, A bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, film étendard de la Nouvelle Vague. Les Quatre Cents Coups, de François Truffaut, vient de sortir en salles après avoir bouleversé le Festival de Cannes, tout comme Les Cousins, de Claude Chabrol, qui a triomphé au Festival de Berlin. Autant dire que c’est avec un esprit de compétition que René Clément affronte ce mouvement, en se nourrissant de l’air du temps, pour réaliser le film d’une époque.
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Maurice Ronet et Alain Delon
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Maurice Ronet et Alain Delon PARITALIA-TITANUS / PROD DB
Film impur et métissé, Plein soleil se situe au carrefour de deux esthétiques qui lui donnent sa force et définissent sa singularité. Un film entre deux chaises, en quelque sorte. D’un côté, il y a la Nouvelle Vague : René Clément coécrit son film avec Paul Gégauff, le scénariste des Cousins, de Chabrol, et il fait appel au chef opérateur Henri Decaë, qui vient d’assurer la photographie des Quatre Cents Coups. Mais il y a aussi, dans Plein soleil, l’esthétique du Swinging London naissant, sa culture pop et insouciante.
Le film est en couleurs – des couleurs lumineuses même, qui révèlent les yeux bleus de Delon et les yeux verts de Marie Laforêt –, à la différence des premiers opus de Truffaut, de Godard et de Chabrol. Et puis, c’est Maurice Binder qui conçoit le générique pop du film, deux ans avant de se voir confier celui de James Bond contre Dr No. Enfin, comme Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, Godard avec Belmondo, Chabrol avec Brialy, René Clément se découvre avec Alain Delon un alter ego à l’écran. Un choix si marqué que l’acteur deviendra ensuite la star de ce qu’il désigne avec affection le « cinéma de papa » : René Clément, Julien Duvivier, Henri Verneuil, Jean Gabin. Des choix antithétiques avec ceux de la Nouvelle Vague.
Un tournage très difficile
Sur le plateau de Plein soleil, dans un tournage rendu très difficile en raison des nombreuses scènes en bateau – la mer, par sa versatilité, a toujours été une ennemie des cinéastes –, Delon bénéficie des égards dévolus à un jeune prince.
« Le seul domaine où Clément n’était pas tendu, se souvient Dominique Delouche qui était l’assistant du réalisateur sur Plein soleil, c’était sa direction d’acteurs. Il était subjugué par Alain Delon, un effet amplifié par la séduction exercée par ce dernier sur Bella Clément. Il était devenu l’enfant adopté. Delon incarne le jeune homme qu’aurait souhaité être Clément. Cela me faisait penser au rapport de Stendhal à ses jeunes héros, détenteurs d’une séduction que leur auteur n’avait pas possédée. Clément a mis cela chez Delon. »
La relation de maître à élève s’impose avec évidence. Delon sait ce qu’il lui manque : un apprentissage sérieux du métier et ce temps de réflexion qui permet de se mesurer avec ce que l’on attend de vous. Clément manifeste une conscience aiguë de ce qu’il peut apporter à ce diamant brut. « C’était très touchant, ajoute Dominique Delouche, de voir comment Delon acceptait de devenir le disciple, avec une telle humilité. Clément lui expliquait les choses le matin, en silence. Delon était émerveillé par la manière dont le metteur en scène lui expliquait son rôle. Souvent, au cinéma, on évite d’en dire trop au comédien, il faut laisser à l’acteur l’idée qu’il se fait du rôle, sinon tout se défait. Or, ici, tout se fait. »
La place privilégiée de Delon, son statut d’enfant prodige, place mécaniquement en porte-à-faux son partenaire Maurice Ronet. Cette mise à l’écart ne va pas de soi. Ne serait-ce que parce que l’acteur, qui formait, deux ans plus tôt, avec Jeanne Moreau le couple maudit d’Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle, remplit alors l’écran, par son charme et son détachement, comme aucun autre acteur français. C’était avant Delon. Ronet est tué par son partenaire dans Plein soleil. Mais il apparaît surtout comme un roi expulsé par le prétendant – plus jeune, plus beau, plus insolent. Un coup d’Etat effectué en douceur, sans que l’amitié entre les deux hommes s’en ressente – ils tourneront encore trois fois ensemble, dans Les Centurions (1966), La Piscine (1969) et Mort d’un pourri (1977).
La rage de l’affranchi
Maurice Ronet est fils de comédiens, issu du sérail donc, connu pour le détachement avec lequel il envisage sa carrière. Delon vient de nulle part, ancien commis charcutier, ancien soldat, il se trouve sommé de façonner son destin, quand son partenaire peut s’offrir le luxe de s’en remettre au cours des choses – c’est aussi le profil des deux personnages de Plein soleil. Lors du tournage, Delon évite de sortir le soir. Concentré, discipliné, il gère ses efforts, quand le dandy Ronet profite à plein des douceurs des nuits romaines et napolitaines.
En 1960, Alain Delon interprète Tom Ripley dans « Plein soleil », de René Clément.
En 1960, Alain Delon interprète Tom Ripley dans « Plein soleil », de René Clément. PARIS FILM-PARITALIA-TITANUS / PROD DB
Cette dynamique joue de façon intense dans Plein soleil. Jeune homme emprunté et de modeste extraction, humilié par ce fils de milliardaire arrogant, Tom Ripley ne se contente pas de l’assassiner, puis d’endosser son identité et de lui voler sa petite amie. Il l’efface des mémoires et des consciences. « On ne tient pas son couteau comme ça », explique dans le film un Ronet condescendant à un Delon humilié. Quand ce dernier lui enfonce plus tard son poignard, c’est avec la rage de l’affranchi.
Le sort réservé à Marie Laforêt, dans le rôle de Marge, la petite amie de Philippe Greenleaf qui succombe à la tentation de Tom Ripley, est beaucoup moins enviable. Le fonctionnement de cour installé par René Clément sur son plateau l’explique en partie. Il y a la table du commandant, avec le réalisateur, son épouse, Delon et Ronet. Tout au bout, donc éloignée et à l’abri des regards, il y a Marie Laforêt. Delon et Ronet l’appellent « la pucelle ». « Ils l’ont prise pour une starlette, se souvient Dominique Delouche. C’était au premier qui allait se l’envoyer. Elle, issue de la grande bourgeoisie du 16e arrondissement, élevée dans un institut catholique, les a tout de suite jetés. » Ce que l’actrice confirmera plus tard, sans diplomatie : « Alain Delon me prenait pour une conne, le fait que je joue une poufiasse n’arrangeait rien à l’affaire. »
Une star ambiguë et délicieusement complexe
René Clément est un cinéaste exigeant, un technicien avec le sens de la hiérarchie, qui envisage un tournage à la manière d’une suite de problèmes à résoudre et dont il a la clé. Pourtant, le défi le plus imposant posé par le film, une fois le couteau de Ripley planté dans le cœur de Philippe Greenleaf, au milieu d’une partie de cartes sur son bateau, provoquant une tempête, un affolement des éléments, comme si la nature réagissait de manière pulsionnelle au tabou du meurtre, ne doit rien à un quelconque raisonnement mathématique.
« La mer s’est fortement creusée, racontait René Clément, le vent a fraîchi d’un coup. On a filmé en une matinée ce qui nous aurait normalement demandé une semaine de travail. Decaë était à cheval sur l’étrave de la chaloupe, qui faisait des bonds de plus de deux mètres sur les vagues, essayant de fixer ce bateau qui arrivait droit sur nous, et nous nous demandions si Alain saurait éviter la dérive. » Lorsque le beaupré frappe Delon sur la tête, il manque de mourir. S’il avait reçu ce coup sur la tempe… C’est comme si ce déchaînement des éléments, inespéré pour Clément, presque fatal à Delon, devait tout à la force de conviction de l’acteur.
Plein soleil sort en salles le 10 mars 1960 et obtient, avec 2 400 000 entrées, le succès escompté. Delon assied son statut de star. Une star ambiguë et délicieusement complexe. La scène la plus sexuellement incarnée de Plein soleil montre Delon au moment où il envisage de prendre l’identité de Maurice Ronet.
Il revêt le blazer à rayures, la chemise blanche, les mocassins du même ton et le pantalon moulant de son ami. A ce moment précis, Delon ouvre un abîme. Il se pince les lèvres, se mire en narcisse maléfique, susurre des mots salaces en face de cette glace panoramique. Ronet apparaît alors, cravache à la main, le visage à la fois défait et interrogateur devant le théâtre de son compagnon auquel il intime l’ordre de retirer ses habits. Delon répond par cet air en partie insolent, en partie soumis. Un regard de sphinx. Ce garçon lumineux aux idées noires, impossible de le lâcher des yeux. Luchino Visconti, qui l’attend pour le tournage de Rocco et ses frères, l’a tout de suite compris. Delon, lui, n’a pas fini de hanter son époque.
Dominique Delouche a été interviewé en juin 2018. Les citations d’Alain Delon proviennent de « Alain Delon », d’Henri Rode (éditions Pac, 1982). Celles de René Clément du même livre d’Henri Rode, et du numéro de « L’Avant-Scène », du 1er février 1981, consacré à « Plein soleil ».
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Aujourd'hui son premier grand rôle : Plein Soleil
Alain Delon en six films cultes (1/6) Tourné en Italie, en 1959, le film de René Clément est le long métrage où l’acteur de 23 ans, peu connu jusqu’alors, devient une icône. Il irradie de beauté. La beauté du diable.
Avant d’entrer, le soir du 7 juillet 1959, dans l’appartement de René Clément, rue Henri-Martin à Paris, pour discuter de Plein soleil, le nouveau film du réalisateur de La Bataille du rail et de Jeux interdits, Alain Delon sait qu’il n’est encore rien.
Il a un visage, certes. Scruté par tous. Déjà admiré. Mais cet acteur de 23 ans se trouve encore en quête d’une postérité que ne sauraient lui offrir les cinq premiers films, « négligeables » selon lui, qu’il a tournés : Quand la femme s’en mêle (1957), d’Yves Allégret, Sois belle et tais-toi (1958), de Marc Allégret, Christine (1958), de Pierre Gaspard-Huit, Faibles femmes (1958) et Le Chemin des écoliers (1959), de Michel Boisrond.
Ce n’est presque rien, mais suffisant pour lui accoler l’étiquette de jeune premier, qui l’étouffe. Delon la trouve réductrice. Elle l’enferme dans une case qui ne correspond pas à l’acteur qu’il entend devenir. On met en avant son physique, comme s’il n’avait rien d’autre à proposer, n’avait aucun vécu.
Tellement plus à offrir
Lui sait aussi d’où il vient. D’une banlieue indécise, plutôt bourgeoise, à Sceaux, où il est né en 1935. Et d’une autre, plus populaire, à Fresnes, où son père et sa mère l’ont placé, plus tard, chez des parents nourriciers qui habitent un petit pavillon près de la prison. Il y a ensuite l’Indochine, engagé volontaire à 17 ans en 1953. Le très jeune homme tient à découvrir le monde, ce qui tombe très bien, car sa mère ne veut plus le voir.
Du territoire quelconque dont il s’est extrait, Delon ne peut qu’apprécier sa célébrité naissante. Même si celle-ci ne contient aucune promesse d’avenir : « Voir des gens qui chuchotent dans votre dos : “Voilà le nouveau James Dean…”, c’est quand même troublant, excitant, reconnaît-il, quand on vient de traîner son short en Indochine et qu’on a connu les cancrelats du cachot militaire. »
Il est convaincu qu’il a tellement plus à offrir… Du reste, ce visage, le regarde-t-on avec l’acuité nécessaire ? Comme s’il avait deviné que sa perfection le handicapait, Delon s’en remet au hasard, ou plutôt aux circonstances, pour altérer son visage, lui ajouter ce petit défaut qui va le rendre unique, et non plus seulement beau.
Une cicatrice sous le menton
A la manière de Brando en son temps, dont le nez s’est trouvé cassé lors d’un entraînement de boxe, en marge des répétitions, à Broadway, de la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé désir, Delon arbore, après un accident de voiture survenu durant le tournage de Sois belle et tais-toi, une cicatrice sous le menton. « Prête-moi ta voiture », exige Delon au dialoguiste du film, Pascal Jardin. « Je n’ai pas le droit », répond ce dernier. Delon surenchérit, avec cette autorité qu’on ne lui soupçonne pas encore : « On s’en fout. » La quatre-chevaux effectue cinq tonneaux sous le tunnel du pont de Saint-Cloud.
Davantage que le véhicule parti en fumée, c’est le regard de Delon qui frappe Pascal Jardin : « Il me regarde, écrit ce dernier dans Guerre après guerre (Grasset & Fasquelle, 1973), de ses yeux métalliques aux reflets d’alliage suédois, qui me font penser au Musée de l’Inquisition de Ratisbonne, et aussi au supplicié des catacombes de Palerme, dont on vida le corps de son sang pour le remplacer par du mercure. C’est un regard doux et meurtrier. »
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Marie Laforêt et Alain Delon.
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Marie Laforêt et Alain Delon. PARI FILMS / PROD DB
Pour peu qu’on y prête attention, cette cicatrice, une fois repérée, envahit le cadre, vampirise la figure de l’acteur, obsède le spectateur. Elle devient cette marque étrange, raturant un visage par ailleurs parfait. Le signe d’un pedigree hors du commun. La différence qui, déjà, différencie Delon des autres acteurs.
Au moment de pousser la porte de l’appartement de René Clément, Delon est conscient de son pouvoir : ce regard doux et meurtrier, comme l’a écrit Pascal Jardin, dont l’acteur est fermement décidé à exploiter les possibles à l’écran. La lecture du scénario – une adaptation du roman policier Monsieur Ripley (1955), de l’Américaine Patricia Highsmith – l’a convaincu qu’il n’est pas fait pour le rôle qu’on lui destine.
Le personnage de Philippe Greenleaf, un bourgeois insouciant, qui profite de la dolce vita romaine et dilapide sa fortune de famille, ce n’est pas Delon. Alors, quand il pousse la porte, ce n’est pas seulement pour refuser ce rôle. C’est pour en négocier un autre. Le rôle principal du film en l’occurrence, celui de Tom Ripley, un ami d’enfance de Philippe Greenleaf, envoyé en Italie par le père de ce dernier pour le convaincre de retourner à San Francisco et qui, plutôt que d’exécuter sa mission, décide d’exécuter son compagnon et d’endosser son identité. Un personnage taillé sur mesure pour l’éphèbe discrètement balafré, pour l’acteur conscient de sa beauté du diable. Ce sera donc Ripley ou rien.
Un rôle destiné à Jacques Charrier
Ce soir du 7 juillet, les hôtes de René Clément sont disposés dans la salle de séjour à la manière de pions sur un échiquier. Cette mise en scène vise à intimider Delon, à le jauger, le juger, le placer dans un étau pour emporter sa décision. Il est assis à une table sur laquelle est posé le scénario de Plein soleil.
René Clément, 46 ans et deux Oscars à Hollywood, s’assoit à sa droite. C’est un homme à la crinière d’argent et à l’allure martiale, d’une élégance froide, et, comme toujours, tiré à quatre épingles. Beau, certes, mais dépourvu de la moindre séduction. En face, Robert et Raymond Hakim, les producteurs du film. Tout au fond de la pièce, loin des protagonistes, l’épouse et éminence grise du réalisateur, Bella Clément. Elle est sensiblement plus âgée que son époux, avec un physique beaucoup plus ingrat. Federico Fellini s’amusait de constater combien sa laideur contredisait son prénom.
A ce moment, le rôle de Ripley est destiné à Jacques Charrier. Ce beau jeune homme de 23 ans a plusieurs cartes en main. Il vient de s’imposer dans le film Les Tricheurs, de Marcel Carné, et dans Les Dragueurs, de Jean-Pierre Mocky. Son mariage avec Brigitte Bardot lui apporte une aura supplémentaire. Du reste, Robert Hakim lance immédiatement à Delon, pour couper court à tout débat, si tant est qu’il puisse y en avoir un : « Nous sommes heureux de vous confirmer que nous vous proposons le rôle de Philippe. » L’acteur jette un froid en répondant : « Je suis désolé, mais je n’en veux pas. » Il argumente pied à pied, explique combien ce choix est une erreur. Il ne peut incarner un fils de milliardaire, un enfant gâté, un héritier indolent pour lequel la vie est une fête.
« Rrrené chérri, le petit a rrraison »
Delon ne s’arrête pas là. Le voyou Ripley, argumente-t-il, c’est lui. Les frères Hakim se mettent à hurler : « Comment ! Vous osez ! Vous n’êtes qu’un petit con ! Vous devriez payer pour le faire ! » Delon reste inflexible : « Je n’en ai rien à foutre ! Je ne veux pas le faire et je ne le ferai pas ! »
Vers deux heures du matin, dans une ambiance lourde, et alors que les protagonistes sont épuisés, s’installe un long silence. Soudain rompu par Bella Clément. Son accent russe étire certaines consonnes, les « r » en particulier, avec une maladresse qui rend pittoresque son autorité sans pour autant l’éroder : « Rrrené chérri, le petit a rrraison. » Au fond de la pièce, elle semblait hors jeu. Il faut se méfier des images. Son influence auprès de son mari est certaine. Mieux que ça, son avis a souvent valeur d’ordre. Jusqu’à 4 heures du matin, elle explique à son « Rrrené chérri » pourquoi le petit a raison. Au bout de la plus longue nuit de son existence, Delon vient de signer son acte de naissance.
Delon deviendra ce jeune homme capable de sacrifier la vie d’un autre pour vivre quelques minutes de rêve éveillé, jamais aussi innocent qu’au moment où il commet son crime.
Les frères Allégret avaient expliqué à Delon à ses débuts : « Reste toi-même. Ne force pas. Marche, respire, souris comme tu l’entends. Tu es bien comme ça. » Sa spontanéité est l’atout de choix de l’acteur. Pourtant, plus que son naturel, ce sont les virtualités troublantes de Delon qui frappent le réalisateur de Plein soleil et le poussent à accepter ses exigences.
Il pressent tout un monde en lui, qu’il va se charger de faire émerger. Car tout ce monde colle à la complexité du personnage de Plein soleil, qui est aussi une façon de poser les termes de l’équation Delon, confie René Clément : « Le personnage de Plein soleil n’est pas facile à interpréter. L’innocence criminelle existe-t-elle ? Delon doit, dans le crime, préserver cette pureté qui ne se juge pas, parce qu’elle relève d’une psychologie qui nous échappe en échappant à la norme de l’humanité. » Delon deviendra ce jeune homme capable de sacrifier la vie d’un autre pour vivre quelques minutes de rêve éveillé, jamais aussi innocent qu’au moment où il commet son crime.
Le tournage de Plein soleil débute le 3 août 1959 en Italie, dans la province de Naples, à Ischia et à Rome. Delon a donc 23 ans. Ses partenaires sont Marie Laforêt, qui en a 19, dont c’est le premier rôle au cinéma et qui n’est pas encore la chanteuse qu’elle deviendra. A 32 ans, Maurice Ronet hérite du rôle de Philippe Greenleaf. Il faut cette jeunesse pour incarner l’oisiveté, l’insouciance et la liberté d’une époque. Au même moment, Fellini met en scène, lui aussi à Rome, avec La Dolce Vita, le même bonheur innocent que René Clément capte presque à son insu.
Les yeux bleus de Delon et les yeux verts de Marie Laforêt
A son insu parce que, en 1959, le réalisateur français passe pour un homme et un cinéaste d’une autre époque. Il est devenu l’un des emblèmes d’une « qualité française » au cinéma, brocardée par François Truffaut dans son fameux – et désormais très daté – article, paru en 1954 dans Les Cahiers du Cinéma, « Une certaine tendance du cinéma français ».
Et si la tendance est certaine, elle n’est pas à l’avantage de René Clément. Surtout durant l’année 1959. Le même été, Jean-Luc Godard tourne à Paris son premier film, A bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, film étendard de la Nouvelle Vague. Les Quatre Cents Coups, de François Truffaut, vient de sortir en salles après avoir bouleversé le Festival de Cannes, tout comme Les Cousins, de Claude Chabrol, qui a triomphé au Festival de Berlin. Autant dire que c’est avec un esprit de compétition que René Clément affronte ce mouvement, en se nourrissant de l’air du temps, pour réaliser le film d’une époque.
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Maurice Ronet et Alain Delon
« Plein Soleil », de René Clément en 1960. Avec Maurice Ronet et Alain Delon PARITALIA-TITANUS / PROD DB
Film impur et métissé, Plein soleil se situe au carrefour de deux esthétiques qui lui donnent sa force et définissent sa singularité. Un film entre deux chaises, en quelque sorte. D’un côté, il y a la Nouvelle Vague : René Clément coécrit son film avec Paul Gégauff, le scénariste des Cousins, de Chabrol, et il fait appel au chef opérateur Henri Decaë, qui vient d’assurer la photographie des Quatre Cents Coups. Mais il y a aussi, dans Plein soleil, l’esthétique du Swinging London naissant, sa culture pop et insouciante.
Le film est en couleurs – des couleurs lumineuses même, qui révèlent les yeux bleus de Delon et les yeux verts de Marie Laforêt –, à la différence des premiers opus de Truffaut, de Godard et de Chabrol. Et puis, c’est Maurice Binder qui conçoit le générique pop du film, deux ans avant de se voir confier celui de James Bond contre Dr No. Enfin, comme Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, Godard avec Belmondo, Chabrol avec Brialy, René Clément se découvre avec Alain Delon un alter ego à l’écran. Un choix si marqué que l’acteur deviendra ensuite la star de ce qu’il désigne avec affection le « cinéma de papa » : René Clément, Julien Duvivier, Henri Verneuil, Jean Gabin. Des choix antithétiques avec ceux de la Nouvelle Vague.
Un tournage très difficile
Sur le plateau de Plein soleil, dans un tournage rendu très difficile en raison des nombreuses scènes en bateau – la mer, par sa versatilité, a toujours été une ennemie des cinéastes –, Delon bénéficie des égards dévolus à un jeune prince.
« Le seul domaine où Clément n’était pas tendu, se souvient Dominique Delouche qui était l’assistant du réalisateur sur Plein soleil, c’était sa direction d’acteurs. Il était subjugué par Alain Delon, un effet amplifié par la séduction exercée par ce dernier sur Bella Clément. Il était devenu l’enfant adopté. Delon incarne le jeune homme qu’aurait souhaité être Clément. Cela me faisait penser au rapport de Stendhal à ses jeunes héros, détenteurs d’une séduction que leur auteur n’avait pas possédée. Clément a mis cela chez Delon. »
La relation de maître à élève s’impose avec évidence. Delon sait ce qu’il lui manque : un apprentissage sérieux du métier et ce temps de réflexion qui permet de se mesurer avec ce que l’on attend de vous. Clément manifeste une conscience aiguë de ce qu’il peut apporter à ce diamant brut. « C’était très touchant, ajoute Dominique Delouche, de voir comment Delon acceptait de devenir le disciple, avec une telle humilité. Clément lui expliquait les choses le matin, en silence. Delon était émerveillé par la manière dont le metteur en scène lui expliquait son rôle. Souvent, au cinéma, on évite d’en dire trop au comédien, il faut laisser à l’acteur l’idée qu’il se fait du rôle, sinon tout se défait. Or, ici, tout se fait. »
La place privilégiée de Delon, son statut d’enfant prodige, place mécaniquement en porte-à-faux son partenaire Maurice Ronet. Cette mise à l’écart ne va pas de soi. Ne serait-ce que parce que l’acteur, qui formait, deux ans plus tôt, avec Jeanne Moreau le couple maudit d’Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle, remplit alors l’écran, par son charme et son détachement, comme aucun autre acteur français. C’était avant Delon. Ronet est tué par son partenaire dans Plein soleil. Mais il apparaît surtout comme un roi expulsé par le prétendant – plus jeune, plus beau, plus insolent. Un coup d’Etat effectué en douceur, sans que l’amitié entre les deux hommes s’en ressente – ils tourneront encore trois fois ensemble, dans Les Centurions (1966), La Piscine (1969) et Mort d’un pourri (1977).
La rage de l’affranchi
Maurice Ronet est fils de comédiens, issu du sérail donc, connu pour le détachement avec lequel il envisage sa carrière. Delon vient de nulle part, ancien commis charcutier, ancien soldat, il se trouve sommé de façonner son destin, quand son partenaire peut s’offrir le luxe de s’en remettre au cours des choses – c’est aussi le profil des deux personnages de Plein soleil. Lors du tournage, Delon évite de sortir le soir. Concentré, discipliné, il gère ses efforts, quand le dandy Ronet profite à plein des douceurs des nuits romaines et napolitaines.
En 1960, Alain Delon interprète Tom Ripley dans « Plein soleil », de René Clément.
En 1960, Alain Delon interprète Tom Ripley dans « Plein soleil », de René Clément. PARIS FILM-PARITALIA-TITANUS / PROD DB
Cette dynamique joue de façon intense dans Plein soleil. Jeune homme emprunté et de modeste extraction, humilié par ce fils de milliardaire arrogant, Tom Ripley ne se contente pas de l’assassiner, puis d’endosser son identité et de lui voler sa petite amie. Il l’efface des mémoires et des consciences. « On ne tient pas son couteau comme ça », explique dans le film un Ronet condescendant à un Delon humilié. Quand ce dernier lui enfonce plus tard son poignard, c’est avec la rage de l’affranchi.
Le sort réservé à Marie Laforêt, dans le rôle de Marge, la petite amie de Philippe Greenleaf qui succombe à la tentation de Tom Ripley, est beaucoup moins enviable. Le fonctionnement de cour installé par René Clément sur son plateau l’explique en partie. Il y a la table du commandant, avec le réalisateur, son épouse, Delon et Ronet. Tout au bout, donc éloignée et à l’abri des regards, il y a Marie Laforêt. Delon et Ronet l’appellent « la pucelle ». « Ils l’ont prise pour une starlette, se souvient Dominique Delouche. C’était au premier qui allait se l’envoyer. Elle, issue de la grande bourgeoisie du 16e arrondissement, élevée dans un institut catholique, les a tout de suite jetés. » Ce que l’actrice confirmera plus tard, sans diplomatie : « Alain Delon me prenait pour une conne, le fait que je joue une poufiasse n’arrangeait rien à l’affaire. »
Une star ambiguë et délicieusement complexe
René Clément est un cinéaste exigeant, un technicien avec le sens de la hiérarchie, qui envisage un tournage à la manière d’une suite de problèmes à résoudre et dont il a la clé. Pourtant, le défi le plus imposant posé par le film, une fois le couteau de Ripley planté dans le cœur de Philippe Greenleaf, au milieu d’une partie de cartes sur son bateau, provoquant une tempête, un affolement des éléments, comme si la nature réagissait de manière pulsionnelle au tabou du meurtre, ne doit rien à un quelconque raisonnement mathématique.
« La mer s’est fortement creusée, racontait René Clément, le vent a fraîchi d’un coup. On a filmé en une matinée ce qui nous aurait normalement demandé une semaine de travail. Decaë était à cheval sur l’étrave de la chaloupe, qui faisait des bonds de plus de deux mètres sur les vagues, essayant de fixer ce bateau qui arrivait droit sur nous, et nous nous demandions si Alain saurait éviter la dérive. » Lorsque le beaupré frappe Delon sur la tête, il manque de mourir. S’il avait reçu ce coup sur la tempe… C’est comme si ce déchaînement des éléments, inespéré pour Clément, presque fatal à Delon, devait tout à la force de conviction de l’acteur.
Plein soleil sort en salles le 10 mars 1960 et obtient, avec 2 400 000 entrées, le succès escompté. Delon assied son statut de star. Une star ambiguë et délicieusement complexe. La scène la plus sexuellement incarnée de Plein soleil montre Delon au moment où il envisage de prendre l’identité de Maurice Ronet.
Il revêt le blazer à rayures, la chemise blanche, les mocassins du même ton et le pantalon moulant de son ami. A ce moment précis, Delon ouvre un abîme. Il se pince les lèvres, se mire en narcisse maléfique, susurre des mots salaces en face de cette glace panoramique. Ronet apparaît alors, cravache à la main, le visage à la fois défait et interrogateur devant le théâtre de son compagnon auquel il intime l’ordre de retirer ses habits. Delon répond par cet air en partie insolent, en partie soumis. Un regard de sphinx. Ce garçon lumineux aux idées noires, impossible de le lâcher des yeux. Luchino Visconti, qui l’attend pour le tournage de Rocco et ses frères, l’a tout de suite compris. Delon, lui, n’a pas fini de hanter son époque.
Dominique Delouche a été interviewé en juin 2018. Les citations d’Alain Delon proviennent de « Alain Delon », d’Henri Rode (éditions Pac, 1982). Celles de René Clément du même livre d’Henri Rode, et du numéro de « L’Avant-Scène », du 1er février 1981, consacré à « Plein soleil ».
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Citation
« Alain Delon me prenait pour une conne, le fait que je joue une poufiasse n’arrangeait rien à l’affaire. »
Le trio magique : Ventura, Gabin, Delon. Intestable.
« Le Clan des Siciliens » : Delon et Gabin, un sacré couple
En 1969, Henri Verneuil réunit, pour la deuxième fois, Gabin et Delon. Mais le tournage est perturbé par l’affaire Markovic...
Ce film, les partenaires de Delon, Jean Gabin et Lino Ventura, le réalisateur, Henri Verneuil, et le producteur, Jacques-Eric Strauss, craignent qu’il l’abandonne. Nous sommes le 25 mars 1969. Il est 8 heures. L’équipe du Clan des Siciliens se trouve à l’aéroport de Rome pour le premier jour de tournage. Mais Delon n’est pas là. La scène prévue ce jour-là est celle où Jean Gabin, le parrain d’une famille mafieuse d’origine sicilienne installée à Paris, les Manalese, accueille son partenaire américain, perdu de vue depuis des années, pour visiter une collection de bijoux exposée à la Galerie Borghèse. L’objectif est de s’emparer du prestigieux butin et de le faire sortir d’Italie en détournant un Boeing de la ligne Rome-New York. Rien que ça. Dans le film, Roger Sartet, le truand incarné par Delon, dont Gabin et son clan organisent l’évasion, devient l’adjuvant permettant de rendre possible ce casse autrement impensable. Sans Delon, rien ne peut advenir.
Il est 9 h 10. Toujours pas la moindre trace de l’acteur. « Je me demandais franchement s’il allait arriver, se souvient Jacques-Eric Strauss, il n’avait plus donné de nouvelles depuis longtemps. » Si Delon n’est pas là dans la demi-heure, le tournage devient naufrage, et Le Clan des Siciliens n’est plus qu’un beau rêve.
Retrouvailles six ans après
A l’origine, Jacques-Eric Strauss achète en une matinée les droits du Clan des Siciliens, le roman d’Auguste Le Breton, pour Henri Verneuil, et commandite José Giovanni et Pierre Pelegri pour en écrire l’adaptation. Delon et Gabin donnent leur accord. Il s’agit de leurs retrouvailles, six ans après leur rencontre, en 1963, dans Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil. Lino Ventura dit oui aussi, alors que son rôle de commissaire, absent du roman, reste à écrire.
Mais pour lui, la perspective de croiser à nouveau Gabin après Razzia sur la chnouf (1955), de Henri Decoin, et de partager à nouveau l’affiche avec Delon, deux ans après Les Aventuriers (1967), de Robert Enrico, constitue une garantie suffisante. En fait, les trois acteurs sont ravis de se retrouver, rappelle Delon. « Gabin était heureux de tourner avec « le Lino », comme il l’appelait, et avec « le Môme », comme il m’appelait, Lino était tellement béat d’admiration devant « le Patron » – et moi de même –, devant Gabin, qui était le maître, le patriarche et notre maître à tous que tout ça a fait que la mayonnaise a pris. »
Mais cette mayonnaise a d’abord eu du mal à prendre. Jacques-Eric Strauss reçoit une lettre de Georges Beaume, l’ami et imprésario de Delon, expliquant que son client a trouvé épouvantable le scénario du Clan des Siciliens. Delon en conviendra plus tard, il n’avait en fait rien lu. C’était juste le point de vue de son imprésario. Jacques-Eric Strauss trouve alors le moyen de contourner l’obstacle. Comme il travaille pour le bureau français de la Fox et que Delon est sous contrat avec ce studio américain, il explique à la star qu’en renonçant au film, les frais déjà engagés seront à sa charge. Cette fois, Delon lit le scénario et lève toute réserve, se contentant de formuler deux ou trois remarques sur son rôle, « d’une incontestable pertinence », reconnaît Jacques-Eric Strauss.
Modèle idéal pour Hollywood
Au-delà du prestigieux label Twentieth Century Fox apposé sur Le Clan des Siciliens, le polar de Verneuil est un film sur lequel le patron emblématique de la firme américaine depuis 1944, Darryl F. Zanuck, a son mot à dire. Au point d’imposer, bien qu’aucun rôle n’ait été écrit pour elle, sa compagne de l’époque, Irina Demick, une mannequin et actrice apparue dans Le Jour le plus long (1962), la production titanesque de Zanuck sur le débarquement en Normandie.
Depuis les années 1960 et jusqu’à la fin des années 1970, les grandes firmes américaines produisent en direct des films français : Adèle H., La Chambre verte et L’Homme qui aimait les femmes, de François Truffaut, Le Roi de cœur, de Philippe de Broca, Le Voleur, de Louis Malle, avec Jean-Paul Belmondo. Les films de Verneuil, aussi, modèle idéal pour Hollywood d’un réalisateur capable de concurrencer les Américains sur le terrain du cinéma de genre et d’action. Chaque scène dialoguée du Clan des Siciliens sera, en prévision de sa sortie américaine, tournée en français et en anglais. Depuis le succès phénoménal, aux Etats-Unis, de Plein soleil et de Mélodie en sous-sol, Hollywood rêve toujours de Delon. Le passage, compliqué, entre 1964 et 1966, de l’acteur à Los Angeles doit beaucoup à sa réticence à vivre en Californie, à la nostalgie de sa langue, à l’amour d’une culture et d’un mode de vie français. Bref, la partie ne se joue pas selon ses règles, et donc ça n’a pas marché.
Un homme seul sort de l’avion, son pilote : Alain Delon. Il arbore une chemise noire, largement ouverte, et un immense sourire
A 9 h 15, l’équipe du Clan des Siciliens aperçoit, à travers l’immense baie vitrée de l’aéroport de Rome, un tout petit avion pointer dans le ciel. Cette tache dans l’horizon grossit peu à peu, pique brutalement sur le tarmac et atterrit en douceur. Un homme seul sort de l’avion, son pilote : Alain Delon. Il arbore une chemise noire, largement ouverte, et un immense sourire. Aujourd’hui encore, les images de cette arrivée restent impressionnantes. On lit sur le visage de l’acteur le bonheur de se retrouver ici, la certitude de produire son effet, tant auprès de l’équipe de tournage que du personnel de l’aéroport, qui n’en revient pas de voir débarquer ainsi la plus grande star européenne. Delon a l’habitude de ces arrivées théâtrales et royales, dans la vie, sur certains tournages, souvent en pilotant son hélicoptère. Mais là, il fait plus fort avec un avion. Il traverse alors la piste, et sa présence suffit à neutraliser le trafic aérien. Rien autour de lui. Ou presque. Car arrive Gabin, pressé de commencer sa journée de travail. Delon se jette dans ses bras et lui lance : « Patron, on va tourner ensemble, ça fait plaisir. »
Gabin a juste le temps de remarquer, par un bref coup d’œil, que son partenaire ne s’est pas donné la peine de saluer son producteur. Delon estime que ce dernier qui, à 32 ans, se révèle d’un an son cadet, lui a forcé la main. « De toute façon, souligne Jacques-Eric Strauss, Delon est cyclothymique. Un jour, il vient et vous embrasse, l’autre jour, il ne vous dit plus bonjour. Il faut le prendre comme il est. » Gabin a pour usage de régir les relations sur un tournage. Cet ordre commence par les civilités. L’acteur de La Grande Illusion surnomme d’emblée Strauss « petit con » – une marque d’affection chez lui. Il demande au « petit con » de s’approcher de lui, fait signe à Delon et lui dit : « Dis donc, tu n’es pas très poli, tu ne dis même pas bonjour à ton producteur. »
Delon arrive quand même par s’inviter dans le film en proposant un cachet à la baisse
L’acteur ne manquera plus jamais à son devoir de courtoisie. « Gabin jouissait d’un énorme respect, souligne Bernard Stora, l’assistant de Verneuil sur le film. Il avait 65 ans à l’époque, faisait très vieux avec sa carrure, ses cheveux blancs, sa démarche. On ne mouftait pas devant lui. Son autorité se marquait pas sa seule présence et les films qu’il avait faits. Quand cela n’allait pas, il intervenait pour mettre tout le monde d’accord. Il était le patron sur le plateau. Même Verneuil n’avait pas l’ascendant sur lui. »
Un des rares films dont Delon gardait un souvenir particulier est Touchez pas au grisbi, le plus grand film policier français des années 1950, qui marque le retour en force de Jean Gabin dans le cinéma français depuis son départ du pays, en 1940, pour rejoindre les Forces françaises libres. Il le découvre à Saïgon en 1954 ou 1955, raconte Delon, quand il est soldat en Indochine. A ce moment, il est à mille lieues de penser qu’il va devenir comédien. Alors jouer avec Gabin…
Mais au début des années 1960, il est impressionné par le duo Gabin/Belmondo – par Gabin surtout – dans Un singe en hiver, l’adaptation du roman d’Antoine Blondin par Verneuil. Au point que son agent, Georges Beaume, fait des pieds et des mains pour qu’il obtienne un rôle dans Mélodie en sous-sol. La Metro-Goldwyn-Mayer estime que la présence de Gabin est suffisante dans le rôle d’un caïd à cheveux blancs et que, pour jouer un acolyte aux dents longues, un inconnu suffira – le tandem doit organiser un casse dans les sous-sols du casino de Cannes. Delon arrive quand même par s’inviter dans le film en proposant un cachet à la baisse.
« Bonjour Monsieur Gabin. Enchanté de vous connaître »
Mais pour finaliser son arrivée, il faut l’approbation de Gabin. Jacques Bar, le producteur français du film, organise le rendez-vous entre les deux comédiens dans son bureau de la rue Pierre-Charron. L’examen se révélait parfois impitoyable pour certains candidats. Pierre Louis, qui a joué un inspecteur face à Gabin dans Razzia sur la chnouf, explique bien le défi à relever : « A ce monstre sacré, on plaisait ou on ne plaisait pas. Il était parfaitement inutile d’esquisser un brin de cour, de faire assaut de flagornerie, de multiplier les attentions pour obtenir ses faveurs. “Tout ou rien.” A cette devise se limitait son choix éclairé et définitif. »
A peine Delon franchit-il le seuil de la porte que Gabin se lève et lui lance un « Bonjour, monsieur », ajoutant un geste inhabituel de sa part : il lui tend la main. « Bonjour, monsieur Gabin. Enchanté de vous connaître », répond poliment Delon. Le « monsieur Gabin », cette marque de respect sèche et sincère, conquiert l’intéressé. « J’ai toujours été amoureux et respectueux des hiérarchies de ce métier, explique Delon. Le simple fait qu’un homme comme Jean Gabin se soit levé pour me dire “Bonjour, monsieur” et me serrer la main m’a laissé pétrifié sur place. D’autant que j’en avais plein la vue de cet homme qui, l’année de ma naissance, avait déjà tourné Pépé le Moko. »
Durant le tournage d’Un singe en hiver, la décontraction et la facilité de Jean-Paul Belmondo, y compris dans ses relations avec lui, déroutent Gabin. Alors que sur le plateau de Mélodie en sous-sol, la tension manifestée par Delon, la pression qu’il se met sur les épaules, et une attention de tous instants à l’égard de Gabin, impressionnent autrement ce dernier. Le jeune acteur n’hésite pas à aller au-devant de son aîné pour le saluer quand celui-ci arrive le matin ou à lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles quand il ne tourne pas. En fait, Gabin retrouve en Delon l’acteur qu’il fut à ses débuts. La théâtralité exubérante de Belmondo lui reste si éloignée quand le mutisme de Delon, son comportement réfléchi sous des dehors d’adolescent futile, ne peuvent que le séduire. Les deux hommes ont aussi des sujets communs. Tous deux sont d’anciens soldats, dans la marine. Tous deux ont commencé par un tout autre métier. Gabin descendait les escaliers des Folies-Bergère, derrière Mistinguett. Un peu comme Burt Lancaster, ancien trapéziste, le partenaire de Delon dans Le Guépard. Delon estime appartenir à cette famille d’acteurs façonnés par les circonstances de la vie.
Le rôle de mentor
Gabin est le seul acteur avec lequel Delon fonctionne en couple. Avec Jean-Paul Belmondo, c’est une autre histoire. Le tandem qu’ils forment dans Borsalino (1974), de Jacques Deray, est teinté de rivalité. Même si tous deux côtoient les cimes du box-office, l’acteur emblématique de la Nouvelle Vague évolue dans un univers parallèle à celui de Delon. Maurice Ronet, que Delon tue dans Plein Soleil et qu’il noie dans La Piscine, apparaît davantage comme son vassal. A Gabin est dévolu le rôle du mentor.
Le tournage du « Clan » a lieu en grande partie dans les studios de Saint-Maurice, en banlieue parisienne. Comme l’explique Bernard Stora, il faut imaginer le plateau à la manière d’un camp au Moyen Age, où il y aurait, pour les trois acteurs phares, la tente du prince, celle du duc, ou encore celle du comte. Gabin a son habilleuse et sa maquilleuse personnelles. Ventura, de même. Pas Delon. Ce dernier entretient des rapports courtois avec tout le monde mais ne copine pas. Cela ne l’intéresse pas. « Il venait pour tourner, précise Bernard Stora. Il vous disait : “A quelle heure vous avez besoin de moi ? On lui répondait 16 h 15. » A 16 h 14, la porte du studio s’ouvrait, et Delon entrait. Entre-temps, soit il était dans sa loge, ou dehors, à la porte du studio. »
Un entrefilet anodin dans la presse
Mais quand il ne tourne pas, Alain Delon doit gérer un emploi du temps inhabituellement chargé. Cinq mois plus tôt éclate ce que l’on appelle l’affaire Markovic. Celle-ci apparaît sous la forme d’un entrefilet anodin dans la presse. Le Monde du 3 octobre 1968 écrit : « Le corps d’un homme enveloppé dans une toile de plastique a été découvert dans un ravin près d’Elancourt (Yvelines). Agée de 30 à 40 ans, la victime porte une profonde blessure à la tête qui, l’autopsie l’a confirmé, est à l’origine de la mort. Une enquête est en cours. » Ce banal fait divers va se transformer en affaire d’Etat.
La victime en question s’appelle Stevan Markovic. Il est yougoslave, habite un deux pièces dans l’hôtel particulier d’Alain Delon, rue de Messine, à Paris. Il a été le garde du corps de l’acteur, sa doublure lumière aussi. D’autres choses encore. Il a entretenu une brève liaison avec Nathalie Delon alors qu’elle se trouvait en instance de divorce avec Alain Delon. Markovic est retrouvé le 1er octobre au milieu d’une décharge publique. Les regards se tournent vers Delon, qui est à Saint-Tropez en plein tournage de La Piscine. Dans cette affaire, il n’est pourtant ni suspect ni témoin, et ne sera jamais inculpé.
Seulement, quelques jours avant sa disparition, Markovic écrit à son frère une lettre lui expliquant qu’en cas de malheur, il faudrait chercher du côté d’un certain « AD » et de François Marcantoni. Ce dernier, une des figures du milieu, est un ami de l’acteur. L’affaire prend ensuite un tour politique lorsque circule la rumeur que Markovic négociait des photos compromettantes, prises lors de parties fines, où figurerait la femme d’un homme politique, nommément Claude Pompidou, l’épouse de l’ancien premier ministre Georges Pompidou, qui a quitté Matignon en juillet 1968.
Cinquante-deux heures de garde à vue
La police fait son travail, contraignant Delon à cinquante-deux heures de garde à vue et d’interrogatoires. Cette pression pèse sur le tournage du Clan des Siciliens. « C’était horrible, se souvient Jacques-Eric Strauss. Il y avait tous les jours deux inspecteurs sur le plateau. A la fin du tournage, Delon partait porte Maillot. On ne savait pas si on allait le revoir. J’attendais dans les couloirs, le commissaire sortait de temps en temps et me disait : “Je crois que ce soir, on le tient.” Ça a duré une semaine mais, à la fin, ils n’ont rien trouvé. Delon a assuré complètement le tournage, il n’a jamais laissé cette affaire perturber son travail. »
Delon redoute l’effet produit par l’une des séquences les plus spectaculaires du film. Non pas celle, dans toutes les mémoires, du Boeing survolant les tours jumelles de Manhattan, puis atterrissant avec sa précieuse cargaison sur une autoroute de la banlieue de New York. Non, la scène qui l’inquiète repose sur la seule précision de ses gestes : menotté, il s’évade sur la route entre le Palais de justice et la prison de Fresnes en sciant le fond de son fourgon cellulaire. C’est une idée de scénariste, inspirée de la véritable évasion de René « la Canne ».
Mais Delon craint que cette séquence soit détournée à d’autres fins : « Je vais tourner ma première scène du Clan des Siciliens au Palais de justice, dans ce qu’on appelle “la souricière”. Je dois sortir du fourgon et entrer dans le cabinet du juge d’instruction. C’est un contrat signé il y a dix-huit mois. Aujourd’hui, je suis à la merci d’une photo, à la “une” des journaux avec des menottes. » Le Clan des Siciliens sort en décembre 1969. Six mois plus tôt, Georges Pompidou est élu président de la République. Les derniers feux de l’affaire Markovic se sont dissipés.
Lino Ventura et Alain Delon.
Lino Ventura et Alain Delon. Fox Europa /Prod DB
Un sondage Ifop de 1969, sorti au plus fort des rumeurs sur Delon, classe l’acteur parmi les dix personnalités les plus estimées par les Français. Ses trois films qui remporteront le plus grand succès sont Le Clan des Siciliens (4 800 000 entrées), Borsalino (4 700 000 entrées) et Le Cercle rouge (4 300 000 entrées), tous sortis en 1969 et 1970, juste après l’affaire Markovic. Un effet Delon ?
C’est, pour certains, un souvenir d’enfance. Et pour ceux qui découvrent plus âgés Le Clan des Siciliens, un fait marquant de leur vie d’adulte. Dans le film, Delon aperçoit le corps nu d’Irina Demick sur la plage, le fameux mannequin imposé par le producteur Darryl Zanuck. Fulgurante et lumineuse apparition. Delon, cheveux longs, lunettes fumées, blouson crème à même le corps, tourne tel un prédateur autour des formes de sa proie.
La musique qui accompagne la scène est un air à la guimbarde, entêtant, d’Ennio Morricone. Il colle si bien à la respiration de Delon qu’il est difficile de l’effacer de sa mémoire. Delon se révèle en 1969 l’acteur le plus érotique du monde. C’est une chose entendue pour la génération 1968 qui réfrène, à la manière d’un secret inavouable, sa passion pour une star, à ses yeux, trop proche du pouvoir gaulliste. Mais c’est une révélation pour une autre génération, plus jeune, étrangère aux soubresauts de la révolution, dont l’adolescence consiste à observer les gestes assurés et insolents de cet homme, espérant un jour les reproduire. Autrefois élève, Delon se mue à son tour en mentor. Le mentor d’une génération.
Jacques-Eric Strauss et Bernard Stora ont été interviewés en juin. Les propos d’Alain Delon proviennent de Jean Gabin inconnu, de Jean-Jacques Jelot-Blanc (Flammarion, 2014) et de Delon - Les Femmes de ma vie, de Philippe Barbier (éditions Carpentier, 2011).
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
« Le Clan des Siciliens » : Delon et Gabin, un sacré couple
En 1969, Henri Verneuil réunit, pour la deuxième fois, Gabin et Delon. Mais le tournage est perturbé par l’affaire Markovic...
Ce film, les partenaires de Delon, Jean Gabin et Lino Ventura, le réalisateur, Henri Verneuil, et le producteur, Jacques-Eric Strauss, craignent qu’il l’abandonne. Nous sommes le 25 mars 1969. Il est 8 heures. L’équipe du Clan des Siciliens se trouve à l’aéroport de Rome pour le premier jour de tournage. Mais Delon n’est pas là. La scène prévue ce jour-là est celle où Jean Gabin, le parrain d’une famille mafieuse d’origine sicilienne installée à Paris, les Manalese, accueille son partenaire américain, perdu de vue depuis des années, pour visiter une collection de bijoux exposée à la Galerie Borghèse. L’objectif est de s’emparer du prestigieux butin et de le faire sortir d’Italie en détournant un Boeing de la ligne Rome-New York. Rien que ça. Dans le film, Roger Sartet, le truand incarné par Delon, dont Gabin et son clan organisent l’évasion, devient l’adjuvant permettant de rendre possible ce casse autrement impensable. Sans Delon, rien ne peut advenir.
Il est 9 h 10. Toujours pas la moindre trace de l’acteur. « Je me demandais franchement s’il allait arriver, se souvient Jacques-Eric Strauss, il n’avait plus donné de nouvelles depuis longtemps. » Si Delon n’est pas là dans la demi-heure, le tournage devient naufrage, et Le Clan des Siciliens n’est plus qu’un beau rêve.
Retrouvailles six ans après
A l’origine, Jacques-Eric Strauss achète en une matinée les droits du Clan des Siciliens, le roman d’Auguste Le Breton, pour Henri Verneuil, et commandite José Giovanni et Pierre Pelegri pour en écrire l’adaptation. Delon et Gabin donnent leur accord. Il s’agit de leurs retrouvailles, six ans après leur rencontre, en 1963, dans Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil. Lino Ventura dit oui aussi, alors que son rôle de commissaire, absent du roman, reste à écrire.
Mais pour lui, la perspective de croiser à nouveau Gabin après Razzia sur la chnouf (1955), de Henri Decoin, et de partager à nouveau l’affiche avec Delon, deux ans après Les Aventuriers (1967), de Robert Enrico, constitue une garantie suffisante. En fait, les trois acteurs sont ravis de se retrouver, rappelle Delon. « Gabin était heureux de tourner avec « le Lino », comme il l’appelait, et avec « le Môme », comme il m’appelait, Lino était tellement béat d’admiration devant « le Patron » – et moi de même –, devant Gabin, qui était le maître, le patriarche et notre maître à tous que tout ça a fait que la mayonnaise a pris. »
Mais cette mayonnaise a d’abord eu du mal à prendre. Jacques-Eric Strauss reçoit une lettre de Georges Beaume, l’ami et imprésario de Delon, expliquant que son client a trouvé épouvantable le scénario du Clan des Siciliens. Delon en conviendra plus tard, il n’avait en fait rien lu. C’était juste le point de vue de son imprésario. Jacques-Eric Strauss trouve alors le moyen de contourner l’obstacle. Comme il travaille pour le bureau français de la Fox et que Delon est sous contrat avec ce studio américain, il explique à la star qu’en renonçant au film, les frais déjà engagés seront à sa charge. Cette fois, Delon lit le scénario et lève toute réserve, se contentant de formuler deux ou trois remarques sur son rôle, « d’une incontestable pertinence », reconnaît Jacques-Eric Strauss.
Modèle idéal pour Hollywood
Au-delà du prestigieux label Twentieth Century Fox apposé sur Le Clan des Siciliens, le polar de Verneuil est un film sur lequel le patron emblématique de la firme américaine depuis 1944, Darryl F. Zanuck, a son mot à dire. Au point d’imposer, bien qu’aucun rôle n’ait été écrit pour elle, sa compagne de l’époque, Irina Demick, une mannequin et actrice apparue dans Le Jour le plus long (1962), la production titanesque de Zanuck sur le débarquement en Normandie.
Depuis les années 1960 et jusqu’à la fin des années 1970, les grandes firmes américaines produisent en direct des films français : Adèle H., La Chambre verte et L’Homme qui aimait les femmes, de François Truffaut, Le Roi de cœur, de Philippe de Broca, Le Voleur, de Louis Malle, avec Jean-Paul Belmondo. Les films de Verneuil, aussi, modèle idéal pour Hollywood d’un réalisateur capable de concurrencer les Américains sur le terrain du cinéma de genre et d’action. Chaque scène dialoguée du Clan des Siciliens sera, en prévision de sa sortie américaine, tournée en français et en anglais. Depuis le succès phénoménal, aux Etats-Unis, de Plein soleil et de Mélodie en sous-sol, Hollywood rêve toujours de Delon. Le passage, compliqué, entre 1964 et 1966, de l’acteur à Los Angeles doit beaucoup à sa réticence à vivre en Californie, à la nostalgie de sa langue, à l’amour d’une culture et d’un mode de vie français. Bref, la partie ne se joue pas selon ses règles, et donc ça n’a pas marché.
Un homme seul sort de l’avion, son pilote : Alain Delon. Il arbore une chemise noire, largement ouverte, et un immense sourire
A 9 h 15, l’équipe du Clan des Siciliens aperçoit, à travers l’immense baie vitrée de l’aéroport de Rome, un tout petit avion pointer dans le ciel. Cette tache dans l’horizon grossit peu à peu, pique brutalement sur le tarmac et atterrit en douceur. Un homme seul sort de l’avion, son pilote : Alain Delon. Il arbore une chemise noire, largement ouverte, et un immense sourire. Aujourd’hui encore, les images de cette arrivée restent impressionnantes. On lit sur le visage de l’acteur le bonheur de se retrouver ici, la certitude de produire son effet, tant auprès de l’équipe de tournage que du personnel de l’aéroport, qui n’en revient pas de voir débarquer ainsi la plus grande star européenne. Delon a l’habitude de ces arrivées théâtrales et royales, dans la vie, sur certains tournages, souvent en pilotant son hélicoptère. Mais là, il fait plus fort avec un avion. Il traverse alors la piste, et sa présence suffit à neutraliser le trafic aérien. Rien autour de lui. Ou presque. Car arrive Gabin, pressé de commencer sa journée de travail. Delon se jette dans ses bras et lui lance : « Patron, on va tourner ensemble, ça fait plaisir. »
Gabin a juste le temps de remarquer, par un bref coup d’œil, que son partenaire ne s’est pas donné la peine de saluer son producteur. Delon estime que ce dernier qui, à 32 ans, se révèle d’un an son cadet, lui a forcé la main. « De toute façon, souligne Jacques-Eric Strauss, Delon est cyclothymique. Un jour, il vient et vous embrasse, l’autre jour, il ne vous dit plus bonjour. Il faut le prendre comme il est. » Gabin a pour usage de régir les relations sur un tournage. Cet ordre commence par les civilités. L’acteur de La Grande Illusion surnomme d’emblée Strauss « petit con » – une marque d’affection chez lui. Il demande au « petit con » de s’approcher de lui, fait signe à Delon et lui dit : « Dis donc, tu n’es pas très poli, tu ne dis même pas bonjour à ton producteur. »
Delon arrive quand même par s’inviter dans le film en proposant un cachet à la baisse
L’acteur ne manquera plus jamais à son devoir de courtoisie. « Gabin jouissait d’un énorme respect, souligne Bernard Stora, l’assistant de Verneuil sur le film. Il avait 65 ans à l’époque, faisait très vieux avec sa carrure, ses cheveux blancs, sa démarche. On ne mouftait pas devant lui. Son autorité se marquait pas sa seule présence et les films qu’il avait faits. Quand cela n’allait pas, il intervenait pour mettre tout le monde d’accord. Il était le patron sur le plateau. Même Verneuil n’avait pas l’ascendant sur lui. »
Un des rares films dont Delon gardait un souvenir particulier est Touchez pas au grisbi, le plus grand film policier français des années 1950, qui marque le retour en force de Jean Gabin dans le cinéma français depuis son départ du pays, en 1940, pour rejoindre les Forces françaises libres. Il le découvre à Saïgon en 1954 ou 1955, raconte Delon, quand il est soldat en Indochine. A ce moment, il est à mille lieues de penser qu’il va devenir comédien. Alors jouer avec Gabin…
Mais au début des années 1960, il est impressionné par le duo Gabin/Belmondo – par Gabin surtout – dans Un singe en hiver, l’adaptation du roman d’Antoine Blondin par Verneuil. Au point que son agent, Georges Beaume, fait des pieds et des mains pour qu’il obtienne un rôle dans Mélodie en sous-sol. La Metro-Goldwyn-Mayer estime que la présence de Gabin est suffisante dans le rôle d’un caïd à cheveux blancs et que, pour jouer un acolyte aux dents longues, un inconnu suffira – le tandem doit organiser un casse dans les sous-sols du casino de Cannes. Delon arrive quand même par s’inviter dans le film en proposant un cachet à la baisse.
« Bonjour Monsieur Gabin. Enchanté de vous connaître »
Mais pour finaliser son arrivée, il faut l’approbation de Gabin. Jacques Bar, le producteur français du film, organise le rendez-vous entre les deux comédiens dans son bureau de la rue Pierre-Charron. L’examen se révélait parfois impitoyable pour certains candidats. Pierre Louis, qui a joué un inspecteur face à Gabin dans Razzia sur la chnouf, explique bien le défi à relever : « A ce monstre sacré, on plaisait ou on ne plaisait pas. Il était parfaitement inutile d’esquisser un brin de cour, de faire assaut de flagornerie, de multiplier les attentions pour obtenir ses faveurs. “Tout ou rien.” A cette devise se limitait son choix éclairé et définitif. »
A peine Delon franchit-il le seuil de la porte que Gabin se lève et lui lance un « Bonjour, monsieur », ajoutant un geste inhabituel de sa part : il lui tend la main. « Bonjour, monsieur Gabin. Enchanté de vous connaître », répond poliment Delon. Le « monsieur Gabin », cette marque de respect sèche et sincère, conquiert l’intéressé. « J’ai toujours été amoureux et respectueux des hiérarchies de ce métier, explique Delon. Le simple fait qu’un homme comme Jean Gabin se soit levé pour me dire “Bonjour, monsieur” et me serrer la main m’a laissé pétrifié sur place. D’autant que j’en avais plein la vue de cet homme qui, l’année de ma naissance, avait déjà tourné Pépé le Moko. »
Durant le tournage d’Un singe en hiver, la décontraction et la facilité de Jean-Paul Belmondo, y compris dans ses relations avec lui, déroutent Gabin. Alors que sur le plateau de Mélodie en sous-sol, la tension manifestée par Delon, la pression qu’il se met sur les épaules, et une attention de tous instants à l’égard de Gabin, impressionnent autrement ce dernier. Le jeune acteur n’hésite pas à aller au-devant de son aîné pour le saluer quand celui-ci arrive le matin ou à lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles quand il ne tourne pas. En fait, Gabin retrouve en Delon l’acteur qu’il fut à ses débuts. La théâtralité exubérante de Belmondo lui reste si éloignée quand le mutisme de Delon, son comportement réfléchi sous des dehors d’adolescent futile, ne peuvent que le séduire. Les deux hommes ont aussi des sujets communs. Tous deux sont d’anciens soldats, dans la marine. Tous deux ont commencé par un tout autre métier. Gabin descendait les escaliers des Folies-Bergère, derrière Mistinguett. Un peu comme Burt Lancaster, ancien trapéziste, le partenaire de Delon dans Le Guépard. Delon estime appartenir à cette famille d’acteurs façonnés par les circonstances de la vie.
Le rôle de mentor
Gabin est le seul acteur avec lequel Delon fonctionne en couple. Avec Jean-Paul Belmondo, c’est une autre histoire. Le tandem qu’ils forment dans Borsalino (1974), de Jacques Deray, est teinté de rivalité. Même si tous deux côtoient les cimes du box-office, l’acteur emblématique de la Nouvelle Vague évolue dans un univers parallèle à celui de Delon. Maurice Ronet, que Delon tue dans Plein Soleil et qu’il noie dans La Piscine, apparaît davantage comme son vassal. A Gabin est dévolu le rôle du mentor.
Le tournage du « Clan » a lieu en grande partie dans les studios de Saint-Maurice, en banlieue parisienne. Comme l’explique Bernard Stora, il faut imaginer le plateau à la manière d’un camp au Moyen Age, où il y aurait, pour les trois acteurs phares, la tente du prince, celle du duc, ou encore celle du comte. Gabin a son habilleuse et sa maquilleuse personnelles. Ventura, de même. Pas Delon. Ce dernier entretient des rapports courtois avec tout le monde mais ne copine pas. Cela ne l’intéresse pas. « Il venait pour tourner, précise Bernard Stora. Il vous disait : “A quelle heure vous avez besoin de moi ? On lui répondait 16 h 15. » A 16 h 14, la porte du studio s’ouvrait, et Delon entrait. Entre-temps, soit il était dans sa loge, ou dehors, à la porte du studio. »
Un entrefilet anodin dans la presse
Mais quand il ne tourne pas, Alain Delon doit gérer un emploi du temps inhabituellement chargé. Cinq mois plus tôt éclate ce que l’on appelle l’affaire Markovic. Celle-ci apparaît sous la forme d’un entrefilet anodin dans la presse. Le Monde du 3 octobre 1968 écrit : « Le corps d’un homme enveloppé dans une toile de plastique a été découvert dans un ravin près d’Elancourt (Yvelines). Agée de 30 à 40 ans, la victime porte une profonde blessure à la tête qui, l’autopsie l’a confirmé, est à l’origine de la mort. Une enquête est en cours. » Ce banal fait divers va se transformer en affaire d’Etat.
La victime en question s’appelle Stevan Markovic. Il est yougoslave, habite un deux pièces dans l’hôtel particulier d’Alain Delon, rue de Messine, à Paris. Il a été le garde du corps de l’acteur, sa doublure lumière aussi. D’autres choses encore. Il a entretenu une brève liaison avec Nathalie Delon alors qu’elle se trouvait en instance de divorce avec Alain Delon. Markovic est retrouvé le 1er octobre au milieu d’une décharge publique. Les regards se tournent vers Delon, qui est à Saint-Tropez en plein tournage de La Piscine. Dans cette affaire, il n’est pourtant ni suspect ni témoin, et ne sera jamais inculpé.
Seulement, quelques jours avant sa disparition, Markovic écrit à son frère une lettre lui expliquant qu’en cas de malheur, il faudrait chercher du côté d’un certain « AD » et de François Marcantoni. Ce dernier, une des figures du milieu, est un ami de l’acteur. L’affaire prend ensuite un tour politique lorsque circule la rumeur que Markovic négociait des photos compromettantes, prises lors de parties fines, où figurerait la femme d’un homme politique, nommément Claude Pompidou, l’épouse de l’ancien premier ministre Georges Pompidou, qui a quitté Matignon en juillet 1968.
Cinquante-deux heures de garde à vue
La police fait son travail, contraignant Delon à cinquante-deux heures de garde à vue et d’interrogatoires. Cette pression pèse sur le tournage du Clan des Siciliens. « C’était horrible, se souvient Jacques-Eric Strauss. Il y avait tous les jours deux inspecteurs sur le plateau. A la fin du tournage, Delon partait porte Maillot. On ne savait pas si on allait le revoir. J’attendais dans les couloirs, le commissaire sortait de temps en temps et me disait : “Je crois que ce soir, on le tient.” Ça a duré une semaine mais, à la fin, ils n’ont rien trouvé. Delon a assuré complètement le tournage, il n’a jamais laissé cette affaire perturber son travail. »
Delon redoute l’effet produit par l’une des séquences les plus spectaculaires du film. Non pas celle, dans toutes les mémoires, du Boeing survolant les tours jumelles de Manhattan, puis atterrissant avec sa précieuse cargaison sur une autoroute de la banlieue de New York. Non, la scène qui l’inquiète repose sur la seule précision de ses gestes : menotté, il s’évade sur la route entre le Palais de justice et la prison de Fresnes en sciant le fond de son fourgon cellulaire. C’est une idée de scénariste, inspirée de la véritable évasion de René « la Canne ».
Mais Delon craint que cette séquence soit détournée à d’autres fins : « Je vais tourner ma première scène du Clan des Siciliens au Palais de justice, dans ce qu’on appelle “la souricière”. Je dois sortir du fourgon et entrer dans le cabinet du juge d’instruction. C’est un contrat signé il y a dix-huit mois. Aujourd’hui, je suis à la merci d’une photo, à la “une” des journaux avec des menottes. » Le Clan des Siciliens sort en décembre 1969. Six mois plus tôt, Georges Pompidou est élu président de la République. Les derniers feux de l’affaire Markovic se sont dissipés.
Lino Ventura et Alain Delon.
Lino Ventura et Alain Delon. Fox Europa /Prod DB
Un sondage Ifop de 1969, sorti au plus fort des rumeurs sur Delon, classe l’acteur parmi les dix personnalités les plus estimées par les Français. Ses trois films qui remporteront le plus grand succès sont Le Clan des Siciliens (4 800 000 entrées), Borsalino (4 700 000 entrées) et Le Cercle rouge (4 300 000 entrées), tous sortis en 1969 et 1970, juste après l’affaire Markovic. Un effet Delon ?
C’est, pour certains, un souvenir d’enfance. Et pour ceux qui découvrent plus âgés Le Clan des Siciliens, un fait marquant de leur vie d’adulte. Dans le film, Delon aperçoit le corps nu d’Irina Demick sur la plage, le fameux mannequin imposé par le producteur Darryl Zanuck. Fulgurante et lumineuse apparition. Delon, cheveux longs, lunettes fumées, blouson crème à même le corps, tourne tel un prédateur autour des formes de sa proie.
La musique qui accompagne la scène est un air à la guimbarde, entêtant, d’Ennio Morricone. Il colle si bien à la respiration de Delon qu’il est difficile de l’effacer de sa mémoire. Delon se révèle en 1969 l’acteur le plus érotique du monde. C’est une chose entendue pour la génération 1968 qui réfrène, à la manière d’un secret inavouable, sa passion pour une star, à ses yeux, trop proche du pouvoir gaulliste. Mais c’est une révélation pour une autre génération, plus jeune, étrangère aux soubresauts de la révolution, dont l’adolescence consiste à observer les gestes assurés et insolents de cet homme, espérant un jour les reproduire. Autrefois élève, Delon se mue à son tour en mentor. Le mentor d’une génération.
Jacques-Eric Strauss et Bernard Stora ont été interviewés en juin. Les propos d’Alain Delon proviennent de Jean Gabin inconnu, de Jean-Jacques Jelot-Blanc (Flammarion, 2014) et de Delon - Les Femmes de ma vie, de Philippe Barbier (éditions Carpentier, 2011).
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Merci pour ces articles.
Ça donne envie de revoir ces films.
Ça donne envie de revoir ces films.
La musique (entre autres) de ce film est géniale, le truc qui te reste en tête indéfiniment.
Des acteurs de cette trempe, y en a plus malheureusement 
Je sais pas si c'est une question de talent, mais c'est sûr par contre qu'il y a un truc avec les productions françaises. On peut trouver des oeuvres sympas...Mais ça va pas très loin, on sait plus faire de polars...
Mardi dernier J'ai vu Shazam au Grand Rex
Bonne surprise, je m'attendais a un sketch entier de 2h, il s'avere que les bandes annonces on ete trompeuses & qu'il ont caché pas mal de choses concernant l'histoire .
Au final ce n'est pas si Enfantin que cela et c'est meme tres orienté" Horreur" par certains moments.
Zachari Levi fait le taf, mais celui qui creve l'ecran c'est Jack Dylan Graser, lui il est enorme.
c'est un bon film qui merite clairement une franchise, comme Aquaman.
Bonne surprise, je m'attendais a un sketch entier de 2h, il s'avere que les bandes annonces on ete trompeuses & qu'il ont caché pas mal de choses concernant l'histoire .
Au final ce n'est pas si Enfantin que cela et c'est meme tres orienté" Horreur" par certains moments.
Zachari Levi fait le taf, mais celui qui creve l'ecran c'est Jack Dylan Graser, lui il est enorme.
c'est un bon film qui merite clairement une franchise, comme Aquaman.
Ce casting
The Highwaymen, des avis?
Il me reste 30 minutes à regarder mais pour l'instant je trouve ça vraiment pas mal.
Par contre Dumbo : bof. On avait vendu ça comme un retour de Tim Burton mais on voit à peine que c'est lui le réal sauf vite fait en seconde partie de film dans Dreamland. Film cool pour les enfants mais oubliable.
Difficile de dire si le film sera bon (le traitement peut vite virer au cliché), mais ce premier teaser donne quand même bien envie.
Todd Phillips en réal, ça fait pas trop envie.
Joaquin Phoenix, par contre.
Joaquin Phoenix, par contre.
À la base je suis pas fan des histoires "origins" sur les personnages qui incarnent le mal absolu : Joker, Michael Myers, Leatherface...
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
Même chose pour Anton Chigurh dans No country for old man.
étudier la trajectoire d'un "villain" ça marche quand on parle d'un type qui bascule dans la criminalité tout en gardant une part d'humanité ou d'empathie, type Walter White, mais pour les cas cités plus haut je trouve que ça fonctionne pas.
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
Même chose pour Anton Chigurh dans No country for old man.
étudier la trajectoire d'un "villain" ça marche quand on parle d'un type qui bascule dans la criminalité tout en gardant une part d'humanité ou d'empathie, type Walter White, mais pour les cas cités plus haut je trouve que ça fonctionne pas.
Dernier volet delonien. Un film que je n'ai pas vu, hélas :
En 1964, Alain Delon a beau se trouver au début de sa carrière d’acteur, il a d’emblée placé celle-ci à très haute altitude, entre films d’auteur et cinéma populaire. Il a tourné Plein soleil, de René Clément, Rocco et ses frères et Le Guépard de Luchino Visconti, L’Eclipse, de Michelangelo Antonioni. Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil est un immense succès public, avec en prime la rencontre déterminante avec Jean Gabin. La filmographie est si dense que le patron de la Cinémathèque française, Henri Langlois, décide de consacrer une rétrospective à cet acteur qui n’a pas 30 ans, mais qui a déjà seize films à son actif.
Et maintenant ? Une seule certitude. Il entend diriger avec encore plus d’acuité le cours de sa carrière. L’acteur devient producteur et commence déjà à parler de lui à la troisième personne. « Il existe une marchandise Delon, explique-t-il, et je me suis dit : “Pourquoi moi, Delon, je ne l’exploiterais pas, cette marchandise ?” » Il entreprend pour cela, en compagnie de son imprésario, Georges Beaume, de créer sa maison de production, baptisée Delbeau, soit la première syllabe des deux noms de famille des fondateurs. Courtisé par Hollywood, s’apprêtant à lancer sa carrière américaine, Delon hérite de l’argent de la prestigieuse Metro-Goldwyn-Mayer qu’il va gérer, à sa guise.
Mais cet acteur ne fait décidément rien comme les autres. Delon accepte, fait nouveau pour lui, la proposition d’un réalisateur de sa génération, Alain Cavalier, 33 ans, et accepte de jouer et de produire son nouveau film, L’Insoumis. Cavalier se trouve au tout début d’une longue et prestigieuse carrière, où il va s’imposer comme l’une des voix les plus singulières du cinéma français – La Chamade (1968) ; Un étrange voyage (1980) ; Thérèse (1986) ; Le Filmeur (2005) ; Pater (2011). Quand il rencontre Delon, le réalisateur n’a qu’un film à son actif, Le Combat dans l’île, tourné deux ans plus tôt, en 1962.
Un film idéal pour lui
Delon pressent néanmoins que ce nouveau projet, qui prend pour toile de fond la guerre d’Algérie – très vivace dans les esprits –, est un film idéal pour lui. Le scénario est écrit par Cavalier avec le journaliste et romancier Jean Cau, ancien secrétaire de Sartre, grand reporter et essayiste, Prix Goncourt en 1961, bref en vogue, et qui n’a pas encore basculé de la gauche vers la droite.
Cavalier et Delon se rencontrent sur le plateau du Combat dans l’île. L’acteur rend visite à sa compagne, Romy Schneider. L’apparition de la vedette de Rocco enchante l’équipe du film, par son charisme, sa beauté et sa faconde. Son inscription, si jeune, si vite, dans l’histoire du cinéma, fascine. Encore un peu, il aurait presque éclipsé Romy Schneider, qui hérite ici d’un de ses premiers vrais rôles au cinéma, celui d’une femme tiraillée entre son époux, un fils de bourgeois membre d’un groupe d’extrême droite, et l’ami de ce dernier, hostile à cette violence.
Le réalisateur opte pour le poison
Le film fait de nombreuses allusions à l’OAS et à la guerre d’Algérie qui n’échappent à personne. Pas plus qu’il n’échappe pas à de nombreux spectateurs que la Romy Schneider de Cavalier n’a plus rien à voir avec celle qui a incarné l’impératrice Sissi d’Autriche dans trois films à succès – au point que certains réclament le remboursement de leur ticket à l’issue de la séance.
Ce soldat d’occasion, pour qui la lutte pour l’Algérie française n’a plus de sens, trouve
des résonances intimes chez l’acteur
Après Le Combat dans l’île, Alain Cavalier tient, avec L’Insoumis, à poursuivre son exploration de la guerre d’Algérie. C’est pour lui une histoire personnelle. Adolescent, il vit trois ans en Tunisie, où son père est un fonctionnaire du temps du protectorat. Rentré en France, et alors qu’il a terminé son service militaire, Alain Cavalier est rappelé pour combattre en Algérie. Une perspective insupportable pour cet opposant aux guerres coloniales. Se faire passer pour un déséquilibré afin de se faire réformer n’est pas une option – il n’a pas le talent nécessaire pour simuler la folie. Le futur réalisateur opte alors pour le poison lent d’une bouteille de cognac, avalée à jeun, juste avant de passer devant le conseil médical. Celui-ci ne pourra que constater les dommages inévitables causés à son estomac, perforé, nécessitant d’être recousu.
Alain Cavalier échappe à la conscription mais pas à l’ulcère. Il endure des souffrances insupportables dès qu’il commence à tourner L’Insoumis. La nuit, il ne dort pas. Il souffre. Sa force vitale, sa lucidité et sa présence au tournage s’en trouvent écornées, sans que personne autour de lui, à commencer par Delon, ne sache, ou ne mesure, le combat silencieux d’un réalisateur prêt à s’effondrer. Une lutte qui fait écho à celle du personnage incarné par Delon, malade comme un chien, qui va mourir pour avoir fait la guerre d’Algérie.
La censure gaulliste veille
Au-delà des deux films de Cavalier sur le sujet, le cinéma français, contrairement à une idée reçue, aborde avec persistance, et un évident courage, tant la censure gaulliste veille, la question de la guerre d’Algérie : parmi tant d’autres, citons Le Petit Soldat, de Jean-Luc Godard (réalisé en 1960, sorti en 1963) ; Adieu Philippine (1962), de Jacques Rozier ; La Belle vie (1963), de Robert Enrico ; Muriel ou le temps d’un retour (1964), d’Alain Resnais. La différence entre L’Insoumis et les films qui le précèdent réside, entre autres, dans la présence de la star Delon. La lutte anticoloniale ne trouve pas avec lui un porte-parole. En revanche, elle récupère un acteur inoubliable dans un film qui ne l’est pas moins.
« J’ai fait L’Insoumis, expliquait Alain Cavalier, parce que je voulais tourner un film avec Delon. J’ai parlé avec lui, il m’a raconté sa vie, cette période très incertaine qu’il a passée en Indochine pendant trois ans »
Delon interprète un jeune Luxembourgeois engagé dans la Légion étrangère pour combattre les « rebelles ». Devenu membre de l’OAS, il se trouve à la fois traqué pour avoir trahi ses amis (en refusant, en 1961, d’exécuter une avocate, dont il va tomber amoureux, venue à Alger plaider en faveur de deux Algériens), et poursuivi par la justice française pour désertion après le putsch manqué d’Alger.
Delon saisit évidemment les enjeux d’un film qui, deux ans après la signature des accords d’Evian en 1962, un an après le retour des pieds-noirs en France, s’aventure sur un sujet brûlant. Il aime ce rôle aussi parce qu’il affectionne au plus haut point les personnages ambigus, déchirés entre plusieurs vérités. Enfin l’acteur de Visconti comprend que ce film, écrit pour lui, deviendra un film sur lui. « J’ai fait L’Insoumis, expliquait Alain Cavalier, parce que je voulais tourner un film avec Delon. J’ai parlé avec lui, il m’a raconté sa vie, et le plus intéressant pour moi était cette période très incertaine qu’il a passée en Indochine pendant trois ans. Petit à petit, je me suis dit que le meilleur moyen d’approcher le comédien serait de profiter des circonstances mêmes de sa vie pour écrire une histoire qui tienne debout. »
Et c’est vrai que le personnage de Thomas Vlassenroot, l’insoumis, c’est Delon. Ce soldat d’occasion, pour qui la lutte pour l’Algérie française n’a plus de sens, trouve des résonances intimes chez l’acteur. Ce conflit le renvoie à la guerre coloniale livrée en Indochine. Engagé volontaire à 17 ans, Delon rejoint en 1953 la marine pour fuir l’ambiance familiale, la charcuterie où il était apprenti, et la banlieue parisienne exécrée. Le tout jeune homme veut s’engager dans l’aviation, mais il faut patienter six mois. La marine lui permet de partir tout de suite. Et il ne pouvait plus attendre. Mais sans doute aussi découvre-il en Indochine l’absurdité de la présence coloniale en Asie, ou ailleurs.
Mélancolie sourde
En fait, le sort réservé aux soldats perdus de la colonisation, Delon en a si peu parlé ! A l’exception d’un épisode, sur lequel Cavalier s’est d’évidence appuyé pour saisir la mélancolie sourde du protagoniste de L’Insoumis. En revenant d’Indochine, un avion dépose le soldat Delon sur la base de Villacoublay. Il suit l’un de ses camarades de régiment jusqu’à la place d’Italie, à Paris, où l’attend sa femme. Le couple s’enlace pour ses retrouvailles. En s’embrassant, il oublie la présence de Delon, puis le laisse seul dans la rue. Il s’en va avec juste un peu d’argent rapporté d’Indochine.
Delon porte la violence de ceux qui ont combattu dans une guerre infâme, trahi par son pays qui a brutalement tourné la page d’un combat douteux. De ce retour, Delon racontera : « J’étais un peu atteint. Un animal sauvage qui ne savait pas qui il était, ce qu’il allait retrouver, mais savait seulement d’où il revenait. Je n’avais pas eu peur de la mort, par inconscience peut-être, mais plutôt peur de la souffrance physique, de la maladie, de l’amputation. J’aurais préféré mourir que de revenir estropié, physiquement ou moralement. »
Les gestes de Delon racontent, aussi bien que ses rares paroles, son passage sous les drapeaux. Il se révèle magnifique quand il démonte et remonte un pistolet, avec une précision horlogère
Delon considère à l’époque L’Insoumis comme son plus beau rôle, au point de ne jamais chercher à discuter avec Cavalier sur les aspects fondamentaux du personnage. Il accepte de se couper les cheveux, très court, et de porter la même chemise et le même pantalon durant tout le film, sans les faire passer au lavage. Cette idée romantique d’un bourreau tombant amoureux de sa victime, au point de la sauver, l’idée encore d’un homme tenant seulement à retrouver sa maison, sa mère et sa petite fille, ne peut que séduire Delon. L’Insoumis n’est pas tant une œuvre politique qu’un film où la politique bouleverse le destin des individus. Delon devient un homme malmené par l’Histoire, cherchant à reprendre le cours de son existence. Un personnage tragique dont l’acteur saisit le potentiel dramatique.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Plein Soleil », naissance d’une étoile
Dans L’Insoumis, les gestes de Delon racontent, aussi bien que ses rares paroles, son passage sous les drapeaux. Il se révèle magnifique quand il démonte et remonte un pistolet, au milieu d’une conversation. Alors qu’on voit chez tant d’autres acteurs effectuant la même opération qu’ils ne comprennent rien à leurs gestes, Delon se révèle d’une précision horlogère. On croirait une sculpture en mouvement. C’est d’ailleurs ainsi que le filme le directeur de la photo de L’Insoumis, Claude Renoir, neveu de Jean Renoir, qui a travaillé sur la plupart des films de son oncle avant guerre, dont La Grande Illusion, le film préféré de Delon. Renoir comprend que, s’il éclaire l’acteur trop de face, son corps est mis en valeur, mais que son visage devient fade. Renoir et Cavalier essaient toujours de mettre une partie du visage dans l’ombre, pour le sculpter.
Il s’agit du seul ajustement habile et nécessaire pour parfaire l’équation Delon, tant l’acteur sait habiter le cadre, témoigne d’une intuition phénoménale de la caméra, devine quand il faut se mettre de dos, remplit l’espace avec intelligence. « Son déplacement dans le cadre, expliquait Alain Cavalier, était animal… et contrôlé. Il savait parfaitement la taille du plan, quand il sortait du champ, quand il y revenait, comment il s’inscrivait dans la profondeur. Il prenait possession de l’espace comme un animal qui chasse, qui attend ou qui aime. C’était d’autant plus fort que son personnage était traqué et toujours aux aguets. A tel point que j’avais l’impression de cadrer non pas une bête de scène, mais un vrai animal, avec ce corps parfaitement proportionné et sa constante justesse, digne de celle du cheval, qui ne peut être faux. »
Ce qui surprend, avec L’Insoumis, c’est la nature de la charge érotique dégagée par Delon. Là où Clément et Visconti, plus tard Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï (1967), filment Delon en femme, Alain Cavalier le regarde comme un homme. La fragilité du personnage, touché par une balle tirée par l’un de ses anciens complices, incapable de se soigner correctement alors qu’il quitte l’Algérie pour retrouver en France l’avocate dont il a sauvé la vie, y est pour beaucoup. L’image d’un Delon soignant sa blessure dans les toilettes d’un train, explorant minutieusement la plaie, restitue un acteur vivant, concret, réel, loin de toute image en papier glacé. Il devient un intense objet de désir.
Delon s’approprie le film pour le façonner à son image
Filmer Delon en action est, pour Cavalier, chose facile : l’acteur entre, il s’assoit, il mange et, très rapidement, traînant une blessure par balle, se meurt. Plus difficile est ce que le réalisateur cherche vraiment : non pas filmer Delon en déserteur de la guerre d’Algérie mais dresser un portrait de l’acteur. Et là, entre les deux, ce fut parfois facile, parfois douloureux. Un vrai combat de coqs. Un jour, devant tout le monde, Delon se met à hurler contre Cavalier. Par arrogance, liée à son statut de vedette, son rôle de producteur, son ego, son tempérament aussi, qui le rend un jour simple à diriger, et le lendemain plus difficile, le fait également qu’il commence à avoir des idées sur la mise en scène qu’il entend imposer à ce réalisateur naissant. « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? », demande Delon agacé. Cavalier rétorque : « Parce que je suis payé pour ça ! » Pétrifié par la repartie, Delon se tait. Ce qui le dérange, ce n’est pas tant que le metteur en scène l’observe, c’est ce qu’il pourrait déceler chez lui.
L’Insoumis baigne dans un univers que l’on identifiera plus facilement par la suite comme appartenant à Delon, Ce dernier s’approprie le film pour le façonner à son image. A un moment, il s’approche d’une cage avec des oiseaux et lance à l’avocate incarnée par Lea Massari « Si l’on m’avait attrapé, je serais le tueur aux oiseaux. » Impossible de ne pas songer au tueur à gages mutique qu’il incarnera trois ans plus tard dans Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville, couvant des yeux son bouvreuil à l’intérieur de sa cage. Et quand, à la fin de L’Insoumis, Delon retourne chez sa mère, au milieu de la nature, parmi les chevaux – une image qui rend hommage au dénouement de Quand la ville dort, de John Huston, où le truand incarné par Sterling Hayden, élevé parmi les chevaux, ressent le besoin de mourir au milieu d’eux –, on pense à l’homme Delon qui, dans la vraie vie, a besoin de rentrer chez lui, en Sologne, où il élève des chevaux.
Avec son tout premier cachet d’acteur, 400 000 francs anciens, tout l’or du monde pour celui qui, à 23 ans, était garçon de café et déchargeait des camions aux Halles, Delon achète un cheval, qui coûte alors moins cher qu’une voiture. Plus tard, il montera une écurie de chevaux de course. Et quand il devient collectionneur d’art, Delon accumule avec passion les toiles de Géricault, un peintre qui saisit merveilleusement la « plus noble conquête de l’homme », par exemple dans son Derby d’Epsom (1821), et qui meurt à 33 ans d’une chute de cheval – l’acteur trouvait des ressemblances entre son destin et celui du peintre.
L’Insoumis n’est pas encore dans les salles qu’Alain Delon vogue, en août 1964, en compagnie de sa femme, Nathalie Delon, enceinte, vers d’autres cieux. Aux Etats-Unis, où une carrière américaine l’attend. Lorsqu’il débarque à Hollywood, c’est avec une copie du film d’Alain Cavalier sous le bras. Il entend le montrer aux producteurs américains et à d’autres comédiens. Il ne s’agit pas de prouver son talent – c’est fait – mais de signifier son goût du secret, sa difficulté à dire qui il est pour laisser L’Insoumis l’exprimer à sa place.
Demi-échec de sa carrière américaine
Dès sa sortie, le 25 septembre 1964, L’Insoumis se retrouve sous les feux de la censure gaulliste. Au début du film, on entend crier : « Algérie française ! » Le ministère de l’information ordonne à Alain Cavalier de baisser le son afin de taire ce slogan. Puis c’est Mireille Glaymann, l’avocate enlevée en 1962 à Alger par un commando de l’OAS, et dont s’inspire le film pour le personnage incarné par Lea Massari, qui estime que le film porte atteinte tant à sa vie privée qu’à sa vie professionnelle. L’avocate vise surtout le moment où son personnage tombe amoureux de son ancien geôlier. Mireille Glaymann obtient l’interdiction de L’Insoumis, qui ressortira amputé d’une vingtaine de minutes.
Le film est un échec public. Pour Delon aussi. Son premier. L’acteur en sort blessé
Ce film dont il est si proche, qui dit tant de lui, presque personne n’en veut
Avec 700 000 entrées en France, le film est un lourd échec public. Pour Delon aussi. Son premier. L’acteur en sort blessé, le producteur qu’il est devenu aussi, en raison de l’argent investi et perdu. Ce film dont il est si proche, qui dit tant de lui, presque personne n’en veut. Des années plus tard, Alain Delon aperçoit Robert Castel à la générale d’un concert de Georges Brassens, à Bobino. Castel incarne dans le film le complice de Delon, un tueur de l’OAS qui inflige une blessure mortelle à son compagnon. « Alain m’aperçoit et hurle : « Amerio ! » C’était le nom de mon personnage », raconte Castel. Comme si Delon ne voulait pas s’extraire d’une aventure qui l’a si profondément marqué.
La carrière américaine de Delon sera un demi-échec. Trois films. Un polar, Les Tueurs de San Francisco (1965) de Ralph Nelson. Un western, Texas nous voilà (1966) de Michael Gordon. Et un film sur la guerre d’Algérie, un autre, Les Centurions (1966) de Mark Robson. Dans une Espagne franquiste que ce réalisateur tente péniblement de faire passer pour les montagnes d’Algérie, alors que la guerre du Vietnam commence à occuper les esprits, Delon incarne un ancien d’Indochine devenu le soldat d’une autre guerre coloniale dont il perçoit la forfaiture et l’injustice. L’acteur, on le sait, a de la suite dans les idées et des obsessions. Comme si, de cette guerre d’Algérie, Delon ne voulait renoncer à devenir le visage.
Robert Castel a été interviewé en juin. Les citations d’Alain Delon proviennent du livre Alain Delon, d’Henri Rode (éditions Pac, 1982) et de l’article « L’Enigme Delon », de Pierre Billard, publié dans Le Point du 1 février 1997. Les propos d’Alain Cavalier sont extraits d’entretiens aux Lettres françaises (30 septembre 1964), au Monde (27 septembre 1964) et à Télérama (24 septembre 2015).
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
En 1964, Alain Delon a beau se trouver au début de sa carrière d’acteur, il a d’emblée placé celle-ci à très haute altitude, entre films d’auteur et cinéma populaire. Il a tourné Plein soleil, de René Clément, Rocco et ses frères et Le Guépard de Luchino Visconti, L’Eclipse, de Michelangelo Antonioni. Mélodie en sous-sol, d’Henri Verneuil est un immense succès public, avec en prime la rencontre déterminante avec Jean Gabin. La filmographie est si dense que le patron de la Cinémathèque française, Henri Langlois, décide de consacrer une rétrospective à cet acteur qui n’a pas 30 ans, mais qui a déjà seize films à son actif.
Et maintenant ? Une seule certitude. Il entend diriger avec encore plus d’acuité le cours de sa carrière. L’acteur devient producteur et commence déjà à parler de lui à la troisième personne. « Il existe une marchandise Delon, explique-t-il, et je me suis dit : “Pourquoi moi, Delon, je ne l’exploiterais pas, cette marchandise ?” » Il entreprend pour cela, en compagnie de son imprésario, Georges Beaume, de créer sa maison de production, baptisée Delbeau, soit la première syllabe des deux noms de famille des fondateurs. Courtisé par Hollywood, s’apprêtant à lancer sa carrière américaine, Delon hérite de l’argent de la prestigieuse Metro-Goldwyn-Mayer qu’il va gérer, à sa guise.
Mais cet acteur ne fait décidément rien comme les autres. Delon accepte, fait nouveau pour lui, la proposition d’un réalisateur de sa génération, Alain Cavalier, 33 ans, et accepte de jouer et de produire son nouveau film, L’Insoumis. Cavalier se trouve au tout début d’une longue et prestigieuse carrière, où il va s’imposer comme l’une des voix les plus singulières du cinéma français – La Chamade (1968) ; Un étrange voyage (1980) ; Thérèse (1986) ; Le Filmeur (2005) ; Pater (2011). Quand il rencontre Delon, le réalisateur n’a qu’un film à son actif, Le Combat dans l’île, tourné deux ans plus tôt, en 1962.
Un film idéal pour lui
Delon pressent néanmoins que ce nouveau projet, qui prend pour toile de fond la guerre d’Algérie – très vivace dans les esprits –, est un film idéal pour lui. Le scénario est écrit par Cavalier avec le journaliste et romancier Jean Cau, ancien secrétaire de Sartre, grand reporter et essayiste, Prix Goncourt en 1961, bref en vogue, et qui n’a pas encore basculé de la gauche vers la droite.
Cavalier et Delon se rencontrent sur le plateau du Combat dans l’île. L’acteur rend visite à sa compagne, Romy Schneider. L’apparition de la vedette de Rocco enchante l’équipe du film, par son charisme, sa beauté et sa faconde. Son inscription, si jeune, si vite, dans l’histoire du cinéma, fascine. Encore un peu, il aurait presque éclipsé Romy Schneider, qui hérite ici d’un de ses premiers vrais rôles au cinéma, celui d’une femme tiraillée entre son époux, un fils de bourgeois membre d’un groupe d’extrême droite, et l’ami de ce dernier, hostile à cette violence.
Le réalisateur opte pour le poison
Le film fait de nombreuses allusions à l’OAS et à la guerre d’Algérie qui n’échappent à personne. Pas plus qu’il n’échappe pas à de nombreux spectateurs que la Romy Schneider de Cavalier n’a plus rien à voir avec celle qui a incarné l’impératrice Sissi d’Autriche dans trois films à succès – au point que certains réclament le remboursement de leur ticket à l’issue de la séance.
Ce soldat d’occasion, pour qui la lutte pour l’Algérie française n’a plus de sens, trouve
des résonances intimes chez l’acteur
Après Le Combat dans l’île, Alain Cavalier tient, avec L’Insoumis, à poursuivre son exploration de la guerre d’Algérie. C’est pour lui une histoire personnelle. Adolescent, il vit trois ans en Tunisie, où son père est un fonctionnaire du temps du protectorat. Rentré en France, et alors qu’il a terminé son service militaire, Alain Cavalier est rappelé pour combattre en Algérie. Une perspective insupportable pour cet opposant aux guerres coloniales. Se faire passer pour un déséquilibré afin de se faire réformer n’est pas une option – il n’a pas le talent nécessaire pour simuler la folie. Le futur réalisateur opte alors pour le poison lent d’une bouteille de cognac, avalée à jeun, juste avant de passer devant le conseil médical. Celui-ci ne pourra que constater les dommages inévitables causés à son estomac, perforé, nécessitant d’être recousu.
Alain Cavalier échappe à la conscription mais pas à l’ulcère. Il endure des souffrances insupportables dès qu’il commence à tourner L’Insoumis. La nuit, il ne dort pas. Il souffre. Sa force vitale, sa lucidité et sa présence au tournage s’en trouvent écornées, sans que personne autour de lui, à commencer par Delon, ne sache, ou ne mesure, le combat silencieux d’un réalisateur prêt à s’effondrer. Une lutte qui fait écho à celle du personnage incarné par Delon, malade comme un chien, qui va mourir pour avoir fait la guerre d’Algérie.
La censure gaulliste veille
Au-delà des deux films de Cavalier sur le sujet, le cinéma français, contrairement à une idée reçue, aborde avec persistance, et un évident courage, tant la censure gaulliste veille, la question de la guerre d’Algérie : parmi tant d’autres, citons Le Petit Soldat, de Jean-Luc Godard (réalisé en 1960, sorti en 1963) ; Adieu Philippine (1962), de Jacques Rozier ; La Belle vie (1963), de Robert Enrico ; Muriel ou le temps d’un retour (1964), d’Alain Resnais. La différence entre L’Insoumis et les films qui le précèdent réside, entre autres, dans la présence de la star Delon. La lutte anticoloniale ne trouve pas avec lui un porte-parole. En revanche, elle récupère un acteur inoubliable dans un film qui ne l’est pas moins.
« J’ai fait L’Insoumis, expliquait Alain Cavalier, parce que je voulais tourner un film avec Delon. J’ai parlé avec lui, il m’a raconté sa vie, cette période très incertaine qu’il a passée en Indochine pendant trois ans »
Delon interprète un jeune Luxembourgeois engagé dans la Légion étrangère pour combattre les « rebelles ». Devenu membre de l’OAS, il se trouve à la fois traqué pour avoir trahi ses amis (en refusant, en 1961, d’exécuter une avocate, dont il va tomber amoureux, venue à Alger plaider en faveur de deux Algériens), et poursuivi par la justice française pour désertion après le putsch manqué d’Alger.
Delon saisit évidemment les enjeux d’un film qui, deux ans après la signature des accords d’Evian en 1962, un an après le retour des pieds-noirs en France, s’aventure sur un sujet brûlant. Il aime ce rôle aussi parce qu’il affectionne au plus haut point les personnages ambigus, déchirés entre plusieurs vérités. Enfin l’acteur de Visconti comprend que ce film, écrit pour lui, deviendra un film sur lui. « J’ai fait L’Insoumis, expliquait Alain Cavalier, parce que je voulais tourner un film avec Delon. J’ai parlé avec lui, il m’a raconté sa vie, et le plus intéressant pour moi était cette période très incertaine qu’il a passée en Indochine pendant trois ans. Petit à petit, je me suis dit que le meilleur moyen d’approcher le comédien serait de profiter des circonstances mêmes de sa vie pour écrire une histoire qui tienne debout. »
Et c’est vrai que le personnage de Thomas Vlassenroot, l’insoumis, c’est Delon. Ce soldat d’occasion, pour qui la lutte pour l’Algérie française n’a plus de sens, trouve des résonances intimes chez l’acteur. Ce conflit le renvoie à la guerre coloniale livrée en Indochine. Engagé volontaire à 17 ans, Delon rejoint en 1953 la marine pour fuir l’ambiance familiale, la charcuterie où il était apprenti, et la banlieue parisienne exécrée. Le tout jeune homme veut s’engager dans l’aviation, mais il faut patienter six mois. La marine lui permet de partir tout de suite. Et il ne pouvait plus attendre. Mais sans doute aussi découvre-il en Indochine l’absurdité de la présence coloniale en Asie, ou ailleurs.
Mélancolie sourde
En fait, le sort réservé aux soldats perdus de la colonisation, Delon en a si peu parlé ! A l’exception d’un épisode, sur lequel Cavalier s’est d’évidence appuyé pour saisir la mélancolie sourde du protagoniste de L’Insoumis. En revenant d’Indochine, un avion dépose le soldat Delon sur la base de Villacoublay. Il suit l’un de ses camarades de régiment jusqu’à la place d’Italie, à Paris, où l’attend sa femme. Le couple s’enlace pour ses retrouvailles. En s’embrassant, il oublie la présence de Delon, puis le laisse seul dans la rue. Il s’en va avec juste un peu d’argent rapporté d’Indochine.
Delon porte la violence de ceux qui ont combattu dans une guerre infâme, trahi par son pays qui a brutalement tourné la page d’un combat douteux. De ce retour, Delon racontera : « J’étais un peu atteint. Un animal sauvage qui ne savait pas qui il était, ce qu’il allait retrouver, mais savait seulement d’où il revenait. Je n’avais pas eu peur de la mort, par inconscience peut-être, mais plutôt peur de la souffrance physique, de la maladie, de l’amputation. J’aurais préféré mourir que de revenir estropié, physiquement ou moralement. »
Les gestes de Delon racontent, aussi bien que ses rares paroles, son passage sous les drapeaux. Il se révèle magnifique quand il démonte et remonte un pistolet, avec une précision horlogère
Delon considère à l’époque L’Insoumis comme son plus beau rôle, au point de ne jamais chercher à discuter avec Cavalier sur les aspects fondamentaux du personnage. Il accepte de se couper les cheveux, très court, et de porter la même chemise et le même pantalon durant tout le film, sans les faire passer au lavage. Cette idée romantique d’un bourreau tombant amoureux de sa victime, au point de la sauver, l’idée encore d’un homme tenant seulement à retrouver sa maison, sa mère et sa petite fille, ne peut que séduire Delon. L’Insoumis n’est pas tant une œuvre politique qu’un film où la politique bouleverse le destin des individus. Delon devient un homme malmené par l’Histoire, cherchant à reprendre le cours de son existence. Un personnage tragique dont l’acteur saisit le potentiel dramatique.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Plein Soleil », naissance d’une étoile
Dans L’Insoumis, les gestes de Delon racontent, aussi bien que ses rares paroles, son passage sous les drapeaux. Il se révèle magnifique quand il démonte et remonte un pistolet, au milieu d’une conversation. Alors qu’on voit chez tant d’autres acteurs effectuant la même opération qu’ils ne comprennent rien à leurs gestes, Delon se révèle d’une précision horlogère. On croirait une sculpture en mouvement. C’est d’ailleurs ainsi que le filme le directeur de la photo de L’Insoumis, Claude Renoir, neveu de Jean Renoir, qui a travaillé sur la plupart des films de son oncle avant guerre, dont La Grande Illusion, le film préféré de Delon. Renoir comprend que, s’il éclaire l’acteur trop de face, son corps est mis en valeur, mais que son visage devient fade. Renoir et Cavalier essaient toujours de mettre une partie du visage dans l’ombre, pour le sculpter.
Il s’agit du seul ajustement habile et nécessaire pour parfaire l’équation Delon, tant l’acteur sait habiter le cadre, témoigne d’une intuition phénoménale de la caméra, devine quand il faut se mettre de dos, remplit l’espace avec intelligence. « Son déplacement dans le cadre, expliquait Alain Cavalier, était animal… et contrôlé. Il savait parfaitement la taille du plan, quand il sortait du champ, quand il y revenait, comment il s’inscrivait dans la profondeur. Il prenait possession de l’espace comme un animal qui chasse, qui attend ou qui aime. C’était d’autant plus fort que son personnage était traqué et toujours aux aguets. A tel point que j’avais l’impression de cadrer non pas une bête de scène, mais un vrai animal, avec ce corps parfaitement proportionné et sa constante justesse, digne de celle du cheval, qui ne peut être faux. »
Ce qui surprend, avec L’Insoumis, c’est la nature de la charge érotique dégagée par Delon. Là où Clément et Visconti, plus tard Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï (1967), filment Delon en femme, Alain Cavalier le regarde comme un homme. La fragilité du personnage, touché par une balle tirée par l’un de ses anciens complices, incapable de se soigner correctement alors qu’il quitte l’Algérie pour retrouver en France l’avocate dont il a sauvé la vie, y est pour beaucoup. L’image d’un Delon soignant sa blessure dans les toilettes d’un train, explorant minutieusement la plaie, restitue un acteur vivant, concret, réel, loin de toute image en papier glacé. Il devient un intense objet de désir.
Delon s’approprie le film pour le façonner à son image
Filmer Delon en action est, pour Cavalier, chose facile : l’acteur entre, il s’assoit, il mange et, très rapidement, traînant une blessure par balle, se meurt. Plus difficile est ce que le réalisateur cherche vraiment : non pas filmer Delon en déserteur de la guerre d’Algérie mais dresser un portrait de l’acteur. Et là, entre les deux, ce fut parfois facile, parfois douloureux. Un vrai combat de coqs. Un jour, devant tout le monde, Delon se met à hurler contre Cavalier. Par arrogance, liée à son statut de vedette, son rôle de producteur, son ego, son tempérament aussi, qui le rend un jour simple à diriger, et le lendemain plus difficile, le fait également qu’il commence à avoir des idées sur la mise en scène qu’il entend imposer à ce réalisateur naissant. « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? », demande Delon agacé. Cavalier rétorque : « Parce que je suis payé pour ça ! » Pétrifié par la repartie, Delon se tait. Ce qui le dérange, ce n’est pas tant que le metteur en scène l’observe, c’est ce qu’il pourrait déceler chez lui.
L’Insoumis baigne dans un univers que l’on identifiera plus facilement par la suite comme appartenant à Delon, Ce dernier s’approprie le film pour le façonner à son image. A un moment, il s’approche d’une cage avec des oiseaux et lance à l’avocate incarnée par Lea Massari « Si l’on m’avait attrapé, je serais le tueur aux oiseaux. » Impossible de ne pas songer au tueur à gages mutique qu’il incarnera trois ans plus tard dans Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville, couvant des yeux son bouvreuil à l’intérieur de sa cage. Et quand, à la fin de L’Insoumis, Delon retourne chez sa mère, au milieu de la nature, parmi les chevaux – une image qui rend hommage au dénouement de Quand la ville dort, de John Huston, où le truand incarné par Sterling Hayden, élevé parmi les chevaux, ressent le besoin de mourir au milieu d’eux –, on pense à l’homme Delon qui, dans la vraie vie, a besoin de rentrer chez lui, en Sologne, où il élève des chevaux.
Avec son tout premier cachet d’acteur, 400 000 francs anciens, tout l’or du monde pour celui qui, à 23 ans, était garçon de café et déchargeait des camions aux Halles, Delon achète un cheval, qui coûte alors moins cher qu’une voiture. Plus tard, il montera une écurie de chevaux de course. Et quand il devient collectionneur d’art, Delon accumule avec passion les toiles de Géricault, un peintre qui saisit merveilleusement la « plus noble conquête de l’homme », par exemple dans son Derby d’Epsom (1821), et qui meurt à 33 ans d’une chute de cheval – l’acteur trouvait des ressemblances entre son destin et celui du peintre.
L’Insoumis n’est pas encore dans les salles qu’Alain Delon vogue, en août 1964, en compagnie de sa femme, Nathalie Delon, enceinte, vers d’autres cieux. Aux Etats-Unis, où une carrière américaine l’attend. Lorsqu’il débarque à Hollywood, c’est avec une copie du film d’Alain Cavalier sous le bras. Il entend le montrer aux producteurs américains et à d’autres comédiens. Il ne s’agit pas de prouver son talent – c’est fait – mais de signifier son goût du secret, sa difficulté à dire qui il est pour laisser L’Insoumis l’exprimer à sa place.
Demi-échec de sa carrière américaine
Dès sa sortie, le 25 septembre 1964, L’Insoumis se retrouve sous les feux de la censure gaulliste. Au début du film, on entend crier : « Algérie française ! » Le ministère de l’information ordonne à Alain Cavalier de baisser le son afin de taire ce slogan. Puis c’est Mireille Glaymann, l’avocate enlevée en 1962 à Alger par un commando de l’OAS, et dont s’inspire le film pour le personnage incarné par Lea Massari, qui estime que le film porte atteinte tant à sa vie privée qu’à sa vie professionnelle. L’avocate vise surtout le moment où son personnage tombe amoureux de son ancien geôlier. Mireille Glaymann obtient l’interdiction de L’Insoumis, qui ressortira amputé d’une vingtaine de minutes.
Le film est un échec public. Pour Delon aussi. Son premier. L’acteur en sort blessé
Ce film dont il est si proche, qui dit tant de lui, presque personne n’en veut
Avec 700 000 entrées en France, le film est un lourd échec public. Pour Delon aussi. Son premier. L’acteur en sort blessé, le producteur qu’il est devenu aussi, en raison de l’argent investi et perdu. Ce film dont il est si proche, qui dit tant de lui, presque personne n’en veut. Des années plus tard, Alain Delon aperçoit Robert Castel à la générale d’un concert de Georges Brassens, à Bobino. Castel incarne dans le film le complice de Delon, un tueur de l’OAS qui inflige une blessure mortelle à son compagnon. « Alain m’aperçoit et hurle : « Amerio ! » C’était le nom de mon personnage », raconte Castel. Comme si Delon ne voulait pas s’extraire d’une aventure qui l’a si profondément marqué.
La carrière américaine de Delon sera un demi-échec. Trois films. Un polar, Les Tueurs de San Francisco (1965) de Ralph Nelson. Un western, Texas nous voilà (1966) de Michael Gordon. Et un film sur la guerre d’Algérie, un autre, Les Centurions (1966) de Mark Robson. Dans une Espagne franquiste que ce réalisateur tente péniblement de faire passer pour les montagnes d’Algérie, alors que la guerre du Vietnam commence à occuper les esprits, Delon incarne un ancien d’Indochine devenu le soldat d’une autre guerre coloniale dont il perçoit la forfaiture et l’injustice. L’acteur, on le sait, a de la suite dans les idées et des obsessions. Comme si, de cette guerre d’Algérie, Delon ne voulait renoncer à devenir le visage.
Robert Castel a été interviewé en juin. Les citations d’Alain Delon proviennent du livre Alain Delon, d’Henri Rode (éditions Pac, 1982) et de l’article « L’Enigme Delon », de Pierre Billard, publié dans Le Point du 1 février 1997. Les propos d’Alain Cavalier sont extraits d’entretiens aux Lettres françaises (30 septembre 1964), au Monde (27 septembre 1964) et à Télérama (24 septembre 2015).
Alain Delon en six films-cultes : la série du « Monde »
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
Surtout que là l'histoire n'a même pas l'air de coller au comics spécialement...
J'ai eu le malheur de voir Dumbo par nostalgie, aie aie aie 
Même pour un gosse ça me semble pété, les 20 premières minutes sont d'un chiant abyssal
Et putain ce qu'ils ont fait à la scène mythique des éléphants roses
Je souhaite du sale à l'empire Disney-Marvel-Lucas
Même pour un gosse ça me semble pété, les 20 premières minutes sont d'un chiant abyssal
Et putain ce qu'ils ont fait à la scène mythique des éléphants roses
Je souhaite du sale à l'empire Disney-Marvel-Lucas
Des avis sur la nouvelle bombe suédoise the unthinkable? Le film est sorti sur le net incognito, il se tape des supers critiques.
Todd Phillips en réal, ça fait pas trop envie.
Joaquin Phoenix, par contre.
Joaquin Phoenix, par contre.
La carriere de Phoenix est un quasi sans-faute (l'exception a mes yeux etant les 2 Shyamalan qui sont assez mauvais), pleine confiance en lui pour choisir ses projets et faire des masterclass
Des avis sur la nouvelle bombe suédoise the unthinkable? Le film est sorti sur le net incognito, il se tape des supers critiques.
C’est vraiment très bon, vu au PIFFF l’an dernier.
La scène des helicos et celle du pont notamment
Assez impressionnant vu le budget.
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
C'était la grande force du Joker version Heath Ledger effectivement, au-delà de l'interprétation en elle-même. Surtout que le film jouait constamment sur ce flou avec les histoires différentes racontées sur les cicatrices. On ne connaissait ni son passé ni ses intentions et c'est ce qui faisait toute sa dangerosité.
Pour autant je pense qu'une origin story du Joker peut aussi avoir son intérêt. C'est un point de vue et une ambition complètement opposés à la version Nolan, mais en soit c'est aussi ce qui rend le projet intriguant et casse-gueule à la fois.
Je n'ai pas non plus une grande confiance en Todd Philips, mais c'est quand même assez couillu de se lancer dans un tel projet. S'il se foire, il va prendre cher.
https://twitter.com/FuckCinephiles/status/1113735685100335104
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Cette affiche
"Par le réalisateur de Mission Impossible"
J'hésite entre le et le
et le 
J'hésite entre le
Je l’attends quand même mais le trailer fait peur et les conditions de tournage ne rassurent pas des masses.
De Palma ne nous a pas fait un truc potable depuis 1996 avec son Mission Impossible, le meilleur de la sage d'ailleurs.
Et la BA est dégueulasse, les échos aussi...
Et la BA est dégueulasse, les échos aussi...
https://twitter.com/FuckCinephiles/status/1113735685100335104
— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011
Plus qu'un poil déçu perso. Je suis resté complètement extérieur au délire même.
Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais juste que c'est raté.
Je comprends ce que Jordan Peele a voulu faire en terme sous-texte politico-complotiste, et ça aurait pu être cool. Mais sur la forme je n'ai pas du tout aimé. Déjà à cause du ton qui oscille entre suspens/horreur, ni vraiment stressant ni vraiment flippant, et phases comiques qui désamorcent l'ambiance plus qu'autre chose. Et aussi juste parce que la métaphore apporte au moins autant d'invraisemblances sur le premier degré de lecture qu'elle donne de la profondeur au propos. Et venant de Jordan Peele qui avait écrit un scénar suffisamment malin dans Get Out pour obtenir un Oscar, c'est plutôt décevant de voir quelque chose d'aussi mal ficelé.
Reste que c'est joliment mis en scène et que Lupita Nyong'o joue bien (x2).
Le travail sonore est bon aussi. Et la version retravaillée du sample de "I Got 5 On It" très cool.
Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais juste que c'est raté.
Je comprends ce que Jordan Peele a voulu faire en terme sous-texte politico-complotiste, et ça aurait pu être cool. Mais sur la forme je n'ai pas du tout aimé. Déjà à cause du ton qui oscille entre suspens/horreur, ni vraiment stressant ni vraiment flippant, et phases comiques qui désamorcent l'ambiance plus qu'autre chose. Et aussi juste parce que la métaphore apporte au moins autant d'invraisemblances sur le premier degré de lecture qu'elle donne de la profondeur au propos. Et venant de Jordan Peele qui avait écrit un scénar suffisamment malin dans Get Out pour obtenir un Oscar, c'est plutôt décevant de voir quelque chose d'aussi mal ficelé.
Reste que c'est joliment mis en scène et que Lupita Nyong'o joue bien (x2).
Le travail sonore est bon aussi. Et la version retravaillée du sample de "I Got 5 On It" très cool.
Vu hier et je suis globalement d'accord. En gros y'a de la qualité sur la forme (et encore, l'humour vient limite gâcher les très bonnes scènes de tensions/horreur), mais le fond...
Le final remet en question pas mal de choses aussi et y'a des soucis de cohérence. L'impression d'un potentiel gâché, c'est dommage.
Difficile de dire si le film sera bon (le traitement peut vite virer au cliché), mais ce premier teaser donne quand même bien envie.
Malgré Joaquin Phoenix ça me donne pas du tout envie perso
À la base je suis pas fan des histoires "origins" sur les personnages qui incarnent le mal absolu : Joker, Michael Myers, Leatherface...
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
Même chose pour Anton Chigurh dans No country for old man.
étudier la trajectoire d'un "villain" ça marche quand on parle d'un type qui bascule dans la criminalité tout en gardant une part d'humanité ou d'empathie, type Walter White, mais pour les cas cités plus haut je trouve que ça fonctionne pas.
Même si je comprends la logique commerciale, ça désamorce tellement le côté horrifique du personnage ; le Joker de Nolan était fascinant car d'une part magnifiquement interprété, et d'autre part parce que son passé était flou.
Même chose pour Anton Chigurh dans No country for old man.
étudier la trajectoire d'un "villain" ça marche quand on parle d'un type qui bascule dans la criminalité tout en gardant une part d'humanité ou d'empathie, type Walter White, mais pour les cas cités plus haut je trouve que ça fonctionne pas.
Si je dis pas de bêtise, une des forces de ce personnage est qu'il n'a pas d'origine claire justement donc choisir de lui en donner une c'est forcément risqué.
Tout ça pour avoir droit à un nouveau Joker dans quelques années dans l'univers ciné DC...
J'avais pas lu qu'ils avaint annoncé Zombieland Double Tap 
La 1ere scène
Non, c'est J J Abrams, ça sera un bon divertissement.
Pas du grand cinéma mais ça fera plaisir à certains : http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/...ar-Les-Inconnus
Je te remercie le premier
Sympa à lire
Sympa à lire
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
