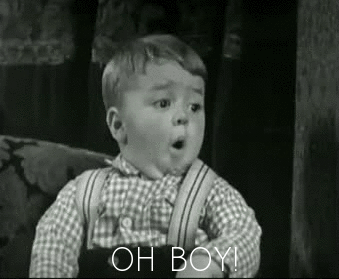Monde Diplomatique, Septembre 2018
Bénéfices en hausse, résultats en baissePrivatisation de l’école, le fiasco suédoisAu cours de la campagne pour les élections générales qui se tiennent en Suède le 9 septembre, la poussée attendue de la droite xénophobe a occulté le débat sur l’avenir des services publics. À la tête d’un gouvernement minoritaire depuis quatre ans, les sociaux-démocrates n’ont même pas réussi à plafonner les profits des entreprises privées qui ont investi la santé ou l’éducation, au détriment de la qualité des services et de la réussite des élèves.C’est une école “deux en une” », résume Mme Elsa Heuyer. Cette professeure de français du lycée Drottning Blanka a dû apprendre à « optimiser » le temps et l’espace au bénéfice d’AcadeMedia, l’« entreprise éducative » cotée en Bourse qui l’emploie à temps (très) partiel : 28,7 %. Situé au sud de Stockholm, son lycée, un établissement privé sous contrat, dit friskola (friskolor au pluriel), partage ses locaux avec un autre du même groupe. Rentabilité oblige, Mme Heuyer doit gérer deux niveaux dans la même classe : « En pratique, je suis obligée de diviser le temps de cours par deux. »
Exerçant, eux, à temps plein, ses collègues professeurs d’espagnol, Mme Sandra Nylen et M. Adrian Reyes, enseignent également une autre matière — un fait commun en Suède. Ils assurent en outre un tutorat pour une quinzaine d’élèves chacun, jouant le rôle de ce qu’on appelle en suédois un mentor. Par courriel ou par téléphone, ils doivent maintenir un contact permanent avec les parents pour le suivi des absences et de la scolarité, toutes matières confondues. « Lorsqu’un élève rencontre des difficultés, c’est de la faute du mentor », soupire M. Reyes. Il n’est ainsi pas rare de voir un professeur aider un élève à faire remonter ses notes dans une autre matière que celles qu’il enseigne. « Je m’assure sans cesse auprès de mes élèves que tout va bien, car je sais que mon directeur va me demander des comptes, raconte Mme Nylen avec nervosité. Mais que faire lorsqu’ils échouent dans plusieurs matières ? »
Le directeur du lycée Drottning Blanka « demande des comptes » parce qu’il lui faut de bons résultats pour conserver ses élèves ou en attirer davantage. Après le retour au pouvoir des « partis bourgeois », en 1991, le premier ministre du Parti modéré, M. Carl Bildt, instaura le système des « chèques éducation ». Depuis, il n’y a plus de carte scolaire, et chaque famille peut inscrire gratuitement ses enfants dans l’école publique ou privée de son choix. Lorsqu’elle opte pour le privé, la municipalité doit octroyer à l’établissement un chèque, ou voucher, du même montant que ce qui est dépensé pour un élève du secteur public dans la même commune (un élève inscrit au collège à Stockholm, par exemple, coûte 10 000 euros par an). Résultat : quasi inexistants dans les années 1990, les collèges privés sous contrat représentaient en 2017 près de 20 % des effectifs des collèges suédois (1).
La recherche de la « satisfaction client » pousse à une inflation de bonnes notes, facilitée par le fait que les examens nationaux sont souvent corrigés par des professeurs du même établissement que les élèves. L’école revalorise d’autant plus volontiers les bulletins pour soigner son image que parents et enfants peuvent obliger le professeur à revoir sa copie. « C’est à la carte », lance Mme Heuyer, qui, fin juin, dispense des cours supplémentaires pour « corriger » les notes d’élèves mécontents de leur évaluation. Beaucoup d’enseignants préfèrent valider leur passage dans la classe supérieure plutôt que de les noter en dessous de la moyenne et engendrer un sentiment d’échec, mais aussi un surcroît de travail et de stress.
Ainsi, de nombreux élèves, parents et décideurs politiques entretiennent une illusion de réussite, alors que le pays dégringole dans les évaluations internationales. Au dernier classement PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), en 2015 (2), la Suède reste dans la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; mais elle n’occupe plus les meilleures places comme dans le premier classement, en 2000, et enregistre un net recul en sciences et en mathématiques. En outre, consacrant plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB) à l’éducation, elle est devenue le pays d’Europe le plus dépensier dans ce domaine (3). L’écart se creuse entre les élèves les plus performants et les autres, en particulier ceux issus de l’immigration. Paradoxalement, les élèves continuent à affluer dans le privé, même si, à profil socio-économique équivalent, les résultats sont meilleurs dans le public (comme dans la plupart des pays occidentaux). En effet, comme les écoles privées attirent moins de jeunes des classes les plus défavorisées, leurs résultats apparaissent globalement meilleurs.
« La relation devient celle d’un client et d’un prestataire »La concurrence du privé influence fortement le système public, d’autant qu’elle s’ajoute à une réforme pédagogique commune d’individualisation des apprentissages qui laisse plus de liberté aux élèves — et défavorise ceux des familles les plus modestes. « La relation entre l’élève et le professeur devient celle d’un client et d’un prestataire », constate M. Henrik Wall, professeur d’histoire et société au collège public de Skarpnäck, dans la banlieue sud de Stockholm. Ses trois collègues et lui, réunis en « équipe de travail », gèrent les quelque soixante-dix élèves de sixième. Chaque semaine se tient un « conseil d’élèves » afin de recueillir les suggestions des intéressés. Assis à la table de réunion dans la salle des professeurs, M. Wall écoute Mme Ida Sjödin, qui enseigne les mathématiques, énumérer leurs dernières revendications : « Ils veulent pouvoir aller aux toilettes, porter leurs casquettes, mâcher du chewing-gum en classe et utiliser leurs portables. » Mme Sophia Berglin, professeure de biologie, intervient : « Moi, la casquette ne me dérange pas. » Une discussion s’ensuit. « On accepte la casquette et on garde l’interdiction du portable ? », propose Mme Sjödin.
M. Wall dit envier la France, ce « pays civilisé où, paraît-il, les profs n’ont qu’à préparer et donner leurs cours et à noter les devoirs ». Ici, en plus de surveiller la récréation et la cantine, l’équipe enseignante organise une foule d’activités : examens, journées d’intégration, sorties sportives, emplois du temps et informations générales grâce au blog de l’équipe de travail. Elle se retrouve chaque semaine pour une rencontre, baptisée « apprentissage collégial », autour de sujets pédagogiques. L’ensemble des professeurs du collège sont tenus de produire des « documents de réflexion » et de mener des enquêtes sur l’environnement de travail pour la direction.
Calquant leurs méthodes sur celles des friskolor, les professeurs du public se doivent de fournir un accompagnement individualisé, tout en veillant à la dynamique de groupe. Et ils doivent accomplir cet exercice d’équilibrisme sans élever la voix, sous peine de paraître autoritaires et d’être signalés comme tels. Dans la classe de mathématiques de Mme Sjödin, la porte reste grande ouverte, et les élèves ont le droit d’écouter de la musique tout en faisant leurs exercices. « Cela m’aide à me concentrer », explique Kevin au milieu du va-et-vient de ses camarades partis à la recherche d’un crayon ou d’une gomme, à leur disposition dans les classes. Certains préfèrent travailler à deux ; ils s’entraident et parlent à haute voix. Pour ceux qui ont besoin de silence, comme Märta, des casques antibruit sont disponibles.
Une adolescente préférant l’école buissonnière est invitée par sa mentor à boire un chocolat chaud. Mme Berglin communique ensuite à ses collègues un emploi du temps personnalisé, même si la jeune fille n’a pris aucun engagement à le suivre... De même, un perturbateur est accueilli chez la psychologue scolaire avec des petits gâteaux. Tout est fait pour éviter le conflit et pour maintenir une relation « symétrique » avec l’élève, note M. Wall. L’objectif est de favoriser la discussion et la négociation, au risque de permettre des abus de pouvoir de la part des adolescents. En 2017, l’Office suédois de l’environnement du travail a reçu 767 signalements de menaces et de violence dans les écoles, collèges et lycées, soit deux fois plus qu’en 2012. Cette violence touche particulièrement les enseignantes (4).
Au collège public de Skarpnäck, le malaise se traduit par un fort absentéisme : chaque jour, il manque en moyenne près de 10 % des professeurs. Lorsqu’ils ne sont pas remplacés par des intérimaires d’une entreprise privée, leurs collègues présents supervisent leurs classes, voire dispensent des cours supplémentaires dans des matières qui ne sont pas les leurs, au titre de la « coopération » et de la « flexibilité ». Mme Erika Frimodig, professeure de sport et déléguée syndicale, confie ainsi avoir enseigné le français aux sixièmes débutants, et ce pendant deux ans : « J’ai des notions de français, ma fille habite à Paris », explique-t-elle sur le ton de l’évidence.
Pour cette rentrée 2018, un amendement au programme général impose l’apprentissage par des moyens numériques. L’équipement informatique devient obligatoire, et sa qualité constitue un argument pour attirer les élèves. Quand le lycée Drottning Blanka fournit des MacBook Air à ses élèves et à ses professeurs, le collège public de Skarpnäck achète des centaines d’iPad et organise des conférences d’intervenants extérieurs incitant à l’usage du numérique en classe. Toutefois, en dépit de la pléthore d’outils dont ils disposent sur leur plate-forme, les enseignants du lycée Drottning Blanka distribuent encore photocopies et crayons : « Les élèves n’aiment pas lire sur écran », explique Mme Heuyer, consternée par l’extrême dépendance à l’informatique. Mme Nylen renchérit : « Jeudi dernier, on a eu une panne d’Internet. Plusieurs élèves m’ont demandé si le cours était annulé… »
L’un des acteurs-clés de ce marché, le groupe Kunskapsskolan (« école du savoir » en suédois), revendique treize mille élèves. Le numérique figure parmi ses « six compétences du futur », peut-on lire sur son site Internet ; il propose une méthode normalisée d’enseignement en ligne, baptisée Kunskapsskolan Education (KED), qui fait de l’élève « l’acteur de son apprentissage ». Le collège d’Enskede, à deux pas de celui de Skarpnäck, est son établissement vitrine. Dans les locaux d’une ancienne entreprise, près de cinq cents élèves s’entassent sur deux étages seulement compartimentés par des murs de verre. En guise de cour, l’établissement loue un terrain de football municipal.
Construits à l’âge d’or de l’école suédoise, les deux bâtiments du collège public de Skarpnäck, qui accueillent un millier d’élèves, contrastent par leur confort. Exposés au sud pour mieux capter la lumière, ils abritent deux gymnases intérieurs et comprennent deux cours avec terrains de basket. À proximité d’un terrain de football se trouve la cantine, avec, à l’étage, une bibliothèque scolaire.
Des élèves privés de bibliothèque… et même de livresLes élèves de Kunskapsskolan se passent de bibliothèque. D’ailleurs, ils se passent aussi de livres ! À la suite des réclamations de certains parents, ils disposent toutefois d’une licence de livres en ligne pour la biologie ; c’est tout. Pierre angulaire de leur organisation, l’agenda sur papier des élèves va bientôt être abandonné, au grand désespoir des professeurs. Mais, pour Kunskapsskolan, « les générations futures doivent être préparées à un monde en développement constant et être capables de s’adapter à ce marché du travail imprévisible », comme le clame une vidéo promotionnelle.
Chaque semaine, l’élève de Kunskapsskolan élabore son propre emploi du temps, selon son rythme et ses besoins. Il va et vient aux ateliers, où, penché sur son ordinateur portable, il passe des étapes sur le contenu en ligne qu’il fait valider par le professeur présent. Une rencontre hebdomadaire de quinze minutes avec son mentor permet de mettre en place des plans d’action. Installée dans la cafétéria, qui sert de salle de cours, Mme Stéphanie Arseneau-Bussières, professeure d’anglais et de français, revendique une « familiarité » avec ses élèves. Comme le précise un film promotionnel, tout employé de Kunskapsskolan doit être à la fois « mentor, facilitateur, accompagnateur personnel, expert dans une matière, ami et guide ».
Directrice générale du groupe fondé par son père en 1999, Mme Cecilia Carnefeldt porte aux nues le système Kunskapsskolan, qui, dit-elle, favorise l’autonomie des élèves et nécessite moins de professeurs. Certes, son pays a chuté dans le classement PISA, mais, selon elle, ce dernier « n’est pas une référence », notamment parce qu’il omet de prendre en compte « la créativité et le travail en équipe ». Pourtant, elle-même a inscrit ses enfants à l’école du château de Fredrikshov, qui dit appliquer une méthode d’enseignement des mathématiques venue de Singapour, pays arrivé en tête du classement PISA 2015. Elle défend le principe des profits réalisés par une structure privée sur la base de fonds publics : « Il y a beaucoup de fournisseurs privés en affaire avec l’État, plaide-t-elle. Certains produisent des meubles, d’autres des livres… Si vous êtes sérieux, dans n’importe quelle industrie, vous avez besoin d’être rentable. Enregistrer des pertes ne serait pas bon pour les clients — si je peux utiliser ce mot pour parler des élèves. » Les bénéfices de Kunskapsskolan sont pour l’heure investis pour permettre son expansion au-delà des frontières suédoises (lire l’article ci-dessous).
Une mission complexe comme l’éducation ne peut pas être considérée comme une industrie, réplique Samuel E. Abrams, directeur du Centre national d’étude de la privatisation de l’éducation à l’université Columbia, aux États-Unis : « Ceux qui dégagent des profits dans ce secteur ont la motivation implicite de contrevenir aux intérêts des citoyens. Les parents, les contribuables, les législateurs ne peuvent pas savoir si les élèves apprennent ce qu’ils doivent apprendre. La probabilité qu’il se produise des malversations augmente quand il y a la possibilité de faire des profits. »
Le métier d’enseignant ne séduit plusDes études récentes démontrent que les friskolor attirent davantage les familles les plus aisées. « Les nouveaux arrivants, les personnes de milieux défavorisés ne viennent pas chez nous, confirme Mme Arsenau-Bussières. Nous avons cinq cents élèves sur liste d’attente, et leur inscription est le fait de parents qui connaissent le système. » Chercheur indépendant travaillant sur la non mixité générée par ce mode d’organisation de l’éducation, Per Kornhall ajoute : « Lorsque vous venez de vous installer dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, vous n’avez pas accès aux bonnes informations. Les inscriptions se font par imitation des amis, des voisins… » Pour pallier ce manque d’information, sur le site de la ville de Stockholm, un comparateur affiche désormais une liste des écoles selon des critères tels que les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des élèves, le nombre d’élèves par enseignant ou le pourcentage de professeurs certifiés.
D’anciens partisans de la réforme reconnaissent leur erreur : « Nous avons sous-estimé la force du pouvoir économique, admet Mme Åsa Fahlén, présidente du syndicat de professeurs Lärarnas Riksförbund. Il y a eu de la naïveté dans la société suédoise. » Elle nous reçoit au siège du syndicat, situé en face de la tombe d’Olof Palme, premier ministre assassiné en 1986 et incarnation du socialisme à la suédoise de jadis : travailliste, tiers- mondiste, féministe et favorable à un État fort. Elle reconnaît le rôle joué par les deux principaux syndicats — Lärarnas Riksförbund et Lärarförbundet — dans l’adoption des réformes : « Nous étions favorables à ce qu’il y ait des écoles privées avec divers types de pédagogie, admet-elle en souriant. Cela devait augmenter le pluralisme, la diversité, et favoriser une concurrence bénéfique pour les salaires. Mais c’est l’inverse qui s’est produit. »
Pour Emil Bertilsson (5), professeur de sciences de l’éducation à l’université d’Uppsala, « les syndicats ont contribué à la dégradation du statut des professeurs ». « Ils passent davantage de temps à écrire des rapports qu’à faire cours, explique sa collègue Shirin Ahlbäck Öberg, enseignante-chercheuse en administration publique. On a privé leur métier de tout ce qui faisait son attractivité. » En moyenne, ils consacreraient seulement un tiers de leur temps à la préparation et à la dispense de leurs cours (6), contre la moitié en France (7).
L’essentiel des tâches administratives vise à montrer des résultats à la commune de rattachement de l’école. « Le Parlement a tenté d’encadrer ces tâches chronophages, mais les communes continuent de commander des rapports d’activité et de résultat, raconte Ahlbäck Öberg. Il faudrait que les 290 communes se mettent toutes d’accord pour laisser les professeurs travailler en paix, ce qui est très difficile. » Ainsi privé de ce qui fait son essence, le métier ne séduit plus, d’autant que le salaire moyen d’un professeur reste inférieur de 200 euros au salaire moyen national. « Les enfants de profs ne veulent plus devenir profs : c’est un signe, note Bertilsson. Plus largement, les bons élèves, pour qui le choix de ce métier était auparavant une voie naturelle, l’ont progressivement délaissé. » On observe une baisse du nombre de candidats à la formation au métier d’enseignant, qui, dès lors, devient de moins en moins sélective.
Embauchés directement par les écoles sur la base d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, les professeurs sont soumis aux règles du marché de l’emploi, ce qui aggrave les inégalités entre établissements : « Les meilleurs cherchent à être embauchés là où les élèves ont les meilleures notes », observe Bertilsson.
Bien que ce soit illégal depuis 2006, près d’un quart des professeurs de collège ont exercé sans certification en 2017-2018, selon Skolverket, la direction nationale de l’enseignement scolaire. Cette certification étant requise pour l’adhésion à un syndicat, la mobilisation devient difficile. Certains ignorent même qu’ils disposent du droit de grève, comme l’atteste une question fréquemment posée sur le site d’un syndicat. Une offense à la riche histoire des luttes autrefois menées par une profession qui, de guerre lasse, a fini par jeter l’éponge.
Violette Goarant
Journaliste, Stockholm.
----------------------
(1) Service de presse de Skolverket, la direction nationale de l’enseignement scolaire.
(2) « PISA à la loupe », Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 2016.
(3) « Statistiques sur les dépenses d’éducation », Eurostat, Kirchberg (Luxembourg).
(4) Cecilia Granestrand, « Fler utsätts för våld i skolan », Dagens Samhälle, Stockholm, 12 avril 2018.
(5) Emil Bertilsson, « Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009 », 23 mai 2014.
(6) « Lärarnas yrkesvardag », 2013, www.skolverket.se
(7) « Note d’information », no 13.13, ministère de l’éducation nationale, Paris, juillet 2013.

 ils ont changé les punks
ils ont changé les punks